Voltaire (1694-1778), Dictionnaire philosophique
Article « Auteurs »
Auteur est un nom générique qui peut, comme le nom de toutes les autres professions, signifier du bon et du mauvais, du respectable ou du ridicule, de l’utile et de l’agréable ou du fatras de rebut.
Ce nom est tellement commun à des choses différentes, qu’on dit également l’Auteur de la nature, et l’auteur des chansons du Pont-Neuf, ou l’auteur de l’Année littéraire.
Nous croyons que l’auteur d’un bon ouvrage doit se garder de trois choses, du titre, de l’épître dédicatoire, et de la préface. Les autres doivent se garder d’une quatrième, c’est d’écrire.
Quant au titre, s’il a la rage d’y mettre son nom, ce qui est souvent très dangereux, il faut du moins que ce soit sous une forme modeste ; on n’aime point à voir un ouvrage pieux, qui doit renfermer des leçons d’humilité, par Messire ou Monseigneur un tel, conseiller du roi en ses conseils, évêque et comte d’une telle ville. Le lecteur, qui est toujours malin, et qui souvent s’ennuie, aime fort à tourner en ridicule un livre annoncé avec tant de faste. On se souvient alors que l’auteur de l’Imitation de Jésus-Christ n’y a pas mis son nom.
Mais les apôtres, dites-vous, mettaient leurs noms à leurs ouvrages. Cela n’est pas vrai ; ils étaient trop modestes. Jamais l’apôtre Matthieu n’intitula son livre, Évangile de saint Matthieu ; c’est un hommage qu’on lui rendit depuis. Saint Luc lui-même, qui recueillit ce qu’il avait entendu dire, et qui dédie son livre à Théophile, ne l’intitule point Évangile de Luc. Il n’y a que saint Jean qui se nomme dans l’Apocalypse ; et c’est ce qui fit soupçonner que ce livre était de Cérinthe, qui prit le nom de Jean pour autoriser cette production.
Quoi qu’il en puisse être des siècles passés, il me paraît bien hardi dans ce siècle de mettre son nom et ses titres à la tête de ses œuvres. Les évêques n’y manquent pas ; et dans les gros in-quarto qu’ils nous donnent sous le titre de Mandements, on remarque d’abord leurs armoiries avec de beaux glands ornés de houppes ; ensuite il est dit un mot de l’humilité chrétienne, et ce mot est suivi quelquefois d’injures atroces contre ceux qui sont, ou d’une autre communion, ou d’un autre parti. Nous ne parlons ici que des pauvres auteurs profanes. Le duc de La Rochefoucauld n’intitula point ses Pensées, par Monseigneur le duc de La Rochefoucauld, pair de France, etc.
Plusieurs personnes trouvent mauvais qu’une compilation dans laquelle il y a de très beaux morceaux soit annoncée par Monsieur, etc., ci-devant professeur de l’Université, docteur en théologie, recteur, précepteur des enfants de M. le duc de…, membre d’une académie, et même de deux. Tant de dignités ne rendent pas le livre meilleur. On souhaiterait qu’il fût plus court, plus philosophique, moins rempli de vieilles fables : à l’égard des titres et qualités, personne ne s’en soucie.
L’épître dédicatoire n’a été souvent présentée que par la bassesse intéressée, à la vanité dédaigneuse.
De là vient cet amas d’ouvrages mercenaires ;
Stances, odes, sonnets, épîtres liminaires,
Où toujours le héros passe pour sans pareil,
Et, fût-il louche et borgne, est réputé soleil.Qui croirait que Rohault, soi-disant physicien, dans sa dédicace au duc de Guise, lui dit que « ses ancêtres ont maintenu aux dépens de leur sang les vérités politiques, les lois fondamentales de l’État, et les droits des souverains ? » Le Balafré et le duc de Mayenne seraient un peu surpris si on leur lisait cette épître. Et que dirait Henri IV ?
On ne sait pas que la plupart des dédicaces, en Angleterre, ont été faites pour de l’argent, comme les capucins chez nous viennent présenter des salades, à condition qu’on leur donnera pour boire.
Les gens de lettres, en France, ignorent aujourd’hui ce honteux avilissement; et jamais ils n’ont eu tant de noblesse dans l’esprit, excepté quelques malheureux qui se disent gens de lettres, dans le même sens que des barbouilleurs se vantent d’être de la profession de Raphaël, et que le cocher de Vertamont était poète.
Les préfaces sont un autre écueil. Le moi est haïssable, disait Pascal1. Parlez de vous le moins que vous pourrez, car vous devez savoir que l’amour-propre du lecteur est aussi grand que le vôtre. Il ne vous pardonnera jamais de vouloir le condamner à vous estimer. C’est à votre livre à parler pour lui, s’il parvient à être lu dans la foule.
« Les illustres suffrages dont ma pièce a été honorée devraient me dispenser de répondre à mes adversaires. Les applaudissements du public… » Rayez tout cela, croyez-moi ; vous n’avez pas eu de suffrages illustres, votre pièce est oubliée pour jamais.
« Quelques censeurs ont prétendu qu’il y a un peu trop d’événements dans le troisième acte, et que la princesse découvre trop tard dans le quatrième les tendres sentiments de son cœur pour son amant ; à cela je réponds que… » Ne réponds point, mon ami, car personne n’a parlé ni ne parlera de ta princesse. Ta pièce est tombée parce qu’elle est ennuyeuse et écrite en vers plats et barbares ; ta préface est une prière pour les morts, mais elle ne les ressuscitera pas.
D’autres attestent l’Europe entière qu’on n’a pas entendu leur système sur les compossibles, sur les supralapsaires, sur la différence qu’on doit mettre entre les hérétiques macédoniens et les hérétiques valentiniens. Mais vraiment je crois bien que personne ne t’entend, puisque personne ne te lit.
On est inondé de ces fatras et de ces continuelles répétitions, et des insipides romans qui copient de vieux romans, et de nouveaux systèmes fondés sur d’anciennes rêveries, et de petites historiettes prises dans des histoires générales.
Voulez-vous être auteur, voulez-vous faire un livre ; songez qu’il doit être neuf et utile, ou du moins infiniment agréable.
Quoi ! du fond de votre province vous m’assassinerez de plus d’un in-quarto pour m’apprendre qu’un roi doit être juste, et que Trajan était plus vertueux que Caligula ! vous ferez imprimer vos sermons qui ont endormi votre petite ville inconnue ! vous mettrez à contribution toutes nos histoires pour en extraire la vie d’un prince sur qui vous n’avez aucuns mémoires nouveaux !
Si vous avez écrit une histoire de votre temps, ne doutez pas qu’il ne se trouve quelque éplucheur de chronologie, quelque commentateur de gazette qui vous relèvera sur une date, sur un nom de baptême, sur un escadron mal placé par vous à trois cents pas de l’endroit où il fut en effet posté. Alors corrigez-vous vite.
Si un ignorant, un folliculaire se mêle de critiquer à tort et à travers, vous pouvez le confondre ; mais nommez-le rarement, de peur de souiller vos écrits.
Vous attaque-t-on sur le style, ne répondez jamais ; c’est à votre ouvrage seul de répondre.
Un homme dit que vous êtes malade, contentez-vous de vous bien porter, sans vouloir prouver au public que vous êtes en parfaite santé ; et surtout souvenez-vous que le public s’embarrasse fort peu si vous vous portez bien ou mal.
Cent auteurs compilent pour avoir du pain, et vingt folliculaires font l’extrait, la critique, l’apologie, la satire de ces compilations, dans l’idée d’avoir aussi du pain, parce qu’ils n’ont point de métier. Tous ces gens-là vont le vendredi demander au lieutenant de police de Paris la permission de vendre leurs drogues. Ils ont audience immédiatement après les filles de joie, qui ne les regardent pas, parce qu’elles savent bien que ce sont de mauvaises pratiques2.
Ils s’en retournent avec une permission tacite de faire vendre et débiter par tout le royaume leurs historiettes, leurs recueils de bons mots, la vie du bienheureux Régis, la traduction d’un poème allemand, les nouvelles découvertes sur les anguilles, un nouveau choix de vers, un système sur l’origine des cloches, les amours du crapaud. Un libraire achète leurs productions dix écus ; ils en donnent cinq au folliculaire du coin, à condition qu’il en dira du bien dans ses gazettes. Le folliculaire prend leur argent, et dit de leurs opuscules tout le mal qu’il peut. Les lésés viennent se plaindre au juif qui entretient la femme du folliculaire ; on se bat à coups de poing chez l’apothicaire Lelièvre ; la scène finit par mener le folliculaire au For-l’Évêque ; et cela s’appelle des auteurs !
Ces pauvres gens se partagent en deux ou trois bandes, et vont à la quête comme des moines mendiants ; mais n’ayant point fait de vœux, leur société ne dure que peu de jours ; ils se trahissent comme des prêtres qui courent le même bénéfice, quoiqu’ils n’aient nul bénéfice à espérer ; et cela s’appelle des auteurs !
Le malheur de ces gens-là vient de ce que leurs pères ne leur ont pas fait apprendre une profession : c’est un grand défaut dans la police moderne. Tout homme du peuple qui peut élever son fils dans un art utile, et ne le fait pas, mérite punition. Le fils d’un metteur en œuvre se fait jésuite à dix-sept ans. Il est chassé de la société à vingt-quatre, parce que le désordre de ses mœurs a trop éclaté. Le voilà sans pain ; il devient folliculaire ; il infecte la basse littérature, et devient le mépris et l’horreur de la canaille même ; et cela s’appelle des auteurs !
Les auteurs véritables sont ceux qui ont réussi dans un art véritable, soit dans l’épopée, soit dans la tragédie, soit dans la comédie, soit dans l’histoire, ou dans la philosophie ; qui ont enseigné ou enchanté les hommes. Les autres dont nous avons parlé sont parmi les gens de lettres ce que les frelons sont parmi les oiseaux.
On cite, on commente, on critique, on néglige, on oublie, mais surtout on méprise communément un auteur qui n’est qu’auteur.
A propos de citer un auteur, il faut que je m’amuse à raconter une singulière bévue du révérend P. Viret, cordelier, professeur en théologie. Il lit dans la Philosophie de l’histoire de ce bon abbé Bazin3, que « jamais aucun auteur n’a cité un passage de Moïse avant Longin, qui vécut et mourut du temps de l’empereur Aurélien. » Aussitôt le zèle de saint François s’allume : Viret4 crie que cela n’est pas vrai ; que plusieurs écrivains ont dit qu’il y avait eu un Moïse; que Josèphe même en a parlé fort au long, et que l’abbé Bazin est un impie qui veut détruire les sept sacrements. Mais, cher père Viret, vous deviez vous informer auparavant de ce que veut dire le mot citer. Il y a bien de la différence entre faire mention d’un auteur et citer un auteur. Parler, faire mention d’un auteur, c’est dire : « Il a vécu, il a écrit en tel temps. » Le citer, c’est rapporter un de ses passages : « Comme Moïse le dit dans son Exode, comme Moïse a écrit dans sa Genèse. » Or l’abbé Bazin affirme qu’aucun écrivain étranger, aucun même des prophètes juifs n’a jamais cité un seul passage de Moïse, quoiqu’il soit un auteur divin. Père Viret, en vérité, vous êtes un auteur bien malin ; mais on saura du moins par ce petit paragraphe que vous avez été un auteur.
Les auteurs les plus volumineux que l’on ait eus en France, ont été les contrôleurs généraux des finances. On ferait dix gros volumes de leurs déclarations, depuis le règne de Louis XIV seulement. Les parlements ont fait quelquefois la critique de ces ouvrages ; on y a trouvé des propositions erronées, des contradictions : mais où sont les bons auteurs qui n’aient pas été censurés ?
Notes
1 Pensées, Ire partie, IX, 23.
2 En France, il existe ce qu’on appelle l’inspection de la librairie : le chancelier en est chargé en chef ; c’est lui seul qui décide si les Français doivent lire ou croire telle proposition. Les parlements ont aussi une juridiction sur les livres ; ils font brûler par leurs bourreaux ceux qui leur déplaisent mais la mode de brûler les auteurs avec les livres commence passer. Les cours souveraines brûlent aussi en cérémonie les livres qui ne parlent point d’elles avec assez de respect. Le clergé de son côté tâche, autant qu’il peut, de s’établir une petite juridiction sur les pensées. Comment la vérité s’échappera-t-elle des mains des censeurs, des exempts de police des bourreaux et des docteurs ? Elle ira chercher une terre étrangère ; et comme il est impossible que cette tyrannie exercée sur les esprits ne donne un peu d’humeur, elle parlera avec moins de circonspection et plus de violence.
Dans le temps où M. de Voltaire a écrit, c’était ce lieutenant de police de Paris qui avait, sous le chancelier, l’inspection des livres : depuis, on lui a ôté une partie de ce département. Il n’a conservé que l’inspection des pièces de théâtre, et des ouvrages au-dessous d’une feuille d’impression. Le détail de cette partie est immense. Il n’est point permis à Paris d’imprimer qu’on a perdu son chien, sans que la police se soit assurée qn’il n’y a, dans le signalement de cette pauvre bête, aucune proposition contraire aux bonnes mœurs et à la religion.
3 Voir les Mélanges.
4 Auteur d’une Réponse à la Philosophie de l’histoire, 1767, in-12.
Voir aussi :
- Biographie de Voltaire
- Candide, chapitre troisième, commentaire
- Candide, commentaire composé du chapitre III
- Les thèmes du mal et de la Providence dans Candide
- Commentaire composé : Dictionnaire philosophique, article « guerre »
- Dictionnaire philosophique, article « beau »
- Dictionnaire philosophique, article « Bêtes »
- Micromégas
- Commentaire du chapitre 7 de Micromégas
- Zadig
- Zadig, chapitre 7
- L’Ingénu
- Traité sur la Tolérance, chapitre XXIII – Étude du texte « Prière à Dieu »
- Histoire des voyages de Scarmentado écrite par lui-même
- Œuvres complètes de Voltaire
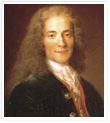 Auteur est un nom générique qui peut, comme le nom de toutes les autres professions, signifier du bon et du mauvais, du respectable ou du ridicule, de l’utile et de l’agréable ou du fatras de rebut.
Auteur est un nom générique qui peut, comme le nom de toutes les autres professions, signifier du bon et du mauvais, du respectable ou du ridicule, de l’utile et de l’agréable ou du fatras de rebut.