Le sonnet de Félix Arvers
ou une tentative de lecture sans préjugés…
Mon âme a son secret, ma vie a son mystère,
Un amour éternel en un moment conçu :
Le mal est sans espoir, aussi j’ai dû le taire,
Et celle qui l’a fait n’en a jamais rien su.Hélas ! j’aurai passé près d’elle inaperçu,
Toujours à ses côtés, et pourtant solitaire.
Et j’aurai jusqu’au bout fait mon temps sur la terre,
N’osant rien demander et n’ayant rien reçu.Pour elle, quoique Dieu l’ait faite douce et tendre,
Elle suit son chemin, distraite et sans entendre
Ce murmure d’amour élevé sur ses pas.À l’austère devoir, pieusement fidèle,
Elle dira, lisant ces vers tout remplis d’elle
"Quelle est donc cette femme ?" et ne comprendra pas.
Mes heures perdues
Qui est Félix Arvers ?
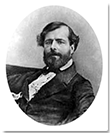 Alexis-Félix Arvers a vécu de 1806 à 1850. Ce seul sonnet l’a rendu célèbre. Ce timide personnage se serait consumé pour une femme mariée bien mystérieuse que les critiques désignent en général comme Marie Mennessier, la fille de Charles Nodier (dont on peut voir le portrait par Achille Devéria).
Alexis-Félix Arvers a vécu de 1806 à 1850. Ce seul sonnet l’a rendu célèbre. Ce timide personnage se serait consumé pour une femme mariée bien mystérieuse que les critiques désignent en général comme Marie Mennessier, la fille de Charles Nodier (dont on peut voir le portrait par Achille Devéria).
Un intéressant article de Wikipedia émet aussi d’autres hypothèses et des réponses de l’inconnue souvent en forme de pastiche.
Pour le commentaire…
Ce sonnet présente un intéressant exercice d’interprétation. C’est ce que nous allons essayer de démontrer.
En effet nous sommes en quelque sorte conditionnés par nos études scolaires. Nous abordons nos lectures l’esprit bridé par des préjugés dont l’un des moindres est de considérer les écrivains "reconnus" (surtout ceux qui appartiennent aux siècles passés) comme des êtres à part. En d’autres termes, ces personnages seraient par essence des gens "sérieux" peu susceptibles de se commettre dans des entreprises tortueuses et inavouables. Par principe, les textes soumis à l’étude des lycéens auraient une garantie de normalité, une possibilité de lecture univoque.
Nous sommes ici conduits par des schémas interprétatifs convergents :
Le paratexte nous renvoie au début du XIXe siècle, période marquée par le romantisme. Cette forme de sensibilité littéraire et artistique est dans notre esprit liée aux passions de préférence impossibles, à l’envahissement du moi et au destin malheureux (surtout celui du poète incompris).
De fait, tous les ingrédients sont présents et s’entrelacent étroitement. Nous avons donc toutes les bonnes raisons de déposer nos trouvailles dans le dossier romantisme éploré, maladie d’amour, passion malheureuse. Notre lecture pourrait en être sclérosée.
Donc, si nous creusons la veine traditionnelle, nous ferons remarquer que ce poème est bâti sur une série d’oppositions et de parallélismes.
Il prend la forme d’une confession à demi-mots : Arvers y révèle un amour secret pour une femme mariée (« À l’austère devoir, pieusement fidèle »).
C’est un poème d’inspiration romantique dans une forme classique, appartenant à la veine élégiaque.
Félix Arvers a donc écrit un sonnet pour confier à ses lecteurs le secret douloureux de son existence : un amour caché pour une femme inconnue. Il y exprime une expérience douloureuse de la passion dans le registre lyrique élégiaque, et s’inscrit dans une tradition particulière de l’amour et de la femme.
C’est effectivement le "moi" romantique qui déborde ici, l’affectivité de l’individu, particulièrement dans ses manifestations douloureuses : « Mon âme a son secret… ». Cette affirmation du moi est intimement liée à la conscience d’un destin particulier : « …ma vie a son mystère ». L’amoureux romantique qui se confie à sa page se veut unique. Cette haute idée de sa singularité explique l’abondance des pronoms personnels et des adjectifs possessifs de la première personne. Cette valorisation de "l’ego" est caractéristique du romantisme, elle constitue en outre une revanche du mal-aimé, une sorte de consolation dans la contemplation narcissique de ses propres mérites, la confirmation de son "génie" dans la fidélité au silence et au rejet.
L’idée de souffrance y est intimement mêlée : « Le mal est sans espoir… », « Hélas ! », « solitaire… ». Le poète romantique est marqué au sceau d’un destin maudit. Si l’amoureux qui souffre prend la plume, c’est parce que la douleur est la plus forte. De plus cette même douleur est une muse certaine. Musset, l’ami d’Arvers, en a d’ailleurs énoncé le principe dans le distique suivant : « Les plus désespérés sont les chants les plus beaux / Et j’en sais d’immortels qui sont de purs sanglots. » La souffrance est d’autant plus atroce qu’elle semble recouvrir d’un voile mortuaire la vie entière du poète. La commotion fatale appartient à un passé éloigné : « un amour éternel en un moment conçu. » Depuis le poète n’en a éprouvé que longues souffrances, « puisqu’elle n’en a jamais rien su » ; de plus, l’avenir est sans espoir car il ne débouche que sur la triste mort : « Et j’aurai jusqu’au bout fait mon temps sur la terre / N’osant rien demander et n’ayant rien reçu. » La souffrance exprimée ici est donc celle de l’homme seul et incompris de celle qu’il aime. C’est un thème lyrique et élégiaque particulièrement poignant. Mais pourquoi cette souffrance ?
Le poète romantique est un élu du destin. Le poète est un être délicat, à la sensibilité exacerbée, destiné à être éprouvé par « Un amour éternel en un moment conçu ». Cette passion est une véritable pathologie incurable, puisque « Le mal est sans espoir ». Pourquoi donc devoir souffrir en silence ?
La femme aimée, la muse du poète en aime un autre, avec lequel elle est mariée. L’amant s’est donc réfugié dans le silence et la réserve par respect et par grandeur d’âme dans l’exercice du devoir moral : « …aussi j’ai dû le taire ». Cette soumission au devoir fait du poète un héros tragique qui s’inscrit dans la longue lignée des amants malheureux. Comme un héros romantique prenant la pose, il se voit condamné par un destin contraire qui le grandit. L’avenir ne peut déboucher que sur la mort : « Et j’aurai jusqu’au bout fait mon temps sur la terre ».
Les deux tercets sont consacrés tout entiers à l’évocation de la bien-aimée, de l’inspiratrice : c’est une créature idéale, issu du monde divin, « douce et tendre », elle ressortit à la cohorte des anges. Elle est toute vertu pour l’édification de son soupirant (mais aussi pour son dépit : une fausse note dans le portrait !) « à l’austère devoir pieusement fidèle ». Leurs deux vies auront connu des chemins parallèles. Le chemin de la femme angélique est lié au monde de la musique ou du ruisseau pur que peut évoquer le « murmure d’amour ». Cet être qui semble appartenir à un autre monde ne peut recevoir en retour une déclaration sans équivoque. Le destin de l’amant incompris est d’autant plus poignant qu’il ne pourra jamais répondre à la question qu’elle posera sans doute : « Quelle est donc cette femme ? »
Marqué par le destin, le poète se situe dans la tradition courtoise du dévouement absolu à la dame. Cette femme appartient à un autre monde, celui de l’idéal inaccessible. Cet ange, qu’il faut garder des souillures par la réserve et le silence, devient alors muse inspiratrice et objet d’art sous la plume de son amant. Le poète transmue sa douloureuse passion en vers lyriques et élégiaques, afin d’immortaliser celle qui l’a inspirée. Arvers s’inscrirait donc dans la tradition italienne pétrarquisante.
Voilà pour l’analyse traditionnelle !
Il existe pourtant une autre grille d’analyse…
Ce poème recèle peut-être une ironie discrète, une revanche sur l’aimée pour le moins peu perspicace et figée dans son rigorisme moral. Il aurait fallu percevoir l’acrostiche du premier quatrain, repris par les derniers mots du sonnet.
Dans ce cas, l’interprétation générale serait très différente. Au lieu de la plainte d’un amant incompris, il s’agirait en quelque sorte d’une « vacherie » littéraire (bien qu’il s’agisse d’un terme peu convenable pour une « mule »).On pourrait m’objecter que cet acrostiche est fortuit. Il me semble que cette position est difficilement défendable pour plusieurs raisons :
- D’abord sa place : les acrostiches, dans les poèmes, sont toujours disposés depuis le début.
- Ensuite, le mot dessiné verticalement MULE correspond à la critique émise : le manque de perspicacité et l’entêtement.
- Enfin le dépit apparaît sur le tard : il ternit le portrait final avec la concession « quoique » et l’« austère devoir ». Le doute sur l’intuition féminine révélée par la pointe du sonnet va dans le même sens.
Dans cette hypothèse, Arvers serait moins le continuateur de la tradition du sonnet pétrarquisant qu’un annonciateur de Baudelaire par ce mélange d’adoration et d’ironie.