Bac français 2018 (Amérique du Nord)
Corrigé de la question (série L)
Objet d’étude : le personnage de roman, du XVIIe siècle à nos jours
Corpus :
- Samuel Beckett, Molloy (1951)
- Alain Robbe-Grillet, Les Gommes (1953)
- Laurent Mauvignier, Seuls (2004)
- Francis Bacon, Trois études pour un portrait de George Dyer, triptyque, huile sur toile, 89,5 x 90 cm chacun, collection privée (1963)
Samuel Beckett, Molloy (1951)
Il s’agit de l’incipit du roman.
Je suis dans la chambre de ma mère. C’est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j’y suis arrivé. Dans une ambulance peut-être, un véhicule quelconque certainement. On m’a aidé. Seul je ne serais pas arrivé. Cet homme qui vient chaque semaine, c’est grâce à lui peut-être que je suis ici. Il dit que non. Il me donne un peu d’argent et enlève les feuilles. Tant de feuilles, tant d’argent. Oui, je travaille maintenant, un peu comme autrefois, seulement je ne sais plus travailler. Cela n’a pas d’importance, paraît-il. Moi je voudrais maintenant parler des choses qui me restent, faire mes adieux, finir de mourir. Ils ne veulent pas. Oui, ils sont plusieurs, paraît-il. Mais c’est toujours le même qui vient. Vous ferez ça plus tard, dit-il. Bon. Je n’ai plus beaucoup de volonté, voyez-vous. Quand il vient chercher les nouvelles feuilles il rapporte celles de la semaine précédente. Elles sont marquées de signes que je ne comprends pas. D’ailleurs je ne les relis pas. Quand je n’ai rien fait il ne me donne rien, il me gronde. Cependant je ne travaille pas pour l’argent. Pour quoi alors ? Je ne sais pas. Je ne sais pas grand’chose, franchement. La mort de ma mère, par exemple. Était-elle déjà morte à mon arrivée ? Ou n’est-elle morte que plus tard ? Je veux dire morte à enterrer. Je ne sais pas. Peut-être ne l’a-t-on pas enterrée encore. Quoi qu’il en soit, c’est moi qui ai sa chambre. Je couche dans son lit. Je fais dans son vase. J’ai pris sa place. Je dois lui ressembler de plus en plus. Il ne me manque plus qu’un fils. J’en ai un quelque part peut-être. Mais je ne crois pas. Il serait vieux maintenant, presque autant que moi. C’était une petite boniche. Ce n’était pas le vrai amour. Le vrai amour était dans une autre. Vous allez voir. Voilà que j’ai encore oublié son nom. Il me semble quelquefois que j’ai même connu mon fils, que je me suis occupé de lui. Puis je me dis que c’est impossible. Il est impossible que j’aie pu m’occuper de quelqu’un. J’ai oublié l’orthographe aussi, et la moitié des mots. Cela n’a pas d’importance, paraît-il. Je veux bien. C’est un drôle de type, celui qui vient me voir. C’est tous les dimanches qu’il vient, paraît-il. Il n’est pas libre les autres jours. Il a toujours soif. C’est lui qui m’a dit que j’avais mal commencé, qu’il fallait commencer autrement. Moi je veux bien. J’avais commencé au commencement, figurez-vous, comme un vieux con. Voici mon commencement à moi. Ils vont quand même le garder, si j’ai bien compris. Je me suis donné du mal. Le voici. Il m’a donné beaucoup de mal. C’était le commencement, vous comprenez. Tandis que c’est presque la fin, à présent. C’est mieux, ce que je fais à présent ? Je ne sais pas. La question n’est pas là. Voici mon commencement à moi. Ça doit signifier quelque chose, puisqu’ils le gardent. Le voici.
Alain Robbe-Grillet, Les Gommes (1953)
Il s’agit de l’incipit du roman.
Dans la pénombre de la salle de café le patron dispose les tables et les chaises, les cendriers, les siphons d’eau gazeuse ; il est six heures du matin.
Il n’a pas besoin de voir clair, il ne sait même pas ce qu’il fait. Il dort encore. De très anciennes lois règlent le détail de ses gestes, sauvés pour une fois du flottement des intentions humaines ; chaque seconde marque un pur mouvement : un pas de côté, la chaise à trente centimètres, trois coups de torchon, demi-tour à droite, deux pas en avant, chaque seconde marque, parfaite, égale, sans bavure. Trente et un. Trente-deux. Trentetrois. Trente-quatre. Trente-cinq. Trente-six. Trente-sept. Chaque seconde à sa place exacte.
Bientôt malheureusement le temps ne sera plus le maître. Enveloppés de leur cerne d’erreur et de doute, les événements de cette journée, si minimes qu’ils puissent être, vont dans quelques instants commencer leur besogne, entamer progressivement l’ordonnance idéale, introduire çà et là, sournoisement, une inversion, un décalage, une confusion, une courbure, pour accomplir peu à peu leur œuvre : un jour, au début de l’hiver, sans plan, sans direction, incompréhensible et monstrueux.
Mais il est encore trop tôt, la porte de la rue vient à peine d’être déverrouillée, l’unique personnage présent en scène n’a pas encore recouvré son existence propre. II est l’heure où les douze chaises descendent doucement des tables de faux marbre où elles viennent de passer la nuit. Rien de plus. Un bras machinal remet en place le décor.
Quand tout est prêt, la lumière s’allume…
Un gros homme est là debout, le patron, cherchant à se reconnaître au milieu des tables et des chaises. Au-dessus du bar, la longue glace où flotte une image malade, le patron, verdâtre et les traits brouillés, hépatique1 et gras dans son aquarium.
De l’autre côté, derrière la vitre, le patron encore qui se dissout lentement dans le petit jour de la rue. C’est cette silhouette sans doute qui vient de mettre la salle en ordre ; elle n’a plus qu’à disparaître. Dans le miroir tremblote, déjà presque entièrement décomposé, le reflet de ce fantôme ; et au-delà, de plus en plus hésitante, la kyrielle2 indéfinie des ombres : le patron, le patron, le patron… Le Patron, nébuleuse3 triste, noyé dans son halo.
Notes
1 Hépatique : qui souffre du foie.
2 Kyrielle : suite interminable.
3 Nébuleuse : forme indécise et confuse.
Laurent Mauvignier, Seuls (2004)
Il s’agit de l’incipit du roman.
Il a voulu les villes pour réapprendre à vivre. Il a voulu les routes et d’autres aventures que celles où il dormait, comme au retour de la mer il somnolait parfois, sur les sièges en moleskine bleue des bus, avec un livre sur les genoux prêt à tomber. Il a voulu les villes et puis avoir du temps. Et ranger dans un coin de sa tête tout ce qui, pour n’être pas de lui, lui semblait étranger et venir de si loin que son regard devenait flou pour se pencher dessus. Les mots, les gestes, les attentions des autres qui peuplaient les nuits d’insomnie. Il voulait se reprendre et ne se laisser bercer que par cette vie qui s’agitait dans ses veines : parcourir des rues et des villes, d’autres regards, d’autres attentes.
Il a voulu tout ça et d’autres choses encore, qu’il savait seulement pressentir, têtu, s’accrochant à l’idée qu’il y a trop de risque et le vertige si fort que ça fait de ne pas bouger, de rester sur son canapé-lit toute la journée, devant la fenêtre de la chambre, à regarder en contrebas la fin du marché, les étalages vides et les cageots dégoulinants de légumes pourris, de fruits, avec quelques passants encore pour y traîner le regard, les chiens qui reniflent, les jets d’eau des camionnettes pour nettoyer les restes dans le vacarme du moteur, de l’eau qui racle le sol et des derniers bruits de fer des étals qu’on démonte, qu’on range dans les camions sous les cris et les rires des marchands. Leurs habitudes et lui, son habitude, pareillement, de ne pas sortir encore de sa chambre. D’attendre de vouloir, de croire qu’il y a mieux à faire dehors qu’à rester dans la chambre de l’appartement, à l’ombre tranquille et sage, tellement sage encore, de son propre besoin de marcher.
Il n’aimait pas son visage ni sa petite taille, ses cheveux et les épis qui déformaient la tête dans le miroir, tous les jours, avec l’obligation de les couvrir de gel pour les rabattre derrière les oreilles. Il n’aimait pas sa voix. Il n’aimait pas ses lunettes aux contours épais ni le menton qu’il avait, qu’il trouvait trop petit sous le sourire qu’il tenait fermé, histoire de cacher les dents jaunes et mal placées – on aurait dit une bataille avec des lances dans tous les coins, qui volent et vont chahuter l’espace. Alors il ne disait rien et trouvait normal que Pauline n’ait pas songé à être amoureuse de lui.
Il ne disait rien non plus, à cette époque, des trains de banlieue qu’en deux équipes ils aspergeaient d’eau à grands seaux, et qu’ils rinçaient en cadence sous les éclats de voix et de langues que lui ne connaissait pas, qui jaillissaient des moustaches d’un vieux Turc, des sourires craqués de soleil et des bouches édentées de Marocains, avec les chants du petit vieux qui travaillait au côté des femmes, à l’intérieur des wagons. Les rires, la bonne compagnie des femmes tranchaient avec l’acharnement des hommes à ployer sous les ordres d’un chef qui hurlait au loup pour n’importe quoi, une saleté oubliée sur la vitre, un journal pas ramassé – et sur les banquettes, des chewing-gums collant aux doigts, avec le dégoût que ça lui donnait, à lui qui ne pouvait parler à cause de la barrière de la langue, quelle langue, dur de parler, pour lui, de quoi, de qui, du bus, de la chambre, de Pauline ou, pourquoi pas, par temps d’averse, quand il ne restait qu’à attendre que le ciel ait fini de crever son abcès de pluie et que le calme vienne le libérer des autres, dire quelques fois, à voix basse, deux ou trois mots sur sa mère.
Francis Bacon, Trois études pour un portrait de George Dyer, triptyque, huile sur toile, 89,5 x 90 cm chacun, collection privée (1963)
Après avoir lu attentivement les textes du corpus, vous répondrez à la question suivante (4 points) :
En quoi les trois textes du corpus introduisent-ils de façon surprenante leurs personnages ?
Proposition de corrigé
Les trois textes du corpus sont extraits de romans du XXe et XXIe siècles : de Molloy de Samuel Beckett, des Gommes de Robbe-Grillet et de Seuls de Mauvignier. Ce sont les premières lignes de chaque récit censées présenter le cadre spatio-temporel, le sujet, les acteurs et la manière de l’auteur. Ici la caractéristique principale de ces incipits est bien la façon surprenante de présenter les personnages au lecteur.
Le Molloy de Beckett est bien déroutant dans ses paradoxes. Amnésique pour ce qui est extérieur à lui : son « vrai amour », son fils, l’existence de sa mère, il se souvient plutôt bien des relations avec son éditeur. Il prétend avoir oublié « son orthographe », mais écrit sans faute, hormis « boniche » qui aurait dû prendre deux N. Il donne l’impression d’un vieillard retombé en enfance. L’écrivain est capricieux, s’entête, ne veut rien entendre et se fait « gronder ». Comme un enfant il est fixé sur la scatologie. Ses propos sont souvent contradictoires : une affirmation est souvent suivie d’une atténuation, voire d’une négation. Le personnage semble perdu entre présent et passé, il doute de la réalité des événements. En particulier la relation avec sa mère fait de lui un frère de Meursault. Comme lui il est étranger à la mort de sa maman réduite à des conséquences pratiques en dehors de tout sentiment. La focalisation interne nous ouvre sur son vide intérieur. Molloy est un auteur qui ne sait pas pourquoi il écrit. Mais curieusement il se livre à une analyse métatextuelle obsessionnelle et absurde de son « commencement ». En effet il se voit comme un « con » dans ce « commencement » qui est une « fin ». Ainsi, dès le début du roman, le lecteur est invité à une lecture en boucle, signe que le récit ne le mènera nulle part.
Le personnage de Mauvignier partage avec Molloy cette introspection vaine. Là où la créature de Beckett emploie un « je » qui tente de trouver sa place dans le temps et l’espace, celle de Mauvignier utilise un « il » de distanciation pour parcourir un monde intérieur qui lui reste incompréhensible dans ses contradictions. « Il a voulu » sortir de lui, mais il est resté immobile, figé dans ses peurs, replié sur son vide intérieur, obligé de coexister avec un corps qu’il n’aime pas. Ce velléitaire est muré dans son silence par incapacité à partager. Lui aussi est resté un enfant rattaché à sa mère. Lui aussi est « têtu » dans ses rêves d’ailleurs.
Alain Robbe-Grillet nous fait entrer de plain-pied dans le portrait de son cabaretier par une description en mouvement et par un présent d’énonciation (à valeur gnomique également par la répétition somnambulique de la mise en ordre matinale). Il utilise la focalisation externe pour décrire moins un homme qu’un automate. De plus ce personnage est fluctuant : d’abord inconsistant, il prend peu à peu la forme d’un gros poisson dans son bocal avant de se dissoudre en images kaléidoscopiques de « nébuleuse ».
Tous ces textes présentent des images brouillées, tous recourent à des notations successives qui floutent le portrait. Nous avons du mal à cerner ces personnages dont la réalité nous fuit. Le titre choisi par Robbe-Grillet, Les Gommes, est bien significatif dans cette entreprise d’effacement progressif ou de correction permanente de personnages qui se défont.
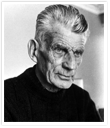 Je suis dans la chambre de ma mère. C’est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j’y suis arrivé. Dans une ambulance peut-être, un véhicule quelconque certainement. On m’a aidé. Seul je ne serais pas arrivé. Cet homme qui vient chaque semaine, c’est grâce à lui peut-être que je suis ici. Il dit que non. Il me donne un peu d’argent et enlève les feuilles. Tant de feuilles, tant d’argent. Oui, je travaille maintenant, un peu comme autrefois, seulement je ne sais plus travailler. Cela n’a pas d’importance, paraît-il. Moi je voudrais maintenant parler des choses qui me restent, faire mes adieux, finir de mourir. Ils ne veulent pas. Oui, ils sont plusieurs, paraît-il. Mais c’est toujours le même qui vient. Vous ferez ça plus tard, dit-il. Bon. Je n’ai plus beaucoup de volonté, voyez-vous. Quand il vient chercher les nouvelles feuilles il rapporte celles de la semaine précédente. Elles sont marquées de signes que je ne comprends pas. D’ailleurs je ne les relis pas. Quand je n’ai rien fait il ne me donne rien, il me gronde. Cependant je ne travaille pas pour l’argent. Pour quoi alors ? Je ne sais pas. Je ne sais pas grand’chose, franchement. La mort de ma mère, par exemple. Était-elle déjà morte à mon arrivée ? Ou n’est-elle morte que plus tard ? Je veux dire morte à enterrer. Je ne sais pas. Peut-être ne l’a-t-on pas enterrée encore. Quoi qu’il en soit, c’est moi qui ai sa chambre. Je couche dans son lit. Je fais dans son vase. J’ai pris sa place. Je dois lui ressembler de plus en plus. Il ne me manque plus qu’un fils. J’en ai un quelque part peut-être. Mais je ne crois pas. Il serait vieux maintenant, presque autant que moi. C’était une petite boniche. Ce n’était pas le vrai amour. Le vrai amour était dans une autre. Vous allez voir. Voilà que j’ai encore oublié son nom. Il me semble quelquefois que j’ai même connu mon fils, que je me suis occupé de lui. Puis je me dis que c’est impossible. Il est impossible que j’aie pu m’occuper de quelqu’un. J’ai oublié l’orthographe aussi, et la moitié des mots. Cela n’a pas d’importance, paraît-il. Je veux bien. C’est un drôle de type, celui qui vient me voir. C’est tous les dimanches qu’il vient, paraît-il. Il n’est pas libre les autres jours. Il a toujours soif. C’est lui qui m’a dit que j’avais mal commencé, qu’il fallait commencer autrement. Moi je veux bien. J’avais commencé au commencement, figurez-vous, comme un vieux con. Voici mon commencement à moi. Ils vont quand même le garder, si j’ai bien compris. Je me suis donné du mal. Le voici. Il m’a donné beaucoup de mal. C’était le commencement, vous comprenez. Tandis que c’est presque la fin, à présent. C’est mieux, ce que je fais à présent ? Je ne sais pas. La question n’est pas là. Voici mon commencement à moi. Ça doit signifier quelque chose, puisqu’ils le gardent. Le voici.
Je suis dans la chambre de ma mère. C’est moi qui y vis maintenant. Je ne sais pas comment j’y suis arrivé. Dans une ambulance peut-être, un véhicule quelconque certainement. On m’a aidé. Seul je ne serais pas arrivé. Cet homme qui vient chaque semaine, c’est grâce à lui peut-être que je suis ici. Il dit que non. Il me donne un peu d’argent et enlève les feuilles. Tant de feuilles, tant d’argent. Oui, je travaille maintenant, un peu comme autrefois, seulement je ne sais plus travailler. Cela n’a pas d’importance, paraît-il. Moi je voudrais maintenant parler des choses qui me restent, faire mes adieux, finir de mourir. Ils ne veulent pas. Oui, ils sont plusieurs, paraît-il. Mais c’est toujours le même qui vient. Vous ferez ça plus tard, dit-il. Bon. Je n’ai plus beaucoup de volonté, voyez-vous. Quand il vient chercher les nouvelles feuilles il rapporte celles de la semaine précédente. Elles sont marquées de signes que je ne comprends pas. D’ailleurs je ne les relis pas. Quand je n’ai rien fait il ne me donne rien, il me gronde. Cependant je ne travaille pas pour l’argent. Pour quoi alors ? Je ne sais pas. Je ne sais pas grand’chose, franchement. La mort de ma mère, par exemple. Était-elle déjà morte à mon arrivée ? Ou n’est-elle morte que plus tard ? Je veux dire morte à enterrer. Je ne sais pas. Peut-être ne l’a-t-on pas enterrée encore. Quoi qu’il en soit, c’est moi qui ai sa chambre. Je couche dans son lit. Je fais dans son vase. J’ai pris sa place. Je dois lui ressembler de plus en plus. Il ne me manque plus qu’un fils. J’en ai un quelque part peut-être. Mais je ne crois pas. Il serait vieux maintenant, presque autant que moi. C’était une petite boniche. Ce n’était pas le vrai amour. Le vrai amour était dans une autre. Vous allez voir. Voilà que j’ai encore oublié son nom. Il me semble quelquefois que j’ai même connu mon fils, que je me suis occupé de lui. Puis je me dis que c’est impossible. Il est impossible que j’aie pu m’occuper de quelqu’un. J’ai oublié l’orthographe aussi, et la moitié des mots. Cela n’a pas d’importance, paraît-il. Je veux bien. C’est un drôle de type, celui qui vient me voir. C’est tous les dimanches qu’il vient, paraît-il. Il n’est pas libre les autres jours. Il a toujours soif. C’est lui qui m’a dit que j’avais mal commencé, qu’il fallait commencer autrement. Moi je veux bien. J’avais commencé au commencement, figurez-vous, comme un vieux con. Voici mon commencement à moi. Ils vont quand même le garder, si j’ai bien compris. Je me suis donné du mal. Le voici. Il m’a donné beaucoup de mal. C’était le commencement, vous comprenez. Tandis que c’est presque la fin, à présent. C’est mieux, ce que je fais à présent ? Je ne sais pas. La question n’est pas là. Voici mon commencement à moi. Ça doit signifier quelque chose, puisqu’ils le gardent. Le voici.