Sujets du bac de français 2018 (Afrique)
Séries S et ES
Objet d’étude : le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours
Corpus :
- Texte A : Marivaux, Les Fausses Confidences, acte I, scène 14, 1737
- Texte B : Beaumarchais, Le Barbier de Séville, acte II, scène 2, 1775
- Texte C : Feydeau, Occupe-toi d’Amélie !, acte I, scène 10, 1911
Marivaux, Les Fausses Confidences, acte I, scène 14
Dorante est amoureux d’Araminte. Sur les conseils de Dubois, son ancien valet, maintenant au service d’Araminte, il s’est fait engager auprès d’elle comme intendant. Dubois, dans cette scène, joue le rôle d’intermédiaire.
DUBOIS. — Il1 vous adore ; il y a six mois qu’il n’en vit point, qu’il donnerait sa vie pour avoir le plaisir de vous contempler un instant. Vous avez dû voir qu’il a l’air enchanté quand il vous parle.
ARAMINTE. — Il y a bien en effet quelque petite chose qui m’a paru extraordinaire. Eh ! juste Ciel ! le pauvre garçon, de quoi s’avise-t-il ?
DUBOIS. — Vous ne croiriez pas jusqu’où va sa démence : elle le ruine, elle lui coupe la gorge. Il est bien fait, d’une figure passable, bien élevé et de bonne famille ; mais il n’est pas riche : et vous saurez qu’il n’a tenu qu’à lui d’épouser des femmes qui l’étaient, et de fort aimable, ma foi, qui offraient de lui faire sa fortune, et qui auraient mérite qu’on la leur fît à elles-mêmes. Il y en a une qui n’en saurait revenir, et qui le poursuit encore tous les jours ; je le sais, car je l’ai rencontrée.
ARAMINTE. avec négligence. — Actuellement ?
DUBOIS. — Oui, Madame, actuellement : une grande brune très piquante2 et qu’il fuit. Il n’y a pas moyen, Monsieur refuse tout. « Je les tromperais » me disait-il, je ne puis les aimer, mon cœur est parti » ; ce qu’il disait quelquefois la larme à l’œil ; car il sent bien son tort.
ARAMINTE. — Cela est fâcheux ; mais où m’a-t-il vue avant que de venir chez moi, Dubois ?
DUBOIS. — Hélas ! Madame, ce fut un jour que vous sortîtes de l’Opéra, qu’il perdit la raison. C’était un vendredi, je m’en ressouviens ; oui, un vendredi ; il vous vit descendre l’escalier, à ce qu’il me raconta, et vous suivit jusqu’à votre carrosse ; il avait demandé votre nom, et je le trouvai qui était comme extasié ; il ne remuait plus.
ARAMINTE. — Quelle aventure !
DUBOIS. — J’eus beau lui crier : « Monsieur » ! Point de nouvelles, il n’y avait plus personne au logis. À la fin, pourtant, il revint à lui avec un air égaré ; je le jetai dans une voiture, et nous retournâmes à la maison. J’espérais que cela se passerait, car je l’aimais ; c’est le meilleur maître ! Point du tout, il n’y avait plus de ressource. Ce bon sens, cet esprit jovial, cette humeur charmante, vous aviez tout expédié, et des le lendemain nous ne fîmes plus tous deux, lui, que rêver à vous, que vous aimer ; moi d’épier depuis le matin jusqu’au soir où vous alliez.
ARAMINTE. — Tu m’étonnes à un point !…
DUBOIS. — Je me fis même ami d’un de vos gens qui n’y est plus, un garçon fort exact, qui m’instruisait, et à qui je payais bouteille. « C’est à la Comédie qu’on va ». me disait-il ; et je courais faire mon rapport, sur lequel, dés quatre heures, mon homme était à la porte. « C’est chez Madame celle-ci, c’est chez Madame celle-là » ; et, sur cet avis, nous allions toute la soirée habiter la rue, ne vous déplaise, pour voir Madame entrer et sortir, lui dans un fiacre, et moi derrière ; tous deux morfondus et gelés, car c’était dans l’hiver ; lui ne s’en soucient guère, moi jurant par-ci par-là pour me soulager.
ARAMINTE. — Est-il possible ?
DUBOIS. — Oui. Madame. À la fin, ce train de vie m’ennuya ; ma santé s’altérait, la sienne aussi. Je lui fis accroire3 que vous étiez à la campagne ; il le crut, et j’eus quelque repos ; mais n’alla-t-il pas deux jours après vous rencontrer aux Tuileries, où il avait été s’attrister de votre absence. Au retour, il était furieux, il voulut me battre, tout bon qu’il est ; moi, je ne le voulus point, et je le quittai. Mon bonheur ensuite m’a mis chez Madame, où, à force de se démener, je le trouve parvenu à votre intendance ; ce qu’il ne troquerait pas contre la place d’un empereur.
ARAMINTE. — Y a-t-il rien de si particulier ? Je suis si lasse d’avoir des gens qui me trompent, que je me réjouissais de l’avoir, parce qu’il a de la probité4, ce n’est pas que je sois fâchée, car je suis bien au-dessus de cela.
DUBOIS. — Il y aura de la bonté à le renvoyer. Plus il voit Madame, plus il s’achève.
ARAMINTE. — Vraiment, je le renverrais bien ; mais ce n’est pas là ce qui le guérira. Je ne sais que dire à Monsieur Rémy, qui me l’a recommandé ; et ceci m’embarrasse. Je ne vois pas trop comment m’en défaire honnêtement.
DUBOIS. — Oui ; mais vous ferez un incurable, Madame.
ARAMINTE, vivement. — Oh ! tant pis pour lui. Je suis dans des circonstances où je ne saurais me passer d’un intendant ; et puis, il n’y a pas tant de risque que tu ne le crois. Au contraire, s’il y avait quelque chose qui pût ramener cet homme, c’est l’habitude de me voir plus qu’il n’a fait ; ce serait même un service à lui rendre.
DUBOIS. — Oui, c’est un remède bien innocent.Notes
1 Il : Dorante.
2 Piquante : charmante.
3 Accroire : croire.
4 Probité : honnêteté.
Beaumarchais, Le Barbier de Séville, acte II, scène 2
Bartholo retient chez lui Rosine, jeune femme innocente qu’il a élevée et qui lui est promise. Lindor, qui l’a aperçue à sa fenêtre, est tombé amoureux d’elle. Il charge son valet Figaro de jouer les intermédiaires en révélant ses sentiments à la jeune fille.
Rosine.
Avec qui parliez-vous donc là-bas si vivement ? Je n’entendais pas, mais…
Figaro.
Avec un jeune bachelier1 de mes parents, de la plus grande espérance ; plein d’esprit, de sentiments, de talents, et d’une figure fort revenante.
Rosine.
Oh ! tout à fait bien, je vous assure ! il se nomme…
Figaro.
Lindor. Il n’a rien : mais, s’il n’eût pas quitté brusquement Madrid, il pouvait y trouver quelque bonne place.
Rosine, étourdiment.
Il en trouvera, monsieur Figaro, il en trouvera. Un jeune homme tel que vous le dépeignez n’est pas fait pour rester inconnu.
Figaro, à part.
Fort bien. (Haut.) Mais il a un grand défaut, qui nuira toujours à son avancement.
Rosine.
Un défaut, monsieur Figaro ! un défaut ! En êtes-vous bien sûr ?
Figaro.
Il est amoureux.
Rosine.
Il est amoureux ! et vous appelez cela un défaut ?
Figaro.
À la vérité, ce n’en est un que relativement à sa mauvaise fortune.
Rosine.
Ah ! que le sort est injuste ! et nomme-t-il la personne qu’il aime ? Je suis d’une curiosité…
Figaro.
Vous êtes la dernière, madame, à qui je voudrais faire une confidence de cette nature.
Rosine, vivement.
Pourquoi, monsieur Figaro ? je suis discrète ; ce jeune homme vous appartient, il m’intéresse infiniment… dites donc.
Figaro, la regardant finement.
Figurez-vous la plus jolie petite mignonne, douce, tendre, accorte2 et fraîche, agaçant l’appétit ; pied furtif, taille adroite, élancée, bras dodus, bouche rosée, et des mains ! des joues ! des dents ! des yeux !…
Rosine.
Qui reste en cette ville ?
Figaro.
En ce quartier.
Rosine.
Dans cette rue peut-être ?
Figaro.
À deux pas de moi.
Rosine.
Ah ! que c’est charmant… pour monsieur votre parent ! Et cette personne est…
Figaro.
Je ne l’ai pas nommée ?
Rosine, vivement.
C’est la seule chose que vous ayez oubliée, monsieur Figaro. Dites donc, dites donc vite ; si l’on rentrait, je ne pourrais plus savoir…
Figaro.
Vous le voulez absolument, madame ? Eh bien ! cette personne est… la pupille3 de votre tuteur.
Rosine.
La pupille… ?
Figaro.
Du docteur Bartholo ; oui, Madame.
Rosine, avec émotion.
Ah ! Monsieur Figaro !… je ne vous crois pas, je vous assure.
Figaro.
Et c’est ce qu’il brûle de venir vous persuader lui-même.
Rosine.
Vous me faites trembler, Monsieur Figaro.
Figaro.
Fi donc, trembler ! mauvais calcul, Madame ; quand on cède à la peur du mal, on ressent déjà le mal de la peur. D’ailleurs, je viens de vous débarrasser de tous vos surveillants jusqu’à demain.
Rosine.
S’il m’aime, il doit me le prouver en restant absolument tranquille.
Figaro.
Eh, madame ! amour et repos peuvent-ils habiter en même cœur ? La pauvre jeunesse est si malheureuse aujourd’hui, qu’elle n’a que ce terrible choix : amour sans repos, ou repos sans amour.
Rosine, baissant les yeux.
Repos sans amour… paraît…
Figaro.
Ah ! bien languissant4. Il semble, en effet, qu’amour sans repos se présente de meilleure grâce : et pour moi, si j’étais femme…
Rosine, avec embarras.
Il est certain qu’une jeune personne ne peut empêcher un honnête homme de l’estimer.
Figaro.
Aussi mon parent vous estime-t-il infiniment.
Rosine.
Mais s’il allait faire quelque imprudence, Monsieur Figaro, il nous perdrait.
Figaro, à part.
Il nous perdrait ! (Haut.) Si vous le lui défendiez expressément par une petite lettre… Une lettre a bien du pouvoir.
Rosine lui donne la lettre qu’elle vient d’écrire.
Je n’ai pas le temps de recommencer celle-ci ; mais en la lui donnant, dites-lui… dites-lui bien… (Elle écoute.)
Figaro.
Personne, madame.
Rosine.
Que c’est par pure amitié tout ce que je fais.
Figaro.
Cela parle de soi. Tudieu5 ! l’amour a bien une autre allure !
Notes
1 Bachelier : jeune homme de bonne famille célibataire. En réalité, Lindor est le Comte Almaviva, déguisé en pauvre jeune homme, afin de se faire aimer pour lui-même.
2 Accorte : aimable.
3 Pupille : personne mineure placée sous l’autorité d’un tuteur.
4 Languissant : ici, maladif.
5 Tudieu : juron.
Feydeau, Occupe-toi d’Amélie !, acte I, scène 10
Le Général Koschnadieff est envoyé auprès d’Amélie par le prince Nicolas de Palestrie pour lui obtenir un rendez-vous avec cette dernière.
Acte I, scène X
AMÉLIE, KOSCHNADIEFF
Amélie, paraissant à la baie1 et descendant par la droite du canapé. — Monsieur ?
Koschnadieff, s’inclinant et se présentant. — Général Koschnadieff ! (Amélie lui indique le canapé pour l’inviter à s’asseoir près d’elle ; du geste, il décline respectueusement cet honneur et, allant jusqu’au piano sur lequel il dépose son chapeau, il prend la chaise qu’il descend près du canapé. Se présentant à nouveau.) Général Koschnadieff, premier aide de camp de Son Altesse Royale le prince Nicolas de Palestrie.
Sur un nouveau signe d’Amélié, il s’assied sur la chaise qu’il a descendue.
Amélie. — Oh ! Général, très honorée, mais… ?
Koschnadieff. — C’est Son Altesse qui m’envoie vers vous.
Amélie, étonnée. — Son Altesse ?
Koschnadieff. — Le prince est donc très amoureux de vous.
Amélie. — De moi ?… comment ? mais Son Altesse ne me connaît pas.
Koschnadieff. — Je vous demande pardon ! Vous étiez bien une fois au gala du Français2, lors de la dernière visite officielle du prince à Paris ?… aux fauteuils de l’orchestre ?
Amélie. — En effet, mais…
Koschnadieff. — Eh bien, le prince vous a remarquée.
Amélie, très flattée. — Moi ! non, vraiment ? oh !
Koschnadieff. — Certes !… Il a même demandé au président de la République qui vous étiez !
Amélie, n’en croyant pas ses oreilles. — Non ?
Koschnadieff. — Mais le président n’a pas pu le renseigner.
Amélie. – Ah ?
Koschnadieff. – Non !
Amélie. – Tiens !
Koschnadieff. — Alors, nous avons délégué un attaché de l’ambassade, qui s’est mis en rapport avec la police, laquelle, le lendemain, nous a fait parvenir une fiche.
Amélie, estomaquée. — Une… une fiche !
Koschnadieff, confirmant de la tête. — Une fiche. C’est comme cela que le prince a eu la joie d’apprendre qui vous étiez.
Amélie, aimable, mais vexée. — Ah ! c’est… c’est d’un galant !
Koschnadieff. — Oh ! Son Altesse est très éprise ! Elle a le pépin3… comme vous dites ! (Rapprochant sa chaise d’Amélie, et confidentiellement, presque dans l’oreille.) Je crois que si elle est revenue incognito, c’est beaucoup pour vous.
Amélie. — À ce point !
Koschnadieff, hoche la tête affirmativement, puis. — À ce ! Son Altesse est arrivée ce matin… En ce moment, elle fait la visite au président, qui la lui rendra un quart d’heure après ; après quoi, elle sera débarrassée !
Amélie. — Oui, le fait est que ces petites cérémonies… !
Koschnadieff. — Qu’est-ce que vous voulez ? c’est le protocole ! (Revenant à ses moutons.) Si je vous disais que la première chose que le prince m’a dite en s’installant à l’hôtel — sur l’honneur ! — c’est une parole d’amour pour vous.
Amélie, sur un ton légèrement langoureux. — Le prince est donc sentimental ?
Koschnadieff, élevant la main au-dessus de sa tête pour exprimer l’immensité de la chose. — Très !… (Comme à l’appui de son dire.) Il m’a dit : « Koschnadieff, mon bon ! Cours chez elle et arrange-moi ça, hein ? Sur toi je compte ! »
Amélie, un peu estomaquée. — Ah ?… Ah ? comme ça ?
Koschnadieff. – Positivement.
Amélie, entre chair et cuir4. — Eh ben, mon colon !
Koschnadieff. — Oh ! il est très amoureux ! (Changeant de ton.) Et alors, voilà, je fais la démarche.
Amélie, interloquée. — Ah ? Ah ! Alors c’est vous qui…
Koschnadieff, étonné de la surprise d’Amélie. — Quoi ?… on dirait que je vous étonne ?…
Amélie. — Du tout, du tout ; seulement, n’est-ce pas… ?
Koschnadieff. — Oui, je comprends ! c’est un peu délicat !… Vous n’êtes peut-être pas habituée à ce genre de démarche !
Amélie. — Oh ! c’est pas ça !… Vous pensez bien, n’est-ce pas ? que tous les jours… Seulement, tout de même, ordinairement, c’est pas un général.
Koschnadieff. — Vraiment ?… Tiens, tiens, tiens !
Amélie. – Non.
Koschnadieff. — Comme c’est curieux !
Amélie. – Ah ?
Koschnadieff, avec fierté. — En Palestrie, c’est moi que j’ai l’honneur d’être chargé !… (Comme raison de cette charge : ) Je suis l’aide de camp de Son Altesse !
Amélie, s’inclinant avec un peu d’ironie. — Évidemment ! évidemment !
Koschnadieff, se levant comme mû par un ressort, et les deux mains sur les hanches, bien en face d’Amélie. — Alors !… dites-moi quoi ? voyons !… quand ?
Amélie, se levant également. — Quoi, quand ?
Koschnadieff, très à la hussarde. — Quelle nuit voulez-vous ?
Amélie, avec un sursaut d’effarement. — Hein ? Ah ! non, vous savez ? vous avez une façon de vous coller ça dans l’estomac !… Mais je ne suis pas libre, général ! J’ai un ami !Notes
1 La baie : la porte-fenêtre.
2 Français : nom couramment donné à la Comédie-Française.
3 Le pépin : pour « le béguin », avoir un faible pour quelqu’un.
4 Entre chair et cuir : à part.
Après avoir lu attentivement les textes du corpus, vous répondrez à la question suivante (4 points) :
Quelles stratégies ont en commun les personnages d’intermédiaires dans les trois textes du corpus ?
Vous traiterez ensuite, au choix, l’un des sujets suivants (16 points) :
Commentaire
Vous ferez le commentaire du texte de Marivaux (texte A).
Dissertation
Au théâtre, existe-t-il vraiment des personnages secondaires ?
Vous répondrez à cette question en vous fondant sur les textes du corpus, ainsi que sur les textes et les œuvres que vous avez lus et étudiés.
Écriture d’invention
Imaginez le monologue de Rosine, suite au départ de Figaro (texte B).
Votre texte comportera une quarantaine de lignes au minimum.
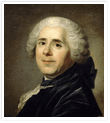
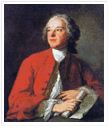 Rosine.
Rosine. Amélie, paraissant à la baie1 et descendant par la droite du canapé. — Monsieur ?
Amélie, paraissant à la baie1 et descendant par la droite du canapé. — Monsieur ?