Bac français 2019 (Afrique, Europe, Proche-Orient)
Corrigé de la question (séries S et ES)
Objet d’étude : le texte théâtral et sa représentation, du XVIIe siècle à nos jours
Corpus :
- Texte A : Jean Racine, Britannicus, acte II, scène 2, 1670
- Texte B : Albert Camus, Caligula, acte I, scènes 3 et 4, 1944
- Texte C : Eugène Ionesco, Le Roi se meurt, 1962
Jean Racine, Britannicus, acte II, scène 2, 1670
Néron, empereur de Rome entre 54 et 68, vient de tomber subitement amoureux de Junie, qui aime Britannicus, demi-frère de l’empereur. Il la fait enlever en pleine nuit par ses soldats pour la séquestrer dans son palais. Il s’adresse à Narcisse, son confident.
NÉRON
Narcisse, c’en est fait, Néron est amoureux.
NARCISSE
Vous !
NÉRON
Depuis un moment ; mais pour toute ma vie.
J’aime, que dis-je, aimer ? j’idolâtre Junie.NARCISSE
Vous l’aimez ?
NÉRON
Excité d’un désir curieux,
Cette nuit je l’ai vue arriver en ces lieux,
Triste, levant au ciel ses yeux mouillés de larmes,
Qui brillaient au travers des flambeaux et des armes,
Belle sans ornement, dans le simple appareil1
D’une beauté qu’on vient d’arracher au sommeil.
Que veux-tu ? Je ne sais si cette négligence,
Les ombres, les flambeaux, les cris et le silence,
Et le farouche aspect de ses fiers ravisseurs,
Relevaient de ses yeux les timides douceurs.
Quoi qu’il en soit, ravi d’une si belle vue,
J’ai voulu lui parler, et ma voix s’est perdue :
Immobile, saisi d’un long étonnement,
Je l’ai laissé passer dans son appartement.
J’ai passé dans le mien. C’est là que, solitaire,
De son image en vain j’ai voulu me distraire.
Trop présente à mes yeux, je croyais lui parler ;
J’aimais jusqu’à ses pleurs que je faisais couler.
Quelquefois, mais trop tard, je lui demandais grâce ;
J’employais les soupirs, et même la menace.
Voilà comme, occupé de mon nouvel amour,
Mes yeux, sans se fermer, ont attendu le jour.
Mais je m’en fais peut-être une trop belle image :
Elle m’est apparue avec trop d’avantage,
Narcisse, qu’en dis-tu ?NARCISSE
Quoi ! seigneur, croira-t-on
Qu’elle ait pu si longtemps se cacher à Néron ?NÉRON
Tu le sais bien, Narcisse. Et, soit que sa colère
M’imputât le malheur qui lui ravit son frère2 ;
Soit que son cœur, jaloux d’une austère fierté,
Enviât à nos yeux sa naissante beauté ;
Fidèle à sa douleur, et dans l’ombre enfermée,
Elle se dérobait même à sa renommée :
Et c’est cette vertu, si nouvelle à la cour,
Dont la persévérance irrite mon amour.
Quoi, Narcisse ! tandis qu’il n’est point de Romaine
Que mon amour n’honore et ne rende plus vaine3,
Qui, dès qu’à ses regards elle ose se fier,
Sur le cœur de César4 ne les vienne essayer ;
Seule, dans son palais, la modeste Junie
Regarde leurs honneurs comme une ignominie5,
Fuit, et ne daigne pas peut-être s’informer
Si César est aimable, ou bien s’il sait aimer !Notes
1 Dans le simple appareil : comme nue.
2 Junie pense que Néron est la cause de la mort de son frère.
3 Vaine : vaniteuse, fière d’elle.
4 Par « César », Néron se désigne lui-même, comme Empereur. Il le fait à nouveau au vers 55.
5 Ignominie : déshonneur extrême.
Albert Camus, Caligula, acte I, scènes 3 et 4, 1944
Caligula, empereur de Rome entre 37 et 41 après J.-C., se retrouve ici avec Hélicon, son confident.
SCÈNE III
La scène reste vide quelques secondes. Caligula entre furtivement par la gauche. Il a l’air égaré, il est sale, il a les cheveux pleins d’eau et les jambes souillées. Il porte plusieurs fois la main à sa bouche. Il avance vers le miroir et s’arrête dès qu’il aperçoit sa propre image. Il grommelle des paroles indistinctes, puis va s’asseoir, à droite, les bras pendants entre les genoux écartés. Hélicon entre à gauche. Apercevant Caligula, il s’arrête à l’extrémité de la scène et l’observe en silence. Caligula se retourne et le voit. Un temps.
SCÈNE IV
HÉLICON, d’un bout de la scène à l’autre. Bonjour, Caïus1.
CALIGULA, avec naturel.
Bonjour, Hélicon.
Silence.
HÉLICON
Tu sembles fatigué ?
CALIGULA
J’ai beaucoup marché.
HÉLICON
Oui, ton absence a duré longtemps.
Silence.
CALIGULA
C’était difficile à trouver.
HÉLICON
Quoi donc ?
CALIGULA
Ce que je voulais.
HÉLICON
Et que voulais-tu ?
CALIGULA, toujours naturel. La lune.
HÉLICON
Quoi ?
CALIGULA
Oui, je voulais la lune.
HÉLICON
Ah !
Silence. Hélicon se rapproche.
Pour quoi faire ?
CALIGULA
Eh bien !… C’est une des choses que je n’ai pas.
HÉLICON
Bien sûr. Et maintenant, tout est arrangé ?
CALIGULA
Non, je n’ai pas pu l’avoir.
HÉLICON
C’est ennuyeux.
CALIGULA
Oui, c’est pour cela que je suis fatigué.
Un temps.
CALIGULA
Hélicon !
HÉLICON
Oui, Caïus.
CALIGULA
Tu penses que je suis fou.
HÉLICON
Tu sais bien que je ne pense jamais. Je suis bien trop intelligent pour ça.
CALIGULA
Oui. Enfin ! Mais je ne suis pas fou et même je n’ai jamais été aussi raisonnable. Simplement, je me suis senti tout d’un coup un besoin d’impossible. (Un temps.) Les choses, telles qu’elles sont, ne me semblent pas satisfaisantes.
HÉLICON
C’est une opinion assez répandue.
CALIGULA,
II est vrai. Mais je ne le savais pas auparavant. Maintenant, je sais. (Toujours naturel.) Ce monde, tel qu’il est fait, n’est pas supportable. J’ai donc besoin de la lune, ou du bonheur, ou de l’immortalité, de quelque chose qui soit dément peut-être, mais qui ne soit pas de ce monde.
HÉLICON
C’est un raisonnement qui se tient. Mais, en général, on ne peut pas le tenir jusqu’au bout.
CALIGULA, se levant, mais avec la même simplicité.
Tu n’en sais rien. C’est parce qu’on ne le tient jamais jusqu’au bout que rien n’est obtenu. Mais il suffit peut-être de rester logique jusqu’à la fin.
Il regarde Hélicon.
Je sais aussi ce que tu penses. Que d’histoires pour la mort d’une femme2 ! Non, ce n’est pas cela. Je crois me souvenir, il est vrai, qu’il y a quelques jours, une femme que j’aimais est morte. Mais qu’est-ce que l’amour ? Peu de chose. Cette mort n’est rien, je te le jure ; elle est seulement le signe d’une vérité qui me rend la lune nécessaire. C’est une vérité toute simple et toute claire, un peu bête, mais difficile à découvrir et lourde à porter.
HÉLICON
Et qu’est-ce donc que cette vérité, Caïus ?
CALIGULA, détourné, sur un ton neutre.
Les hommes meurent et ils ne sont pas heureux.
HÉLICON, après un temps.
Allons, Caïus, c’est une vérité dont on s’arrange très bien. Regarde autour de toi. Ce n’est pas cela qui les empêche de déjeuner.
CALIGULA, avec un éclat soudain.
Alors, c’est que tout, autour de moi, est mensonge, et moi, je veux qu’on vive dans la vérité ! Et justement, j’ai les moyens de les faire vivre dans la vérité. Car je sais ce qui leur manque, Hélicon. Ils sont privés de la connaissance et il leur manque un professeur qui sache ce dont il parle.
HÉLICON
Ne t’offense pas, Caïus, de ce que je vais te dire. Mais tu devrais d’abord te reposer.
CALIGULA, s’asseyant et avec douceur.
Cela n’est pas possible, Hélicon, cela ne sera plus jamais possible.
HÉLICON
Et pourquoi donc ?
CALIGULA
Si je dors, qui me donnera la lune ?
HÉLICON, après un silence. Cela est vrai.Caligula se lève avec un effort visible.
Notes
1 Caïus : prénom de Caligula.
2 Une femme : il s’agit de Drusilla, qui est la sœur de Caligula et qui aurait été son amante.
Eugène Ionesco, Le Roi se meurt, 1962
Le roi Bérenger Ier est mourant, mais refuse la fatalité de la mort. Il est entouré de ses deux femmes, Marie, qui éprouve de l’empathie pour lui, et Marguerite, qui l’exhorte à accepter son destin. Sont également présents sur scène : son médecin, Juliette (infirmière et femme de ménage) et un garde.
LE ROI
Comment m’y prendre ? On ne peut pas, ou bien on ne veut pas m’aider. Moi-même, je ne puis m’aider. Ô soleil, aide-moi soleil, chasse l’ombre, empêche la nuit. Soleil, soleil éclaire toutes les tombes, entre dans tous les coins sombres et les trous et les recoins, pénètre en moi. Ah ! Mes pieds commencent à refroidir, viens me réchauffer, que tu entres dans mon corps, sous ma peau, dans mes yeux. Rallume leur lumière défaillante, que je voie, que je voie, que je voie. Soleil, soleil, me regretteras-tu ? Petit soleil, bon soleil, défends-moi. Dessèche et tue le monde entier s’il faut un petit sacrifice. Que tous meurent pourvu que je vive éternellement même tout seul dans le désert sans frontières. Je m’arrangerai avec la solitude. Je garderai le souvenir des autres, je les regretterai sincèrement. Je peux vivre dans l’immensité transparente du vide. Il vaut mieux regretter que d’être regretté. D’ailleurs, on ne l’est pas. Lumière des jours, au secours !
LE MÉDECIN, à Marie.
Ce n’est pas de cette lumière que vous lui parliez. Ce n’est pas ce désert dans la durée que vous lui recommandiez. Il ne vous a pas comprise, il ne peut plus, pauvre cerveau.
MARGUERITE
Vaine intervention. Ce n’est pas la bonne voie.
LE ROI
Que j’existe même avec une rage de dents pendant des siècles et des siècles. Hélas, ce qui doit finir est déjà fini.
LE MÉDECIN
Alors, Sire, qu’est-ce que vous attendez ?
MARGUERITE
Il n’y a que sa tirade qui n’en finit plus. (Montrant la reine Marie et Juliette.) Et ces deux femmes qui pleurent. Elles l’enlisent davantage, ça le colle, ça l’attache, ça le freine.
LE ROI
Non, on ne pleure pas assez autour de moi, on ne me plaint pas assez. On ne s’angoisse pas assez. (À Marguerite.) Qu’on ne les empêche pas de pleurer, de hurler, d’avoir pitié du Roi, du jeune Roi, du pauvre petit Roi, du vieux Roi. Moi, j’ai pitié quand je pense qu’elles me regretteront, qu’elles ne me verront plus, qu’elles seront abandonnées, qu’elles seront seules. C’est encore moi qui pense aux autres, à tous. Entrez en moi, vous autres, soyez moi, entrez dans ma peau. Je meurs, vous entendez, je veux dire que je meurs, je n’arrive pas à le dire, je ne fais que de la littérature.
MARGUERITE
Et encore !
LE MÉDECIN
Ses paroles ne méritent pas d’être consignées. Rien de nouveau.
LE ROI
Ils sont tous des étrangers. Je croyais qu’ils étaient ma famille. J’ai peur, je m’enfonce, je m’engloutis, je ne sais plus rien, je n’ai pas été. Je meurs.
MARGUERITE
C’est cela la littérature.
LE MÉDECIN
On en fait jusqu’au dernier moment. Tant qu’on est vivant, tout est prétexte à littérature.
MARIE
Si cela pouvait le soulager.
LE GARDE, annonçant.
La littérature soulage un peu le Roi !
LE ROI
Non, non. Je sais, rien ne me soulage. Elle me remplit, elle me vide. Ah, la, la, la, la, la, la, la. (Lamentations. Puis, sans déclamation, comme s’il gémissait doucement.) Vous tous, innombrables, qui êtes morts avant moi, aidez-moi. Dites-moi comment vous avez fait pour mourir, pour accepter. Apprenez-le-moi. Que votre exemple me console, que je m’appuie sur vous comme sur des béquilles, comme sur des bras fraternels. Aidez-moi à franchir la porte que vous avez franchie. Revenez de ce côté-ci un instant pour me secourir. Aidez-moi, vous, qui avez eu peur et n’avez pas voulu. Comment cela s’est-il passé ? Qui vous a soutenus ? Qui vous a entraînés, qui vous a poussés ? Avez-vous eu peur jusqu’à la fin ? Et vous, qui étiez forts et courageux, qui avez consenti à mourir avec indifférence et sérénité, apprenez-moi l’indifférence, apprenez-moi la sérénité, apprenez-moi la résignation.
Vous répondrez à la question posée en vous appuyant avec précision sur les trois textes du corpus (4 points) : comment la folie des tyrans Néron et Caligula et celle du Roi Bérenger Ier se manifeste-t-elle dans ces scènes ?
Proposition de corrigé
Introduction :
La folie est présente dans la tragédie depuis l’Antiquité. En effet l’obscurcissement de la raison est le châtiment que les dieux réservaient à l’hybris, la démesure orgueilleuse des hommes. Les textes du corpus : la scène 2 de l’acte II de Britannicus de Racine, les scènes 3 et 4 de l’acte I de Caligula de Camus et Le Roi se meurt d’Ionesco mettent en scène ce thème. Comment ces auteurs ont-ils peint la folie des tyrans Néron et Caligula et celle du Roi Bérenger Ier dans ces extraits ?
Développement :
Il convient de faire remarquer préalablement que la folie est un terme commode pour nommer des comportements assez différents. L’égarement passionné de Néron, le désir démesuré de Caligula et la peur égoïste du roi Béranger Ier n’ont pas grand chose à voir ensemble. Mais si les causes divergent, les manifestations ont des points communs.
Les souverains présentent une apparence physique défaite : Néron n’a pu trouver le sommeil, Caligula « a l’air égaré, il est sale, il a les cheveux pleins d’eau et les jambes souillées. » Béranger souffre, (une didascalie note « lamentations »), il a froid aux pieds. Chez Néron et Béranger, on peut noter la volubilité qui devient logorrhéique dans ses répétitions chez le second. Les trois personnages sont intérieurement agités : Néron est exalté, Caligula est exténué par sa quête, Béranger alterne questions, supplications et ordres.
Leurs propos surprennent leur entourage : Narcisse a du mal à croire son maître, Hélicon se réfugie dans des « silences » comme pour digérer ce qu’il entend. Marguerite tient pour nuls les propos de Béranger : « Vaine intervention », « littérature », le médecin se comporte de même quand il dit : « Ses paroles ne méritent pas d’être consignées » et « il ne peut plus, pauvre cerveau ».
Les trois souverains cherchent à se justifier dans des raisonnements qui ont l’apparence de la logique mais qui manifestent une démesure. Néron cherche à comprendre comment lui, le tout-puissant, l’empereur-dieu, a pu s’abaisser à « idolâtrer » Junie. Il veut persuader son confident Narcisse dans une rhétorique des sentiments pleine de violence. Caligula se livre avec réticence. Il a conscience que son discours est extravagant : « Tu penses que je suis fou […] Mais je ne suis pas fou et même je n’ai jamais été aussi raisonnable ». Cependant l’argumentation est paradoxalement rationnelle dans ses conséquences, la perte du sommeil ; ce sont les prémisses qui sont insensées. Notons qu’ici Camus trouve une formulation théâtrale percutante de l’absurde, heurt violent entre le désir de l’homme et la finitude révoltante de sa condition. Béranger, quant à lui, est prêt à tout endurer dans l’impuissance de sa colère sénile. Il étale sans vergogne les conséquences de sa peur et de son égoïsme forcené.
Conclusion :
Cette apparente folie des trois hommes a au fond la même origine : l’insatisfaction du désir. Ce manque insupportable est mis en valeur par la personnalité des souverains, hommes qui n’ont pas connu de limite à leur pouvoir. Les écrivains ont trouvé dans le statut des tyrans la meilleure expression théâtrale de l’incœrcible soif d’absolu des hommes. Dans leur incapacité à sublimer ce désir, ces personnages démunis vivent une régression, un pathétique retour en enfance.
 NÉRON
NÉRON HÉLICON, d’un bout de la scène à l’autre. Bonjour, Caïus1.
HÉLICON, d’un bout de la scène à l’autre. Bonjour, Caïus1.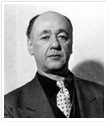 LE ROI
LE ROI