Georges Bernanos, Monsieur Ouine (1943)
Les prolégomènes de l’enfer
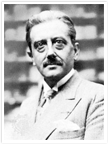 C’est le dernier « roman » de Bernanos, mais aussi celui qu’il a porté le plus longtemps (de décembre 1930 à mai 1940). Cette œuvre est déconcertante car elle semble relever de plusieurs genres différents : roman d’investigation psychologique comme pourrait le laisser penser son titre, récit sociologique, roman policier, conte pour adultes en raison de ses invraisemblances et de ses personnages symboliques… De fait Bernanos y fourvoie son lecteur en le lançant sur des pistes qu’il abandonne en cours de route. Tout semble fonctionner selon le principe de l’énigme comme si Bernanos cherchait à inventer une forme de narration nouvelle dans la littérature occidentale : une gigantesque parabole labyrinthique dans laquelle le lecteur persévérant est invité à trouver un sens caché. À la manière du prologue de Sous le soleil de Satan, Bernanos dépeint à plat un village possédé par le Mal. Pourtant, à la différence de ce roman, le point de vue surnaturel n’apparaît quasiment plus, le versant de la sainteté est gommé. Ainsi le lecteur est-il entraîné vers les terres froides du désespoir dans une lente descente vers l’inanité et l’enfermement infernal. Monsieur Ouine devient une espèce de récit contemplatif glacial sur le vide terrifiant de la civilisation moderne.
C’est le dernier « roman » de Bernanos, mais aussi celui qu’il a porté le plus longtemps (de décembre 1930 à mai 1940). Cette œuvre est déconcertante car elle semble relever de plusieurs genres différents : roman d’investigation psychologique comme pourrait le laisser penser son titre, récit sociologique, roman policier, conte pour adultes en raison de ses invraisemblances et de ses personnages symboliques… De fait Bernanos y fourvoie son lecteur en le lançant sur des pistes qu’il abandonne en cours de route. Tout semble fonctionner selon le principe de l’énigme comme si Bernanos cherchait à inventer une forme de narration nouvelle dans la littérature occidentale : une gigantesque parabole labyrinthique dans laquelle le lecteur persévérant est invité à trouver un sens caché. À la manière du prologue de Sous le soleil de Satan, Bernanos dépeint à plat un village possédé par le Mal. Pourtant, à la différence de ce roman, le point de vue surnaturel n’apparaît quasiment plus, le versant de la sainteté est gommé. Ainsi le lecteur est-il entraîné vers les terres froides du désespoir dans une lente descente vers l’inanité et l’enfermement infernal. Monsieur Ouine devient une espèce de récit contemplatif glacial sur le vide terrifiant de la civilisation moderne.
Plan
- Résumé de l’œuvre
- La faillite des élites
- Une terre inhospitalière
- Le péché omniprésent, les sept péchés capitaux
- M. Ouine
- Le récit de la confusion et du désordre
- Notes
Résumé de l’œuvre
Le récit commence dans la maison de Steeny, un jeune adolescent, en butte à la tyrannie équivoque de Miss sa gouvernante et au détachement de sa mère.
« Maman est une femme sensible, c’est-à-dire admirablement défendue contre les fortes déceptions de la vie, impénétrable. » Michelle Dorsel a fait de sa douceur un rempart contre la dureté de la vie. Elle a décidé de ne plus souffrir en se réfugiant dans sa villa et en ne donnant plus prise aux assauts du mal. Sa douceur est très proche de l’indifférence égoïste, une capacité étonnante qui considère seulement « sa vie, sa petite vie, sa vie à couvrir, à défendre ! ».
Steeny est un cousin de Mouchette : à l’orée de sa vie adulte, il recherche une existence autrement exaltante que l’éducation anglaise étouffante que lui dispensent sa mère et sa gouvernante. Il ne pense qu’à s’enfuir.
Steeny est en fait le surnom de Philippe qui porte le prénom de son père tôt disparu à la guerre peu après son mariage. Ce sobriquet trahit à la fois l’anglomanie de sa mère et surtout sa répulsion pour les hommes dont les passions menacent sa tranquillité. En rebaptisant son fils, elle a implicitement essayé de conjurer les forces contraires et d’éloigner à jamais le souvenir d’un mari encombrant, « l’ennemi de tout repos, le tyran, un autre Philippe ».
Apparaît alors un autre personnage important, Ginette de Néréis, châtelaine de Wambescourt, surnommée « Jambe-de-Laine ». C’est une femme mûre, outrageusement fardée, habillée de noir à l’ancienne mode. Elle paraît folle. Elle partage avec la mère de Steeny d’avoir été bannie de la bonne société de Fenouille. Fille d’un pauvre pharmacien, elle a jeté son dévolu sur Anthelme de Néréis, un joyeux vivant transformé en intellectuel artiste au contact de M. Ouine. En effet Anthelme a adopté un parasite, M. Ouine, un ancien professeur de langues vivantes tuberculeux. Depuis Anthelme est tombé malade, « Ginette court les routes derrière sa grande jument normande, on la croirait poursuivie par des spectres. » C’est justement cette Jambe-de-Laine que Steeny a suivie. Il a feint de se croire enlevé par elle, mais en fait il a choisi de rompre avec la solitude de son milieu familial, il est « sorti de l’enfance ».
C’est donc chez Ginette de Néréis que Steeny va faire la connaissance de M. Ouine, tandis qu’Anthelme est entré en agonie dans la puanteur effroyable d’une gangrène diabétique. N’ayant pas vu le temps passer, mais surtout pris dans les filets du professeur, Steeny choisit en fait l’aventure d’une nuit hors de chez lui. Il abuse du madère du professeur jusqu’à entrer en état d’ébriété.
Nous retrouvons Steeny avec le petit-fils Devandomme, jeune boiteux hypersensible. C’est l’occasion pour Bernanos de nous présenter une famille rustre. Au cours de son entrevue avec son ami, Steeny relate sa répugnante rencontre avec Anthelme. Le moribond lui confie sous le sceau du secret que son père n’est pas mort. Est-ce l’élucubration d’un alcoolique ou la dénonciation du mensonge qui pourrit la bonne société ? Philippe en est ébranlé au point de manquer tout de suite à la parole donnée en partageant la révélation avec son ami.
Surgit à l’improviste Jambe-de-Laine qui demande avec autorité un service à Steeny. La grande jument laissée sans surveillance bouscule sa maîtresse et menace de la blesser. Vivement, Steeny se précipite à la tête de l’attelage et contraint le puissant animal à reculer. Le jeune homme prouve ainsi son courage et sa présence d’esprit. Au cours du domptage, Ginette laisse échapper un colis qu’elle voulait cacher : un petit paletot de velours brun.
Sans transition, le récit passe dans une salle de la mairie transformée en morgue pour accueillir le cadavre dévêtu du jeune valet des Malicorne. Le paletot dissimulé par Ginette a appartenu à l’adolescent. La châtelaine vient à la mairie déposer contre son pensionnaire, M. Ouine, affirmant qu’elle a trouvé les vêtements chez lui et qu’elle l’a vu sortir au cours de la nuit du meurtre. Le médecin est peu porté à croire ce témoignage car il connaît les préventions de Jambe-de-Laine à l’encontre du professeur : elle adresse régulièrement au procureur des lettres anonymes qui mettent en cause son locataire. Cependant Mme Malicorne, l’employeur du vacher, réfute la valeur de preuve des vêtements en affirmant que le jeune homme ne les portait pas le soir du crime.
Alors que Steeny rêve d’une vie extraordinaire sur la route qui sollicite son imagination, il est heurté par l’attelage de Jambe-de-Laine. Un bûcheron qui a tout vu prétend que la châtelaine a délibérément conduit sa voiture sur l’adolescent. La voiture s’est brisée en allant percuter le talus. L’adolescent, après avoir récupéré de cet attentat, dit son fait à la vieille folle blessée, puis accepte de la raccompagner chez elle. Au cours de la soirée, Ginette brosse un portrait ambigu de son pensionnaire, confirme que M. Ouine est sorti au cours de la nuit du meurtre et demande à Steeny de garder le secret sur cette révélation.
Eugène Demenou est rentré chez lui, la nuit du meurtre, trempé jusqu’aux os après avoir pataugé plusieurs heures dans la rivière. À la suite d’un témoignage à charge, il est soupçonné par la police d’être le meurtrier du petit vacher.
Revenu chez lui, Steeny affronte Daisy, sa gouvernante anglaise. Dans un état proche de l’ivresse, Philippe ne peut supporter que cette femme s’interpose pour protéger le confort égoïste de sa mère. Le jeune adolescent qui vient de s’émanciper se voit bafoué dans sa nouvelle liberté virile. Ayant gardé de son enfance toute proche une intuition très sûre, il perce les motivations de la jeune femme. Il perçoit confusément qu’une enfance malheureuse où elle a été victime d’abus lui fait haïr les hommes. Il sent que Daisy entretient une relation équivoque avec sa mère. Il sait donc qu’il est un dangereux rival pour elle. La scène brutale qui suit révèle toute l’ambivalence du comportement de Steeny partagé entre un secret désir sensuel et une révolte contre la méchanceté sournoise de la gouvernante. Il la défie, la bouscule. Son adversaire, qui joue son va-tout pour garder sa confortable situation, lui révèle que son père n’est pas mort et qu’on l’a retrouvé dans un asile. Elle espère ainsi écœurer l’adolescent en lui montrant que sa confiance a été abusée, et ainsi le pousser à s’éloigner du domicile maternel. Possédé par la colère, il tente de l’étrangler. Mobiles secrets, pulsions inavouables, mensonge délétère apparaissent au grand jour.
Le vieux Devandomme rencontre son gendre, mais ne peut aller au bout de sa demande : lui conseiller de laver l’affront en se donnant la mort. De retour chez lui, désillusionné par son petit-fils infirme, il abandonne pour un moment orgueil et dureté de cœur.
M. Ouine est allé rendre visite au nouveau curé desservant le village. En le plaignant et en le désespérant tour à tour, il cherche à obtenir les lettres anonymes que le prêtre a reçues. Cette clairvoyance et le succès de la démarche en disent long sur le pouvoir occulte du professeur.
Hélène Devandomme a accepté de suivre son mari dans une des huttes où il se repose de ses activités de braconnier. Elle se donne la mort et tue en même temps Eugène.
Le village s’est réuni pour enterrer le petit vacher. Tous espèrent secrètement mettre aussi en terre le mal qui est brutalement apparu au grand jour. Au cours de la cérémonie d’absoute, le prêtre surprend son auditoire en déclarant la paroisse morte et en refusant de bénir le cadavre, symbole du péché collectif du village. Il reproche aux villageois la double mort qui a suivi le meurtre et dont l’origine se situe dans la méchanceté foncière du groupe. Les haines accumulées par les villageois se cristallisent désormais sur le curé. La glissade du prêtre, puis le discours incohérent et pleurnichard du maire font tourner la cérémonie à une joyeuse confusion. L’apparition de Jambe-de-Laine qui excite la foule par des propos et des attitudes inadaptés provoque le transfert de haine rancunière sur la châtelaine. Dans le désordre qui s’ensuit, Ginette est blessée par la jacquerie, puis se laissera mourir à l’hôpital où elle a été conduite.
Pendant une passe d’armes entre le curé et le médecin venus rendre visite au maire, Arsène s’est esquivé en pyjama et en pantoufles malgré le temps froid et pluvieux. Il est allé se réfugier à la cure pour rencontrer le prêtre. Après lui avoir confié la nostalgie désespérée de sa pureté perdue, il s’enfuit et se donne la mort.
La fin du roman rapporte la longue agonie de M. Ouine. Steeny vient tous les jours tenir compagnie à son maître. La méchanceté du village est toujours à l’œuvre même en ce lieu abandonné : la vieille sage-femme, Mme Marchal, qui sert de garde-malade au tuberculeux hydropique, établit la chronique du village, rapporte au jeune homme tous les ragots qui courent sur le compte du professeur, maintenant que l’approche de sa mort le rend inoffensif.
La fin se produit alors que Steeny s’est enivré avec le porto de son maître. L’ultime leçon est un face-à-face, mélange d’ironie et de pitié, de défi et de supplication. Il y est question non de jardin secret, mais de « petite armoire à poisons » intérieure. Hélas tout est désormais désespérément vide, insipide et d’une neutralité inhumaine. Ces divagations sur le rien, sur le retournement de l’enveloppe corporelle s’accompagnent d’un rire « limoneux » qui serait la marque de la dérision démoniaque si Satan était reconnu par ses affidés. M. Ouine trépasse seul tandis que Steeny cuve son porto. Le jeune homme reprend ses esprits en présence de la sage-femme et du médecin tandis que M. Ouine s’efface progressivement dans les plis de son suaire.
La faillite des élites
Ce roman brosse en premier lieu l’incapacité des élites à gérer une crise locale qu’elles n’ont pas vu venir et à laquelle elles ont peu ou prou contribué.
La noblesse futile et luxurieuse
Jambe-de-Laine est le pendant féminin du marquis de Cadignan du Soleil de Satan. La châtelaine est accusée par la rumeur publique de poursuivre les jeunes gens de ses assiduités déplacées. Médisance ou calomnie ? Il apparaît néanmoins que Ginette s’intéresse de près à Steeny sans que l’on puisse en connaître le mobile véritable. En outre, elle partage avec Cadignan l’inutilité de son existence. Sa passion à elle est la conduite effrénée de son attelage emmené par sa monstrueuse jument comme sortie de l’Apocalypse.
Un maire inefficace abîmé dans sa culpabilité
Le maire de Fenouille, l’ancien brasseur Arsène, est un bon vivant à l’appendice nasal hypertrophié dans sa forme comme dans les sensations qu’il lui procure. Le médecin a identifié que ce nez difforme était chez lui « un des organes du plaisir ». De fait le premier magistrat est un amateur invétéré de jeunes filles. Se voyant dans sa vieillesse comme un cochon, il est pris d’une frénésie pour étriller sa vieille peau. Finalement, le maire est prisonnier du scientisme médical qui le félicite de ses cures naturelles mais lui interdit ainsi la libération par l’aveu. La sollicitude du docteur ne fait que réveiller le doute fondamental qui taraude le magistrat municipal : « même ceint de l’écharpe tricolore, toujours le gros garçon avide et craintif, pareil à un marmot géant ». Le maire est en recherche permanente d’honorabilité. Sa magistrature lui donne l’impression d’être protégé des critiques de ses concitoyens, c’est pourquoi il en veut tant au petit vacher mort qui menace cet édifice de respectabilité. Il est vrai que le pauvre homme est dépassé par les événements.
Après le meurtre du vacher, son incompétence se combine au regret de sa luxure passée. Le malheureux se récure la peau et raconte ses aventures abjectes à son épouse qui voudrait bien lui pardonner mais se trouve écœurée par l’étalage de ces obscénités. Ce sentiment de culpabilité se confond avec son hyperesthésie olfactive : « D’ailleurs, tout le monde pue, les hommes, les femmes, les bêtes, la terre, l’eau, l’air que je respire, tout, – la vie entière pue ». Cette pestilence universelle a son origine au cœur de l’homme, voilà ce qu’a compris indistinctement le maire : « À mon âge, on devrait pouvoir curer sa mémoire ; juste comme tu cures ton puits, tout pareil. La vase qui sèche au soleil, plus de secrets. Mes secrets, j’en veux plus de mes secrets, ma fille ! » Sa recherche d’un salut possible dans une confession publique échoue lamentablement lors des obsèques sous les quolibets de ses concitoyens. Le malheur du maire est de croire que ses fautes sont impardonnables et d’être considéré comme un malade par son entourage. Lorsque le curé lui propose de l’absoudre après l’avoir entendu en confession, il décline la proposition par fatalisme, méfiance et incapacité à assumer sa vie passée.
Le médecin borné
C’est à « l’incurie du médecin de Fenouille » que le petit-fils Devandomme, boiteux hypersensible doit son infirmité comme Hippolyte devait la sienne à Charles Bovary. Ce docteur Malépine, scientiste obtus, ne réussit pas mieux avec le maire dont il cherche à soigner la culpabilité diffuse par des explications physiologiques et des traitements superficiels. Il est vrai que pour ce pseudo-savant l’âme n’existe pas. Il provoque ainsi une mutilation irréversible de la nature humaine chez le malheureux édile qu’il conduit au désespoir. « Vous faites du scrupule, mon cher, comme beaucoup de vieux pécheurs, au tournant de la soixantaine. Bref, il y a quelque chose qui ne va pas, là, au creux de l’épigastre, pas vrai ? Enfin, un peu plus bas, si vous voulez, au plexus, quoi, au siège de l’âme… Un gros reliquat d’images polissonnes pas trop faciles à éliminer désormais, du moins comme autrefois, hein ! sacré farceur ! Alors, on rêve d’innocence, de pureté, de rachat – que sais-je ? des bêtises. Un vicieux est toujours idéaliste, retenez ça, mon bonhomme… » Tout est affaire d’humeurs, de chimie, de physiologie. Ce qu’on appelle l’âme n’est qu’une émanation de la matière.
Au cours d’une ultime rencontre chez le maire, le prêtre accuse la médecine et son psychologisme d’être la cause des maux actuels. En niant le surnaturel, le scientisme va faire naître des monstres inconnus dont le maire est un signe avant-coureur : « J’aurais voulu seulement expliquer que le pauvre n’a désormais plus de mots pour nommer ce qui lui manque, et si ces mots lui font défaut, c’est que vous les lui avez volés ».
Le professeur irresponsable
Avec M. Ouine, Bernanos nous trace le portrait de l’intellectuel irresponsable. Nous y reviendrons en détail plus loin.
Le prêtre défaitiste
Le clergé n’échappe pas à la critique bernanosienne. La première dérobade est enregistrée lors de l’agonie d’Anthelme, quand, sollicité pour extrémiser le mourant, « M. l’abbé Doucedame n’a pas cru devoir en courir le risque… ». Ensuite le prêtre commet une autre faute en remettant à M. Ouine les lettres anonymes qui dénoncent sa vie personnelle dans son ministère. Bien que ces courriers ne concernent que lui, il trahit symboliquement le secret de la confession ou la confiance absolue qu’un fidèle, même calomniateur, est en droit d’attendre d’un prêtre.
Au cours de ses études au séminaire, il a été si peu préparé à affronter le monde sécularisé et défiguré par le péché que lui aussi renonce au surnaturel comme à une illusion. Ce clerc souffre de sa solitude et pèche contre l’Esprit dans son manquement à la vertu d’espérance : il ne croit plus que ce monde défiguré par le péché est sauvé par le sacrifice christique, que Dieu a déjà vaincu le Mal et la mort. Il est désespéré par l’abandon de sa paroisse. Bernanos, le poilu chrétien anticlérical, le fait déserter. Le pauvre prêtre refuse le combat, abandonne le service des âmes. À sa manière, par son non serviam, il rejoint Satan. Son refus démobilisateur non seulement ne crée pas le choc salutaire dans sa paroisse, mais la conduit à un déchaînement de forces maléfiques.
Aucun notable ou responsable n’est donc exempt de critiques. Pis, ils portent solidairement la responsabilité du pourrissement souterrain du village.
Une terre inhospitalière
Bernanos utilise plusieurs thématiques pour décrire la contrée de Fenouille liée par son maléfice.
Le mal est d’abord symbolisé par ces eaux mortes et impures.
Ce coin de terre est arrosé par des pluies froides et abondantes. On ne peut s’empêcher d’y voir une allusion au Déluge de la Genèse, lorsque la Terre pécheresse est punie par la montée des flots. Les sols et les murs sont gorgés d’eau. Le château de Ginette qui abrite M. Ouine, mais aussi l’église, suintent un liquide glacial et mortuaire. Cette humidité entretient une atmosphère putride, favorisant moisissures et salpêtre1. Le pouvoir de nuisance de ces eaux cachées est immense. Elles corrompent et délitent les bâtiments, elles sont sans doute à l’origine de la tuberculose de M. Ouine. Notons que le corps du professeur est envahi et ballonné par ces liquides impurs.
Le mal est ensuite évoqué par la boue résultant de ces eaux qui se mélangent à la terre.
Cette glaise imbibée présente tous les attributs du péché :
- la succion ou l’attirance irrépressible,
- la glissade ou l’abandon à la tentation,
- la maculation ou l’impureté morale.
C’est au moment où le curé refuse d’exercer son service pastoral qu’il glisse au cimetière et souille son surplis.
Bernanos puise largement dans la symbolique de la Genèse. Dans ce livre, Dieu crée l’homme à partir d’un peu de poussière. À aucun moment, cette terre n’est mélangée à de l’eau. L’homme originel n’est que terre et souffle divin2. La boue est donc une image de l’homme défiguré par le péché, de l’homme qui a laissé entrer en lui le Mal. Mais on peut aussi avancer une autre explication. Dans la Genèse, Dieu sépare les eaux de la terre. Il opère une œuvre de différenciation pour aboutir au chef-d’œuvre de la création, l’homme. Quand Bernanos insiste sur la boue, il pense au chaos qui précède la constitution de l’univers. La boue est ainsi un retour à l’avant indistinct. Le Mal est le chemin inverse de l’acte créateur, il est inversion des valeurs, mélange, confusion.
Avec la boue, Bernanos nous invite à regarder cette terre qui devient menaçante, ces sols qui dissimulent un danger sournois et omniprésent. Cette eau glaciale qui remonte est qualifiée de funèbre ou mortuaire. Ces exfiltrations ont été en contact avec les morts. Bernanos n’évoque pas l’au-delà chrétien rempli d’espérance, mais plutôt les fantômes païens qui viennent inquiéter les vivants. Ces morts appartiennent plus à un univers primitif magique qu’au monde surnaturel. Il est curieux de noter que cette terre du Nord n’engendre ni vie ni récolte, mais pourriture et mort. La boue est ainsi le signe de cette fermentation souterraine que Bernanos note à plusieurs reprises.
D’ailleurs le romancier livre explicitement cette référence comme une des causes de la désespérante situation qui pèse sur Fenouille. Le petit prophète Guillaume évoque ces esprits fantomatiques de la Grande Guerre qui agissent aux frontières du monde visible, ces disparus inapaisés auxquels on n’a pas rendu les derniers hommages. Il est d’abord question d’un héritage qui n’a pas été légué, d’une solution de continuité dans la transmission des valeurs. Mais aussi d’un refus de reconnaître le sacrifice des Poilus si bien que cette injustice criante faite à leur mémoire pourrait bien appeler un châtiment : « Le désordre universel, s’ils en étaient cause ? […] Moi, je les vois très bien à la frontière qu’ils ont franchie trop tôt, malgré eux, […] les coups qu’ils portent ébranlent le monde ». Guillaume perçoit clairement la conséquence du déni de mémoire adressé aux héros de la grande boucherie dans la déviance de Steeny, dans son « idée d’un héroïsme à rebours… », dans son admiration pour M. Ouine, dans cette inversion des valeurs propre à l’univers satanique.
Le péché omniprésent, les sept péchés capitaux
Ce petit monde de Fenouille barbotte dans son mal comme dans un bouillon de culture où vibrionnent tous les péchés.
La paresse
Eugène Demenou, le braconnier est un paresseux, non parce qu’il est un fainéant, mais parce qu’il vit selon ses impulsions. Il n’exerce aucune activité reconnue par la société, s’active seulement en cas de besoin, vend ses prises pour se procurer alcool et tabac ou pour se livrer à ses ribotes. Eugène vit en homme qui ne supporte aucune contrainte. C’est un asocial que le groupe a rejeté.
L’orgueil
Ce péché est illustré par le vieux Martial Devandomme. Ce « paysan orgueilleux » se considère comme le meilleur vétérinaire du pays, se tient à l’écart du village, ne veut rien devoir à personne, cache soigneusement deux hontes secrètes : le déclin de ses forces et surtout le mariage de sa fille avec le « manant » Eugène Demenou. Cette attitude hautaine et solitaire prend ses racines dans une vieille anecdote familiale bâtie autour d’hasardeuses similitudes et d’allégations jamais élucidées, fournies par un étrange voyageur. Les honorables paysans, bons vivants, auraient été la branche spoliée d’un aléatoire marquisat. Depuis la fièvre nobiliaire a généreusement accolé la particule au patronyme tandis que s’en est allée l’insouciance des aïeux. Marqué par son père, joyeux luron débauché, mais soucieux de sa dignité et serviable avec son entourage, Martial ne peut supporter l’idée d’avoir un gendre meurtrier. Aussi a-t-il imaginé de le rencontrer pour lui demander de laver l’affront en mettant fin à ses jours. Il entend ainsi assumer la honte faite à son nom et défier le village qu’il méprise, espérant obliger chacun à marquer, lors de ses obsèques, le respect posthume qu’il s’estime dû. L’orgueil est ainsi homicide.
Au même moment, le vieillard ne peut admettre le déclin de ses forces, il est tout entier dans une image déchue, insoutenable. Cependant son échec dans sa démarche auprès de son gendre, puis la désillusion que lui assène son petit-fils infirme lui permettent d’oublier un moment son orgueil en pleurant. Sous le regard de l’ange, le vieil homme a accepté d’être ce qu’il est, un vieillard démuni. Mais il va affronter la huée muette du village en se rendant aux obsèques du petit vacher : « L’orgueil entretenu tant d’années au plus secret de son âme, cet orgueil si parfaitement incorporé à sa vie, à sa substance, à la substance de sa vie, qu’il n’eût su peut-être encore lui donner son vrai nom, l’orgueil venait de consommer en lui jusqu’au remords. L’assurance de sa parfaite solitude, de l’espèce de damnation où il était tombé, ébranle à cette minute si fortement ses nerfs qu’il essaie gauchement d’exprimer pour lui seul, par quelque image, un sentiment presque inconcevable. Il ressemble à un vieil arbre pourri, plein de sciure, pense-t-il le temps d’un éclair. Puis il hausse les épaules et s’avance hardiment vers son destin. » Au cours de la cérémonie des obsèques du vacher, son orgueil lui donne le courage d’affirmer l’innocence de son gendre.
Steeny aussi est habité par l’orgueil. Il ne peut supporter que le bûcheron ait pu être témoin de sa peur après avoir été bousculé par l’attelage de Mme de Néréis. De même Ginette « blesse sauvagement son orgueil » en étant témoin de sa faiblesse dans les instants qui suivent sa chute. C’est ce même orgueil juvénile que va manipuler Daisy pour éloigner Steeny de sa mère.
Même le prêtre s’accuse de l’orgueil solitaire.
La gourmandise
Cette avidité et ces excès de l’appétit paraissent surtout sous la forme de l’ivrognerie. Tous les villageois boivent plus que de coutume jusqu’à perdre le contrôle d’eux-mêmes. Bière, bistouille et genièvre enfièvrent les esprits lors des obsèques du petit vacher. Dans la bonne société on recourt au vin de Madère ou au porto. Steeny, désireux de se montrer homme, s’enivre à deux reprises sous le regard goguenard de son maître.
La luxure
Ce péché de la chair, ce désir erratique des corps habite plusieurs personnages qui, bien que mariés, se laissent aller à une concupiscence animale. On le relève chez le maire comme chez le gendre du vieux Devandomme, Eugène Demenou. Ginette de Néréis est connue pour sa traque des jeunes adolescents. Elle reconnaît devant Steeny, à demi-mots, qu’elle a désiré beaucoup d’hommes. Cet appétit désordonné l’a conduite à éprouver répugnance et honte. Elle se punit par la haine de son propre corps qui se confond avec celle qu’elle éprouve pour M. Ouine. La luxure chez Ginette et Arsène débouche sur l’autopunition. Au lieu d’ouvrir sur la plénitude d’un désir satisfait, elle conduit à un masochisme destructeur.
Le curé constate combien le péché de luxure attriste l’individu qui s’y livre. « Plus que l’obsession de l’impur, craignez donc la nostalgie de la pureté. Il vous plaît de reconnaître dans la sourde révolte contre le désir, la crainte entretenue depuis tant de siècles par les religions, servantes sournoises du législateur et du juge. Mais l’amour de la pureté, voilà le mystère ! L’amour chez les plus nobles, et chez les autres la tristesse, le regret, l’indéfinissable et poignante amertume plus chère au débauché que la souillure elle-même. » Cette culpabilité que voudrait gommer l’immoralisme agnostique débouche sur la punition autodestructrice.
On peut penser que Ginette s’est donné la mort en provoquant délibérément la foule hostile. Quant au maire, son ADIEU tracé sur le mur ne laisse guère de doute sur ses intentions de se suicider.
L’avarice
L’avarice apparaît d’abord comme le pouvoir inconsidéré de l’argent. Arsène, le maire, confie au docteur sa jouissance extrême d’avoir porté sur lui, à même la peau, « un portefeuille tout plein, tout rond, plein à faire péter la couture ». L’argent n’est plus un moyen de se procurer nécessités et plaisirs futiles. Il est devenu lui-même nécessité et plaisir. « Voilà qui vous chauffe le cœur d’un homme. […] Il avait pris ma chaleur, il était à moi comme ma peau. » Cet argent est devenu une assurance secrète contre la peur et le doute qui menacent l’éternel grand enfant.
La colère
Plusieurs personnages agissent sous l’emprise de la colère. L’une des manifestations les plus caractéristiques est celle qui saisit Steeny lorsque, rentré chez lui, il doit affronter sa vieille et sournoise ennemie, sa gouvernante anglaise. Dans un état second proche de l’ivresse, il déchaîne sa violence meurtrière, se rue, cogne et étrangle. Puis il n’a plus de souvenir de sa furie sauf une « tache noire » qui flotte au fond de sa conscience. La colère est bestiale, fait surgir un vieux fond instinctif mauvais et brutal. Elle aussi est homicide.
L’envie
L’envie est le vice le plus couramment partagé, il prend la forme du désir mimétique. Ainsi le maire affublé de son nez hypertrophié voudrait être un anonyme : « Faut-il découvrir à soixante ans passés qu’on n’est pas comme les autres, scandale des scandales, effroyable damnation des imbéciles ! »
Steeny incarne à l’inverse l’autre forme de l’envie : ce désir d’originalité à tout prix qui est la forme d’une jouissance effrénée de la vie. Au sortir de l’enfance, il a rejeté son idéalisme et ses héros livresques, aidé dans ce travail de destruction par le mercantilisme et la trivialité de ceux qui ont exploité le premier conflit mondial. Il est devenu un jeune fauve prêt à tout dévorer, prêt à se renier pour vivre, comme Mouchette, une existence hors du commun. Son programme de vie, qui est celui d’un chasseur, révolte son jeune ami Guillaume qui perçoit l’œuvre maléfique de l’inquiétant Ouine.
« La vie pour nous, ça ne doit pas être un but, c’est une proie. Et pas une seule, des milliers et des milliers de proies, autant que d’heures. Il s’agit de n’en rater aucune, avant la dernière, la dernière des dernières, celle qui nous échappe toujours ». Steeny n’est pas très regardant sur ce désir d’émancipation « puisque l’attend quelque part une aventure faite pour lui, et un maître ».
Steeny a vu en effet dans Ouine le héros moderne : « Tu sais, parmi tant de gens qui se ressemblent, dont la ressemblance est ridicule, odieuse, obscène, – tous pareils, quelle ignominie ! – on rencontre parfois des types, on pense : « Celui-là, c’est Rastignac, ou Marsay, ou Julien Sorel », – mais on sent presque aussitôt que ce n’est pas vrai, qu’on est en train de jouer avec soi-même, avec son rêve comme un chaton avec sa queue. Tandis que M. Ouine… Tiens, ce mot de héros, – quand il fixe sur toi son regard dormant, son regard qui a l’air de flotter au ras d’une eau grise – tu ne pourrais pas le prononcer sans rire. Et pourtant… Car nos héros, eux aussi, que veux-tu, ils se ressemblent ! Lui est particulier, unique. » Il est vrai aussi que la jeunesse de l’intéressé corrige de manière caustique cette puérile admiration : « la surnaturelle insolence de Philippe s’exalte au souvenir du demi-dieu bedonnant, son absurde chapeau sur les genoux. » Elle a le mérite de nous révéler « ce regard extraordinaire, trop bon, trop chargé de connaissance et de bonté, trop lourd », l’obséquieuse bonté, la doucereuse sollicitude, l’étrange séduction du maître.
Ouine, pour sa part, envie dans Steeny l’enfant qu’il a été : « c’était un soir de septembre, boueux et triste. « Je viens de me revoir moi-même, dit-il, comme un mort regarde dans le passé… Le petit garçon que j’étais, je l’ai vu, j’aurais pu le toucher, l’entendre… » Tel Faust, Ouine rêve de surprendre le secret de l’éternelle jeunesse.
La jalousie chez la fille Devandomme est sans doute une forme de l’envie. Hélène n’est pas jalouse des nombreuses passades de son mari. Elle apprécie comme au premier jour les restes d’affection qu’il lui prodigue au retour de ses équipées nocturnes. Mais une certaine nuit, celle du meurtre du vacher, Eugène est rentré trempé et l’a repoussée. La police est venue recueillir le témoignage de l’épouse. Depuis « l’espèce d’étau qu’elle sent autour de sa poitrine, nulle force au monde ne le desserrera plus. Son amour est perdu, soit, mais elle le fera payer cher. » Dans son esprit, s’est insinuée, lancinante, l’idée de la mort, non comme une expiation ou une punition, mais comme la consommation ultime et désespérée de cet amour. Sous le regard apitoyé du père, la jalousie de la fille ou sa forme de désespoir amoureux paroxystique ne peut que devenir meurtrière.
Au-delà de ces péchés capitaux, parce qu’ils sont la porte d’entrée de tous les autres, Fenouille vit quotidiennement la haine, la méchanceté, les lettres anonymes, la médisance ou la calomnie. « En somme, depuis des jours, le village barbotait dans son crime, chacun pour soi, chacun pour son compte ». Le Mal est un bouillon de culture éminemment toxique qui, de plus, isole les individus. Bernanos le montre particulièrement à l’œuvre lorsque les soupçons de la police qui font suite aux allégations du maire se portent sur le braconnier Eugène Demenou. Demenou est-il coupable du crime dont l’accuse la rumeur publique ? Bernanos ne précisera jamais l’auteur des faits. Ce qui l’intéresse plus est de montrer comment la méchanceté latente et sournoise du village a vite fait de désigner un coupable à la vindicte populaire en présentant le marginal comme un bouc émissaire facile. Le même Eugène fait remarquer d’ailleurs à son beau-père, puis à sa femme, qu’ils n’ont jamais cherché à savoir s’il était coupable.
Ce roman est donc lourd de deux homicides, de plusieurs tentatives de meurtre et de plusieurs morts violentes.
Il faudrait enfin relever la pédophilie dont ont été probablement victimes Ouine et Daisy. Elle perturbe gravement leur existence d’adulte et les conduit à entrer dans la spirale infernale de la transmission du Mal. Bernanos met sans doute en scène la mise en garde évangélique3.
La jeunesse n’est pas innocente dans ce roman. Mû par la curiosité, indifférent à ce qui l’entoure, Steeny est cruel à sa manière. Il semble habité par l’esprit du surhomme. Ses relations avec son ami Guillaume sont très éclairantes. En effet, le seul être angélique est Guillaume, le petit-fils Devandomme, épuré par son infirmité. Il joue le rôle de l’ingénu habité par l’esprit d’enfance qui prophétise et juge ce monde. Dans sa candeur, il émet des paroles de feu à l’encontre de Philippe qui ne s’est guère apitoyé sur la disparition d’Anthelme : « Oh ! Steeny, mon petit Steeny, je vous ai vu l’autre nuit, en rêve, cloué par le milieu de la poitrine sur un rocher aride, une espèce de muraille flamboyante, un mur de sel et, avant que j’aie pu seulement prononcer un mot, vous m’avez crié : « Non, non, reste là, ne bouge pas, laisse-moi », absolument comme si vous étiez déjà damné. » Cette vision d’un moderne Prométhée foudroyé dans Sodome et Gomorrhe est rejetée par celui qu’elle est chargée d’avertir si bien que l’on peut affirmer que Steeny court à sa perte éternelle lui aussi. « Tu m’embêtes. […] tu sais nos conventions, je fonce droit devant moi, toujours. Si la vie n’est qu’un obstacle à forcer, je la force, je sortirai de l’autre côté tout écumant, tout sanglant. Et toi, tu me suis, mais de loin, nous te verrons déboucher à ton tour, portant le poids de mes péchés. Enfin tu es mon âme, fiche-moi la paix, notre salut c’est ton affaire… » Steeny, un rien hautain, reconnaît implicitement la médiation christique du pauvre moderne, l’infirme méprisé, mais la refuse par ses sarcasmes nietzschéens.
Ce même Guillaume va être effacé dans la suite du roman, lorsque la boue universelle submerge Fenouille comme au temps du Déluge. Alors le village est prêt à accueillir son maître satanique.
M. Ouine
Cet enfer qui va advenir porte un nom, M. Ouine. Pourtant, à première vue, rien d’infernal ni de menaçant dans ce personnage grassouillet et propret. Son abord extérieur est soigné, voire méticuleux. Ouine donne l’impression d’un homme affable, pétri de sagesse et d’expérience. Il séduit ceux qui l’approchent par « l’extraordinaire noblesse d’un visage aux lignes si simples, si pures que ni l’âge, ni la souffrance, ni même l’empâtement d’une mauvaise graisse n’en altéraient jamais la bienveillance profonde, l’expression de calme et lucide acceptation. » Il doit son titre de Monsieur à son ancien métier de professeur qui lui vaut la déférence hypocrite de ceux qu’il croise.
Ouine apparaît donc comme un personnage informe, rond et grassouillet, lisse, bonhomme, complaisant. Pour Steeny, « l’épatant, c’est qu’on peut l’imaginer dans n’importe quelle conjoncture vraie ou fausse, vulgaire ou inouïe, tragique ou comique, absurde – il se prête à tout, il se prête à tous les rêves. » Ouine est une illusion.
Le parasite démoniaque
Le portrait que trace de lui Jambe-de-Laine est paradoxal. M. Ouine est une vivante énigme. La relation de la châtelaine avec son pensionnaire pourrait être définie par ce vers de Racine : « Présente je vous fuis, absente je vous trouve »4. En effet le premier sentiment évoqué par Mme de Néréis est celui d’une solide haine : « Nous le haïssons ici comme la mort. » Mais immédiatement et dans le même élan, elle exprime une sollicitude toute maternelle : « Hélas ! il a tant besoin d’être protégé, servi : sa naïveté est extraordinaire, passe toute mesure. Il ne fait rien par lui-même, aussi désarmé qu’un enfant. Servi, voilà le mot. Aveuglément servi, – honoré, servi à l’égal d’un dieu. Son caprice dispose de nous. Car, pour sa volonté, n’en parlons pas. Il n’a pas plus de volonté qu’un enfant. » Tout au long du portrait Ouine apparaît comme une apparence et son contraire. Ce personnage informe peut être modelé au gré de son interlocuteur. Sa plasticité est étonnante. Le secret de M. Ouine semble être celui d’exister par la projection des pensées de ses rencontres comme si le professeur se nourrissait de la vie d’autrui. Cette forme de vampirisme est clairement décrite par la folle comme d’essence démoniaque. « Je vais vous dire, mon cœur : comme d’autres rayonnent, échauffent, notre ami absorbe tout rayonnement, toute chaleur. Le génie de M. Ouine, voyez-vous, c’est le froid. Dans ce froid l’âme repose. » Ce froid est d’ailleurs explicitement désigné comme le contraire de l’amour. M. Ouine est aimable mais ne peut être aimé.
Le manipulateur
Ce personnage s’est imposé dans la bonne société parce « qu’il donne l’impression d’une rare puissance de soi, d’une incalculable force psychique ». M. Ouine envoûte inexplicablement.
Dès la première rencontre avec Steeny, nous assistons à une entreprise de séduction. M. Ouine avec une douceur empreinte de force s’immisce dans la volonté de l’adolescent. Il prend l’ascendant sur lui comme sur toutes les personnes qu’il va rencontrer dans la suite du récit. Bien qu’il paraisse effacé, émanent de lui « une pression mystérieuse », « une autorité prodigieuse ».
Steeny accepte sans regimber cette autorité du maître à penser. Il a reconnu « le compagnon prédestiné de sa vie, l’initiateur, le héros poursuivi à travers tant de livres ». Pourtant Ouine ne correspond nullement au rêve d’un jeune homme. Il est « vieux et malade », il sue la vie en décomposition comme la chambre qu’il habite. Steeny, à l’orée de sa vie jaillissante, est poussé mystérieusement à affronter l’enseignant fatigué et « cette maison même et ses puissances secrètes, servantes diligentes de la plus secrète de toutes, la Mort – la Mort à l’ouvrage si près d’eux, sous leurs pieds… »
L’enseignant se refuse à entrer dans cette relation dominatrice de maître à disciple. Il se refuse à appeler le jeune garçon par son sobriquet, il souhaite que ce dernier reste simple quand il s’adresse à lui… Il veut que l’adolescent le considère comme un égal, un ami.
Il cherche à s’attacher l’adolescent en lui offrant un goûter savoureux. Surtout, il l’initie aux alcools en lui offrant du madère.
Le refus de l’engagement
Cet être qu’on a pu suspecter d’être l’amant de Jambe-de-Laine est particulièrement énigmatique, comme s’il se situait en dehors du Bien et du Mal. Le curé de l’endroit n’a jamais pu obtenir de lui « une parole pour ou contre la religion ». C’est que M. Ouine signifie celui qui ne dit ni oui ni non. Voilà un homme qui ne s’engage pas, un pur spectateur du théâtre mondain.
« Je suis devenu un homme simple, très simple, je ne calcule plus. Après un certain nombre d’expériences inutiles – qui de nous n’a cherché la brebis perdue, rapporté l’agneau sur ses épaules ?… – je n’irai plus au-devant de rien. Comme ces gelées vivantes, au fond de la mer, je flotte et j’absorbe. Nous vous apprendrons ce pauvre secret. Oui, vous apprendrez de moi à vous laisser remplir par l’heure qui passe. »
Le vieil enseignant passe son temps à relire d’anciennes lettres d’élèves, à espionner Steeny, à envier cette jeunesse qui le fuit et qu’il n’a su faire fructifier quand il en était encore temps : « ah ! c’était bien là l’image que j’ai caressée tant d’années, une vie, une jeune vie humaine, tout ignorance et tout audace, la part réellement périssable de l’univers, seule promesse qui ne sera jamais tenue, merveille unique ! Car ne vous y trompez pas, Philippe, une vraie jeunesse est aussi rare que le génie, ou peut-être ce génie même, un défi à l’ordre du monde, à ses lois, un blasphème. Un blasphème. La Nature qui tire parti de tout, ainsi qu’une ménagère horrible, la couve d’une haine vigilante, entrouvre amoureusement ses charniers. Mais la jeunesse saute pardessus, s’envole… Quand tout s’altère, se corrompt, retourne à la boue originelle, la jeunesse seule peut mourir, connaît la mort. » Ouine est un tiède, un envieux. Il n’en reste pas moins perspicace sur lui-même. Au moment où il remporte sa première victoire de vieux séducteur sur Steeny, il ne peut se satisfaire de l’admiration de l’adolescent qui semble prêt à tout quitter pour le suivre : « pas un de mes élèves jadis, qui n’ait fait le projet de me suivre, comme vous dites, au bout du monde. Il n’y a pas de bout du monde, cher garçon […] mais chacun de nous peut aller jusqu’au bout de soi-même. » Ces propos inattendus le transforment en un simulacre de Christ crucifié : « Un moment il demeura immobile, le buste incliné en avant, le cou un peu tordu portant la tête vers l’épaule dans une attitude incommode, presque effrayante, comme si la parole qu’il venait de prononcer l’avait lui-même cloué sur place. » Le lecteur attentif peut percevoir dans cette scène une réécriture démoniaque des appels apostoliques dans les Évangiles. Là où le Christ appelle à tout quitter pour le suivre, là où le disciple reste attaché au divin maître qui a les paroles de vie éternelle, Ouine, qui vient de séduire, refuse le disciple, l’abandonne à sa quête devenue sans objet.
Ouine donne l’apparence d’un être paisible, détaché. Sa chambre est un havre, loin de l’agitation du monde. Ses propos sont lénifiants au point que Steeny, hypnotisé, trompé par l’inexpérience de son jeune âge, en arrive à le considérer comme un saint. Pourtant sa sagesse est frelatée.
La sagesse frelatée et la curiosité maligne
Ouine est un homme sérieux, ennemi des écarts, de la spontanéité. Devant la crise qui saisit Steeny, lorsque le chapeau melon du maître tombe du lit, Ouine s’exclame avec colère : « il y a une malice dans le rire, un poison. »
Son souci d’honorabilité est symbolisé par le récurage patient de sa chambre pour en extirper la crasse et la pourriture accumulées par les siècles. Sa chambre est le symbole de notre existence où « le passé est diablement tenace », ce qu’il faut entendre au sens propre. Sa tentative de purification est purement externe si bien que les salissures reparaissent toujours sous le badigeon, que la sanie sous-jacente finit toujours par affleurer.
Dans le fond, Ouine se voudrait nietzschéen, au-delà du Bien et du Mal : « il se rappelait n’avoir jamais réellement détesté qu’une contrainte, celle dont le principe était en lui, la conscience du bien et du mal, pareille à un autre être dans l’être, – ce ver. »
C’est aussi un sadique délicat, une âme qui s’ausculte sans concession, mais sans désir de s’améliorer non plus : « je me méfie de la pitié, monsieur, elle exalte en moi des sentiments plutôt vils, une démangeaison de toutes les plaies de l’âme, un affreux plaisir. »
Détaché, d’une curiosité toujours insatisfaite, le vieux professeur distille une certaine sagesse désabusée, une médiocrité scrupuleuse et complaisante. Ouine est d’abord un regard qui se repaît des misères de la condition humaine blessée, un anthropologue ou plutôt un entomologiste satanique. Sous son regard réducteur, l’homme devient un insecte bizarre et trop prévisible. Ce n’est pas pour rien qu’il est collectionneur méticuleux, qu’il observe, dissèque avec une neutralité jouisseuse. Lors de sa visite au curé, il avoue cette curiosité impure et envie les pouvoirs du prêtre dans le sacrement de pénitence : « il n’y a ici que vous et moi qui nous intéressions aux âmes. […] Il conviendrait peut-être mieux à mon caractère, à mon état, de dire : à la vérité des êtres, à leurs mobiles secrets. »
Bernanos suggère que l’origine de ce mépris caché pour le genre humain est à rechercher dans un abus subi par l’enfant de douze ans, victime de la pédophilie de son professeur d’histoire.
Ouine est comme l’oeil de la conscience à qui rien n’échappe, mais qui ne renvoie nul jugement. Ouine est dans l’indifférence criminelle, dans la non-assistance à humanité en danger, c’est un voyeur absolu dans la mesure où il contemple sans relâche le néant ou le péché. Nulle révolte en lui. Il a pactisé définitivement avec le mensonge. Ouine est un maître d’erreur qui ne croit plus au dépassement de soi, à la générosité, à la vocation surnaturelle de l’homme. Avec lui, l’homme est réduit à une nature d’insecte. L’ancien professeur nie en pratique la présence secrète d’un Dieu bon, d’une providence bienveillante. Il en est arrivé à admettre que la nature profonde de l’homme est le Mal, non pas le péché qui sous-entendrait l’existence d’un Bien au besoin inaccessible, non simplement la petitesse, l’effondrement intérieur, des relations humaines ordinaires désespérantes. Ouine est fasciné par cet univers boueux et glacial qu’il croit dominer en le pensant prévisible selon sa connaissance dévoyée.
Ouine est ténébreux, décadent, pervers. Dans le fond, comme Faust, Ouine est jaloux de la jeunesse, il espionne Steeny pour tenter de lui arracher son secret, il cherche à l’attirer, à le séduire. Ne pouvant retrouver le feu et l’audace du jeune homme, il va saccager l’innocence, tenter de pervertir ce qui lui échappe. À Steeny qui s’émerveille des forces de vie qui s’éveillent en lui, le vieil enseignant entonne une ode sulfureuse à la Mort, il met ses talents de pédagogue au service d’un enseignement délétère. « Je vous apprendrai à l’aimer […]. Elle est si riche ! L’homme raisonnable reçoit d’elle ce que la crainte ou la honte nous retient de demander ailleurs, et jusqu’à l’initiation du plaisir. Retenez ceci, Philippe : vous l’aimerez. Un jour même viendra où vous n’aimerez qu’elle, je le crains. Si ma modeste petite chambre, dans sa nudité, vous paraît douce, c’est justement qu’elle y est présente ; vous vous y êtes blotti dans son ombre, à votre insu. » Sa contemplation du Mal l’a conduit à cet amour contre-nature pour son propre anéantissement. Ouine est le poison de l’esprit dans l’inversion des valeurs. Il n’est donc pas étonnant que l’adolescence soit subjuguée de manière ambivalente par cet esthète décadent : « Vous me faites peur, dit Steeny. Je vous suivrais au bout du monde. »
Le roman se termine à la manière de Micromégas sur un doute sardonique. Ouine est une page blanche. Sa vie n’aura laissé aucune trace. Le professeur clôt son énigmatique existence sur cette sentence curieuse : « Je suis vide […] Je me vois maintenant jusqu’au fond, rien n’arrête ma vue, aucun obstacle. Il n’y a rien. Retenez ce mot : rien ! » L’ambiguïté est double. M. Ouine est une « outre pleine de vent » aux propos inconsistants, mais il se présente aussi comme un affamé qui a besoin de remplir son creux intérieur de nourritures terrestres autant que de l’enviable jeunesse de son admirateur. Ainsi se révèle M. Ouine, le voyeur, la forme moderne du vampire, qui nourrit son vide intérieur de la vie cachée d’autrui, de sa curiosité infernale. « Je désirais, je m’enflais de désir au lieu de rassasier ma faim, je ne m’incorporais nulle substance, ni bien, ni mal, mon âme n’est qu’une outre pleine de vent. Et voilà maintenant, jeune homme, qu’elle m’aspire à mon tour, je me sens fondre et disparaître dans cette gueule vorace, elle ramollit jusqu’à mes os. »
Le Mal apparaît curieusement sous cette forme d’implosion, de trou noir, forme plus orthodoxe que la Fin de Satan d’Hugo. L’enfer est bien cet écroulement éternel de l’âme en elle-même, cette existence voulue et créée pour l’éternité qui ne peut plus exister.
À l’heure de sa mort, Ouine a la lucidité effroyable de l’athée indifférent ou de l’intendant qui est allé enterrer son talent5 : « Il n’y a eu en moi ni bien, ni mal, aucune contradiction, la justice ne saurait plus m’atteindre, – je suis hors d’atteinte – tel est probablement le véritable sens du mot perdu. Non pas absous ni condamné, notez bien : perdu6, – oui, perdu, égaré, hors d’atteinte, hors de cause. » La méchanceté de M. Ouine réside bien dans son indifférence amoraliste.
Sa profession de foi finale est celle du singe de Dieu : « La curiosité me dévore, […] Telle est ma faim. Que n’ai-je été curieux des choses ! Mais je n’ai eu faim que des âmes. Que dire, faim ? Je les ai convoitées d’un autre désir, qui ne mérite pas le nom de faim. Sinon une seule d’entre elles m’eût suffi, la plus misérable, je l’eusse possédée seul, dans la solitude la plus profonde. Je ne souhaitais pas faire d’elles ma proie. Je les regardais jouir et souffrir ainsi que Celui qui les a créées eût pu les regarder lui-même, je ne faisais ni leur jouissance ni leur douleur, je me flattais de donner seulement l’imperceptible impulsion comme on oriente un tableau vers la lumière ou l’ombre, je me sentais leur providence, une providence presque aussi inviolable dans ses desseins, aussi insoupçonnable que l’autre. […] Avec quelle jubilation j’entrais dans ces modestes consciences, si peu différentes d’aspect, si communes. […] La sécurité de ces âmes était entre mes mains, et elles ne le savaient pas, je la leur cachais ou découvrais tour à tour. Je jouais de cette sécurité grossière comme d’un instrument délicat, j’en tirais une harmonie particulière, d’une suavité surhumaine, je me donnais ce passe-temps de Dieu, car ce sont bien là les amusements d’un Dieu, ses longs loisirs… Telles étaient ces âmes. Je me gardais de les changer, je les découvrais à elles-mêmes, aussi précautionneusement que l’entomologiste déplie les ailes de la nymphe. Leur Créateur ne les a pas mieux connues que moi, aucune possession de l’amour ne peut être comparée à cette prise infaillible […]. D’une pâte vulgaire, j’ai fait une bulle de savon – plus légère, plus impalpable – ces gros doigts que vous voyez là ont réussi cette merveille. » Ouine se veut un démiurge, il imagine Dieu comme un spectateur de sa création, un esthète décadent. Sa démiurgie consiste quand même à s’affranchir de la réalité épaisse que le potier divin façonne patiemment et amoureusement. Lui reste dans l’illusion facile et fugace. Ouine qui ne s’est pas engagé dans le combat surnaturel a l’intuition finale de sa vacuité : « N’ai-je été qu’un regard, un œil ouvert et fixe, une convoitise impuissante ? »
Le récit de la confusion et du désordre
Ouine contemple ce monde vain et trop prévisible, voué à la confusion et au désordre. Le récit en est écrit tout d’une traite, sans partie ni chapitre. Il se déroule au moyen de scènes successives où paraissent toujours un ou plusieurs personnages : pas de longues descriptions, seulement des bribes de vie saisies sans que le lecteur ne puisse déterminer une intention claire. C’est une diégèse hachée, désarticulée aux ellipses fréquentes. Cette technique d’écriture correspond au projet d’évoquer le Mal à partir de l’ambiguïté, de l’obscurité, des énigmes, des mots piégés, de l’incohérence générale qui en résulte. Bernanos utilise en particulier les portraits successifs et contradictoires des personnages qui se jugent les uns les autres. Le Mal est bien dans cette opacité, ce désordre, cette confusion.
L’univers de M. Ouine est le monde des apparences, de l’illusion. Le lecteur peut avoir l’impression que Bernanos se désintéresse de son intrigue policière, qu’il ne cherche pas à répondre aux énigmes dont il a parsemé le récit :
Qui est véritablement Jambe-de-Laine ? Est-elle cette nymphomane que tous méprisent ?
Qui est M. Ouine ? Est-il l’âme damnée du canton ?
Le père de Philippe est-il réellement mort ?
Qui est le meurtrier du jeune vacher ? le gendre du vieux Devandomme ? M. Ouine ? Jambe-de-Laine ? Le maire ?
En fait, si ces questions restent en suspens, c’est que, dans ce monde illusoire, la vérité ne nous est pas accessible.
Le Mal dans Monsieur Ouine n’est pas à proprement parler le contraire du Bien comme dans Sous le soleil de Satan. Dans cette œuvre, le Mal est l’absence. S’il reprend du Soleil de Satan son aspect glacial, le vide et la solitude, on ne le voit pas dans son travail de conquête subversive. Ici nous avons affaire à la perte du sens du surnaturel, à une désespérante solitude, à un abandon terrifiant. L’homme y apparaît orphelin, perdu, errant dans les ténèbres extérieures, absolument abandonné y compris par Satan : « Le diable, voyez-vous, c’est l’ami qui ne reste jamais jusqu’au bout… » Bernanos affirme en creux une vision eschatologique profonde : à la fin des temps, au Jugement dernier, seuls resteront les actes d’amour. Tout le reste sera balayé comme paille au vent, détruit, brûlé au feu purificateur. Le Mal retournera au vide dont il est issu car le Mal est essentiellement le non-être. M. Ouine est simplement une anticipation de ce que n’est pas le royaume des cieux.
M. Ouine pourrait donc être une figure de l’Antéchrist. Avec ce roman Bernanos nous fait entrer dans les derniers temps. Le professeur révèle au prêtre, réputé spécialiste ès âmes et péchés, l’origine de la sanie universelle. Sa vision est purement pascalienne, janséniste en quelque sorte : « D’autant qu’il n’y a pas de malheur des hommes, monsieur l’abbé, il y a l’ennui. Personne n’a jamais partagé l’ennui de l’homme et néanmoins gardé son âme. L’ennui de l’homme vient à bout de tout, monsieur l’abbé, il amollira la terre. » La prophétie qui clôt son discours est en train de se réaliser.
« La dernière disgrâce de l’homme, fit-il, est que le mal lui-même l’ennuie. » Ici, le terme « disgrâce » doit être compris dans son sens fort, la perte de la grâce divine. Bernanos fait encore sien cet aphorisme de Pascal : « Tous les hommes sont corrompus et dans la disgrâce de Dieu ».
Avec Monsieur Ouine, Bernanos, plus pessimiste que jamais, peint l’avènement du monde moderne déjà esquissé dans Sous le Soleil de Satan. Seulement ici, la sainteté salvatrice n’apparaît plus. « L’heure vient où sur les ruines de ce qui reste encore de l’ancien ordre chrétien, le nouvel ordre va naître qui sera réellement l’ordre du monde, l’ordre du Prince de ce Monde, du prince dont le royaume est de ce Monde. »
Notes
1 On peut comprendre que, par association d’idées, le curé qui est désolé de la mort spirituelle de sa paroisse noyée par les eaux maléfiques adresse au docteur agnostique une mise en garde métaphorique : « L’heure viendra cependant où, dans un monde organisé pour le désespoir, prêcher l’espérance équivaudra tout juste à jeter un charbon enflammé au milieu d’un baril de poudre ». En effet le salpêtre entre dans la composition de la poudre noire. ↑
2 Adam signifie être humain (de adamah, terre, sol). ↑
3 « Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer. » Matthieu 18, 6 ↑
4 Phèdre, acte II, scène 2. ↑
5 Parabole des talents Matthieu 25,14-30. ↑
6 Psaumes 1:6 Car le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perd. ↑