Georges Bernanos
Nouvelle Histoire de Mouchette (1937)
La tragédie de l’enfance massacrée
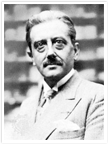 Ce roman de Bernanos prend place juste après le célèbre Journal d’un curé de campagne (1936), et avant Monsieur Ouine (1946) qui a occupé dès lors les dernières années de l’imagination du romancier. Le prénom du personnage éponyme rattache ce récit au Soleil de Satan dont le prologue relate la triste destinée de la première Mouchette. « La Mouchette de la Nouvelle Histoire n’a de commun avec celle du Soleil de Satan que la même tragique solitude où je les ai vues toutes deux vivre et mourir », écrit son créateur. Le second personnage entretient cependant plus que cette déréliction avec le premier ; de même la Nouvelle Histoire de Mouchette annonce un certain nombre de thèmes développés dans Monsieur Ouine, si bien que la Nouvelle Histoire constitue un pont entre le premier et le dernier roman de Bernanos. L’auteur a voulu écrire une pure tragédie : le destin inéluctable d’une enfant misérable, vouée à la mort par le Mal qui a submergé le monde. La Nouvelle Histoire révèle à sa manière l’emprise démoniaque du Soleil de Satan et décrit minutieusement, comme dans Monsieur Ouine, les arcanes infernaux. En effet, de même que le Royaume de Dieu commence secrètement à advenir dès cette vie terrestre, la voie de la perdition est, elle aussi, également présente. Mais elle est tellement plus prégnante qu’elle obsède Bernanos. Le péché originel y destine toujours l’homme à la solitude éternelle ; le silence de Dieu s’y fait toujours plus mystérieux. Pour certains êtres misérables, l’annonce d’un salut reste inaccessible, c’est pourquoi, en dernier recours, l’écrivain catholique révolté les confie à la grâce divine : « À l’une et à l’autre [les deux Mouchette] que Dieu fasse miséricorde ! » Le lecteur ne sait pas encore qu’il va prendre de plein fouet les conséquences de son manque de responsabilité personnelle : si Dieu paraît silencieux, c’est que nos existences n’incarnent plus sa voix.
Ce roman de Bernanos prend place juste après le célèbre Journal d’un curé de campagne (1936), et avant Monsieur Ouine (1946) qui a occupé dès lors les dernières années de l’imagination du romancier. Le prénom du personnage éponyme rattache ce récit au Soleil de Satan dont le prologue relate la triste destinée de la première Mouchette. « La Mouchette de la Nouvelle Histoire n’a de commun avec celle du Soleil de Satan que la même tragique solitude où je les ai vues toutes deux vivre et mourir », écrit son créateur. Le second personnage entretient cependant plus que cette déréliction avec le premier ; de même la Nouvelle Histoire de Mouchette annonce un certain nombre de thèmes développés dans Monsieur Ouine, si bien que la Nouvelle Histoire constitue un pont entre le premier et le dernier roman de Bernanos. L’auteur a voulu écrire une pure tragédie : le destin inéluctable d’une enfant misérable, vouée à la mort par le Mal qui a submergé le monde. La Nouvelle Histoire révèle à sa manière l’emprise démoniaque du Soleil de Satan et décrit minutieusement, comme dans Monsieur Ouine, les arcanes infernaux. En effet, de même que le Royaume de Dieu commence secrètement à advenir dès cette vie terrestre, la voie de la perdition est, elle aussi, également présente. Mais elle est tellement plus prégnante qu’elle obsède Bernanos. Le péché originel y destine toujours l’homme à la solitude éternelle ; le silence de Dieu s’y fait toujours plus mystérieux. Pour certains êtres misérables, l’annonce d’un salut reste inaccessible, c’est pourquoi, en dernier recours, l’écrivain catholique révolté les confie à la grâce divine : « À l’une et à l’autre [les deux Mouchette] que Dieu fasse miséricorde ! » Le lecteur ne sait pas encore qu’il va prendre de plein fouet les conséquences de son manque de responsabilité personnelle : si Dieu paraît silencieux, c’est que nos existences n’incarnent plus sa voix.
- Résumé de l’œuvre
- Les deux Mouchette
- Un univers romanesque typé par des thèmes récurrents
- La présence obsédante de la mort
- Le roman de la damnation
- Le roman de la compassion et de la colère
Résumé de l’œuvre
Mouchette, jeune Picarde de quatorze ans, s’est échappée de l’école où Madame, son institutrice, la brime cruellement. La vieille fille, dans son désir aveugle d’enseigner à tout prix et surtout de forcer les réticences, a transformé l’enfant en objet de dérision pour toute la classe. Mouchette qui n’a pas confiance dans ses propres qualités, qui se croit stupide, a développé une passivité, un repli sur soi et une sournoiserie pour protéger sa blessure de mal-aimée. Ce soir d’hiver où souffle le « vent noir », elle a choisi de regagner par le bois de Manerville la sordide masure qui abrite mal sa famille. Mais un violent orage et la nuit qui vient de tomber la désorientent tandis que la terre détrempée s’oppose à son avancée. Effondrée, trempée, épuisée, elle ne peut qu’accepter l’aide du beau braconnier Arsène qui la conduit à un de ses abris où il fait une flambée et lui offre du genièvre en guise de reconstituant. Le piégeur est ivre, déjà il manifeste son appétence pour cette jeune chair, il se répand en histoires extraordinaires pour séduire la gamine. Il a été mordu cruellement et, devant la fillette, il cautérise sans un cri la plaie avec la braise du foyer. Ils changent d’abri en pleine nuit. Mouchette, amoureuse du mauvais garçon si différent des hommes du village, le suit sans crainte. Comme il a des ennuis avec les gardes-chasse, il essaie de rendre l’enfant complice en lui proposant de livrer un faux témoignage. En effet il prétend s’être battu avec le garde Mathieu qui ne supporterait pas de voir le braconnier tourner autour de sa jeune femme, Louisa. C’est le garde qui l’aurait cruellement mordu. Arsène, gorgé d’alcool et déjà taraudé par la crise d’épilepsie qui va le terrasser en présence de Mouchette, ne se rappelle plus ce qui s’est passé alors. Il lui semble qu’il a tué le garde en le frappant au moyen d’un piège. Revenu de l’évanouissement dû à la crise et à l’alcool, il donne libre cours à son désir et violente la fillette.
Mouchette rentre chez elle endolorie, ne comprenant pas encore complètement ce qui lui est arrivé, mais pressentant le malheur, une honte secrète, qui va détruire sa raison de vivre. Elle y retrouve sa mère qui souffre d’une maladie de poitrine, dans l’indifférence générale de sa misérable famille. Le père et les fils sont partis s’enivrer. Seuls sont restés au logis la mère qui vient d’entrer en agonie et le jeune frère Gustave encore en nourrice. Au petit matin la mère meurt sans que la jeune fille, dérangée par les braillements du nourrisson, ait pu confier son trop lourd secret à sa maman. À l’aube, après être entrée sans joie dans son adolescence en défiant son père d’un vigoureux juron, elle s’enfuit de chez elle.
Chez l’épicière, Mouchette, qui s’est laissée séduire par le café et les vieux croissants, a permis aux commères d’entrapercevoir les stigmates de son agression. Elle se fait injurier ce qui redouble sa honte. En fait elle a formé le projet d’aller voir le garde Mathieu, d’aller « jusqu’au bout de son malheur ». Le garde est là, reposé, sans trace de blessure… Arsène a donc menti pour attirer la jeune fille. Le garde confirme son différend sans importance de la veille avec le braconnier, mais il apprend surtout à Mouchette qu’Arsène a été arrêté le matin même, accusé d’avoir dynamité la rivière afin de pourvoir des grossistes de la grande ville peu scrupuleux. Pour sa défense, le mauvais garçon a affirmé avoir secouru Mouchette à l’heure du délit, loin du lieu de la pêche interdite. Mouchette confirme l’alibi, ce qui lui vaut les sarcasmes de l’agent fédéral. Prise dans ses contradictions, elle laisse deviner le drame de la nuit. Voulant couvrir son beau bourreau, effrayée par la compassion féminine de Louisa, laissant libre cours à sa révolte animale, elle fanfaronne en déclarant qu’Arsène est son amant. Elle a décidé de retourner chez elle, mais sur le retour elle rencontre la gardienne des morts qui l’invite à se reposer. Mouchette est prise par la magie du lieu : un intérieur bien propret et une vieille femme douce. La vieille femme envoûte l’enfant par le récit de la mort d’une jeune fille riche qu’elle a veillée autrefois. D’ailleurs la bonne sorcière qui pratique le culte païen des morts a destiné à Mouchette les vêtements de l’antique défunte. Mouchette, dont la révolte a été vaincue par la bonté de la vieille, livre son secret hideux.
L’enfant va se rendre dans une ancienne carrière dont le fond est une mare aux eaux claires. Le lieu est ironiquement celui des rencontres amoureuses de ses compagnes. C’est là que Mouchette va célébrer ses épousailles avec la mort. Après avoir revêtu maladroitement et avec rage les habits de la belle jeune fille défunte, elle se noie.
Les deux Mouchette
Il convient d’abord de s’interroger pourquoi ce surnom de Mouchette s’est imposé à Bernanos dans les deux récits alors qu’il désigne des personnages différents. Si Mouchette est un surnom dans le Soleil, il est un prénom dans la Nouvelle Histoire. Le personnage s’identifie ainsi plus complètement avec le sens individualisant de son petit nom. Qu’évoque donc ce nom commun complété par un diminutif ? Dans un premier temps, vient à l’esprit la fragilité. Si Germaine Malhorty est déjà une adolescente bien formée, l’héroïne de la Nouvelle Histoire est encore une grande enfant menue, elle paraît bien plus insignifiante que son aînée. Toutes les deux veulent être libres, manœuvrent pour échapper à ceux qui voudraient les attraper. Toutes les deux souffrent de ne pas être regardées pour ce qu’elles sont. La première rêve d’un destin exceptionnel, tandis que la seconde pressent sourdement qu’elle est dépositaire d’un trésor enfoui. Ce sentiment de la différence, clair pour l’une et confus jusqu’à l’entêtement pour l’autre, les conduit toutes deux à une même solitude morale. Toutes les deux sont en révolte contre l’ordre, la première contre le conformisme bourgeois de ses proches, la seconde contre la tyrannie de Madame et l’étroitesse d’esprit de ses condisciples, ayant choisi de « défier par une insouciance sauvage le jugement dédaigneux de ses compagnes et les moqueries des garçons. »
Toutes les deux sont affublées d’un père violent, alcoolique, qui les considère comme quantité négligeable. Ce père craint, voire haï, ne les prépare pas à vivre une féminité épanouie. Toutes les deux vont connaître un destin tragique. Parce qu’elles sont habitées par l’orgueil, déclaré pour l’une, sous-jacent pour l’autre, elles sont amenées à emprunter des chemins périlleux afin d’affirmer leur différence. Ainsi les retrouve-t-on toutes les deux à battre la campagne de nuit, au mépris de toute prudence. Une même volonté farouche leur interdit ensuite de revenir sur leurs pas. On peut remarquer également que toutes deux rencontrent des personnages qui infléchissent leur destinée spirituelle : La première va provoquer son amant, puis bute sur l’abbé Donissan ; la seconde trouve inopinément sur son chemin le beau braconnier Arsène, puis la vieille servante qui veille les défunts. Leur parcours hasardeux les expose au crime et les conduit inexorablement à la mort par le suicide. Voilà pour les ressemblances les plus remarquables.
Examinons dès lors les différences tout aussi marquantes. Si la première Mouchette est issue de la petite bourgeoisie rurale, la seconde appartient aux franges de la société. Derrière des destins apparemment parallèles, se révèle une orientation particulière. La première héroïne a en quelque sorte choisi sa voie, même si sa résolution est en partie la conséquence de son environnement, tandis que, pour l’essentiel, la seconde Mouchette est une victime absolue. La seconde n’a pas connu la joie de voir s’épanouir sa sexualité. La différence la plus notable entre elles reste l’accès possible à une vie spirituelle. La première Mouchette a pu pressentir son insatisfaction, son désir d’absolu, même dans ses premiers vœux sataniques, puis elle a été touchée à mort par la vanité de son désir orgueilleux, et a sans doute entrevu, grâce à la communion des saints, les portes d’une rédemption, d’un possible pardon. La seconde a vécu le dénuement d’une humanité abandonnée, méprisée et piétinée1. Plus étonnant, le lecteur découvre, chez ce personnage apparemment étranger à la religion, un être marial qui s’ignore, une servante des pauvres soucieuse d’autrui. Elle se préoccupe de l’avenir d’Arsène. Surtout, lors de l’agonie de sa mère, elle tente d’oublier sa propre souffrance et sa propre misère pour secourir la moribonde, la consoler et la remplacer. À la différence de son aînée, elle exerce spontanément cet « autre sentiment qu’elle ne connaît pas du tout – car les gosses lui font horreur – d’humilité protectrice, d’inaltérable patience, d’une patience plus forte que tous les dégoûts – l’instinct maternel2 frais éclos dans sa conscience, aussi fragile qu’une rose de mai. » L’amour naissant éprouvé pour le marginal a débouché naturellement sur le désir de donner la vie.
À la lecture de ce qui précède, on sent bien que Bernanos a nourri un projet différent.
Un univers romanesque typé par des thèmes récurrents
Ce récit s’inscrit dans un univers romanesque familier au lecteur bernanosien. En premier lieu, il se déroule dans cet Artois où le jeune Georges passait ses vacances.
La Nouvelle Histoire est en outre pour l’essentiel un roman nocturne où sévissent la pluie et la boue. La nuit donne libre cours aux cauchemars, au déchaînement de la violence et de l’animalité. La pluie et la boue comme la nuit appartiennent au domaine infernal. La mort y rôde, tend ses pièges. Au dehors règne un monde inquiétant où l’homme éprouve une solitude insupportable. Même les taudis humides, glaciaux, inconfortables sont préférables à cet univers extérieur où plane la menace. La certitude de la misère vaut mieux que la peur de l’inconnu.
Le récit met en scène un braconnier sauvage et séducteur, personnage nocturne par excellence. Arsène annonce le jouisseur Eugène Demenou que tout le monde accuse du viol et de la mort du petit vacher dans Monsieur Ouine. Ces marginaux solitaires, instinctifs, suivant leurs seuls désirs, séduisants dans leur différence radicale avec la communauté villageoise, épris de liberté, ont une cruelle innocence à l’image de la nature dans laquelle ils se fondent pour l’exploiter. Ils séduisent les filles par leur étrangeté et leur animalité. Bernanos, à l’opposé de Rousseau, a sans doute voulu exprimer dans ces personnages la beauté de l’homme obscurcie et pervertie par le péché originel.
Comme dans le prologue du Soleil de Satan, la population provinciale est soumise à un déterminisme social hérité du naturalisme. Conformisme, mesquinerie, gourmandise, lubricité, médisances, matérialisme, secrets de famille, atavisme mènent à proprement parler une ronde infernale.
Face à cet environnement gris et délétère, quelques âmes qui aspirent à une autre existence se trouvent marginalisées par leur différence. Bernanos aime cette jeunesse en révolte qui a soif d’un absolu qu’elle ne sait pas nommer. Dans ce registre on peut noter une même sournoiserie qui sert de protection à la différence. Il s’agit pour ces jeunes gens de dissimuler la richesse de leur vie intérieure, d’ailleurs pas toujours verbalisée en particulier chez les personnages incultes, souvent dénommée fierté ou orgueil, afin de lui permettre d’exister face à la pression sociale. Il n’est pas étonnant que ces jeunes êtres vivent la solitude : « l’orgueil diabolique qui l’inspire reste mêlé de crainte. Mais pour la première fois de sa vie, la révolte demi consciente, qui est l’expression même de sa nature, a un sens intelligible. Elle est seule, vraiment seule aujourd’hui, contre tous. » C’est bien cet orgueil entêté qui conduit ces jeunes gens à leur destruction.
La présence obsédante de la mort
Au début du récit, la mort est lointaine, « Mouchette y pense comme à un événement bizarre, aussi improbable, aussi inutile à prévoir que, par exemple, le gain fabuleux d’un gros lot. À son âge, mourir ou devenir une dame sont deux aventures aussi chimériques. » Mais peu à peu, la mort va envahir l’espace romanesque.
Dans la première partie, elle affleure avec la traque du braconnier, avec le produit de ses pièges : la gibecière « est pleine de lapins à peine raidis encore, au poil gluant d’eau et de sang. » Par la suite, les évocations de la sueur et du sang reviennent plusieurs fois, notamment lors de la lutte mortelle entre le garde et le marginal. De même la présence furtive de la mort est suggérée par la pesanteur de la nuit menaçante. Elle apparaît brutalement dans le déchaînement des éléments, dans l’affrontement des hommes qui se clôt sur le meurtre sauvage, l’acharnement bestial du piégeur. Elle culmine dans la « petite mort » du débordement épileptique avant de se réactiver dans l’attentat sexuel brutal, toutes griffes dehors comme dans la chasse animale.
La deuxième partie nous la montre à l’œuvre sournoisement dans la nuit du misérable logis et de la conscience de Mouchette. Tandis qu’une bise glaciale s’insinue par les trous des murs de torchis, que l’obscurité tente de faire régner sa loi implacable, elle taraude la poitrine de la mère sous la forme d’une maladie pulmonaire à son paroxysme. Elle tourmente le corps et l’esprit de la fillette par l’obscure honte qui conduit Mouchette à haïr sa propre chair. Elle est présente dans les deux agonies, celle de la maladie, celle de la Passion3. « L’outrage qui lui a été fait l’a comme surprise dans l’exaltation de son humble ferveur, et elle ne peut ressentir pour le ravisseur de sa chair une véritable haine, une haine de femme. Le souvenir de la violence subie se confond, dans sa mémoire puérile, avec tant d’autres. Sa raison ne la distingue guère des sauvages corrections de l’ivrogne. Mais la honte qui lui en reste est d’une espèce inconnue car, jusqu’ici, elle a craint et méprisé ses bourreaux. Tandis que M. Arsène demeure là où son admiration l’a placé, une fois pour toutes, une fois pour toujours. Ô maudite enfance, qui ne veut pas mourir ! »
La troisième partie est celle de l’hallali. « Sa volonté exténuée ne saurait procéder que par défis, ainsi qu’à la limite de ses forces, une bête chassée avance sous le nez des chiens par bonds convulsifs, avant de rouler sur le côté, morte. » Mouchette, venue s’exposer devant le village, est poursuivie par la meute des moqueries et des injures. Recrue de fatigue et meurtrie par la honte, la jeune fille accepte de faire face chez la gardienne des morts, elle va y être l’innocente victime d’un sortilège, de « l’étrange douceur dont elle est en ce moment la proie, et qui paraît tisser autour d’elle, diligente, patiente, les fils d’une trame invisible. » Vaincue dans sa révolte, dépossédée de son secret, dotée d’une parure funéraire par la vieille gardienne des défunts, Mouchette est submergée par l’idée d’une mort qui mettrait un terme à ses souffrances et à sa honte. Par la magie du verbe païen dans la bouche de la bonne sorcière, Mouchette éprouve la délétère séduction de la mort.
La dernière partie est très ambiguë. Elle relate les conditions psychologiques du suicide. Bernanos cherche dans l’obscurité de cette conscience quelles pulsions ont pu conduire l’enfant à l’acte irréparable : dégoût de soi-même, peur, rage d’en finir, égarement, séduction morbide, geste irraisonné qu’on ne peut plus défaire… Bernanos s’attaque à une question débattue dans l’Église d’alors. L’institution voyait dans le suicide un péché mortel, à l’image du désespoir de Judas qui n’avait pas cru que sa trahison pourrait recevoir un pardon. Le romancier considère d’abord dans le suicide soit une maladie, « certaines formes d’obsessions qui ne relèvent que de l’aliéniste », soit un « phénomène inexplicable, d’une soudaineté effrayante, qui fait penser à ces décompositions chimiques sur lesquelles la science à la mode, encore balbutiante, ne fournit que des hypothèses absurdes ou contradictoires. » Il veut démontrer que le suicide n’est pas « le dernier maillon d’une longue chaîne de réflexions ou du moins d’images, la conclusion d’un débat suprême entre l’instinct vital et un autre instinct, plus mystérieux, de renoncement, de refus. » En fait cet acte désespéré est une impulsion irrépressible. « [Mouchette] ne voulait pas mourir. C’était plutôt comme une sorte de honte inexplicable, une timidité mystérieuse, celle qui saisit tout à coup certains nerveux, non à l’approche d’inconnus, mais parmi des amis familiers, en pleine conversation, avec la brutalité d’une crise épileptique, traçant autour d’eux un cercle invisible de silence et de solitude où l’on croit les voir tourner, affolés ainsi que le scorpion cerné par les flammes. » Au moment crucial, Mouchette ne reçoit aucune grâce spéciale. Elle est livrée tout entière à l’action satanique : « La même force de mort, issue de l’enfer, la haine vigilante et caressante qui prodigue aux riches et aux puissants les mille ressources de ses diaboliques séductions, ne peut guère s’emparer que par surprise du misérable, marqué du signe sacré de la misère. Il faut qu’elle se contente de l’épier, jour après jour, avec une attention effrayante, et sans doute une terreur secrète. Mais la brèche à peine ouverte du désespoir dans ces âmes simples, il n’est sans doute d’autre ressource à leur ignorance que le suicide, le suicide du misérable, si pareil à celui de l’enfant. » Mouchette est donc la victime parfaite de Satan. Elle n’a pas consenti à sa propre mort, elle a été contrainte de s’y abandonner. Voilà le scandale ultime exercé contre le pauvre entre les pauvres, l’enfant de la misère.
Pourtant, alors que Bernanos voit dans l’autolyse la haine démoniaque qui saisit le désespéré, il semble en même temps vouloir montrer que le suicide quitte son caractère de faute grave pour devenir sacrificiel comme dans le martyre. Voilà l’ambiguïté finale : dans ce récit tragique, Bernanos opère un retournement en faisant mourir Mouchette par noyade, ce qui rattache sa fin à un proto-baptême. L’eau est en effet pour les chrétiens le lieu de l’immersion, le symbole sacramentel de la plongée dans la mort et la résurrection du Christ. Elle est aussi de ce fait l’eau qui purifie des conséquences du péché originel. Cette hypothèse est-elle recevable ? Plusieurs détails permettent de l’envisager. La mare, située dans une ancienne carrière, est précédée d’ « un écriteau que la malice des garçons a bariolé de dessins obscènes et qui, au clair de lune, allongé par son ombre, dessine une croix sur la paroi blafarde. » Plus loin, le romancier note qu’ « observée de près, l’eau semblait claire. » Au moment de l’immersion, « l’eau insidieuse glissa le long de sa nuque, remplit ses oreilles d’un joyeux murmure de fête. » Les derniers instants sont marqués par « l’odeur même de la tombe », sensation curieuse quand on est plongé dans un milieu aquatique. Ajoutons que la vieille gardienne des morts a prétendu un peu plus tôt que le défunt devait « finir de se purifier sous la terre ». Mouchette a certainement retenu que la mort était la seule purification possible de sa souillure. Nous pourrions ajouter que Bernanos fait mourir Mouchette un dimanche à l’heure de la grand-messe désertée « car personne ne va plus à la grand-messe. » Est-ce une simple coïncidence ou le désir d’associer le sacrifice de la jeune fille à la Pâque du Christ ?
Le roman de la damnation
Les malheurs de Mouchette ne sont pas le fruit du hasard, mais bien d’un déterminisme social, nous pourrions écrire de structures de péché.
Tout commence avec la pauvreté qui devient bien vite misère. Une part de la population doit se livrer à de petits métiers pour survivre : ouvriers agricoles mal payés, forains, quand il ne s’agit pas de se livrer à des activités illégales et dangereuses comme le braconnage ou la contrebande… Les logis sont inconfortables, humides, ouverts aux vents. Les habits protègent mal des intempéries. Ces pauvres gens sont méprisés, moqués. Mouchette appartient bien à ce sous-prolétariat défavorisé et rejeté. C’est lui qui crée le terreau de sa solitude.
Une autre caractéristique est la consommation abusive d’alcool dans ces pages qui décrivent la misère de ce petit peuple cherchant à survivre. L’alcool apparaît essentiellement sous les espèces du genièvre, eau-de-vie de grains souvent mal distillée, titrant 40° et parfumée aux baies de genévrier. Cette boisson offre des services constants à ses adeptes. C’est un revigorant : épuisée par sa longue course à travers bois contre les intempéries, Mouchette est recrue de fatigue, elle a le ventre nouée par la faim. Le braconnier lui donne alors à boire du genièvre. « L’alcool est descendu dans sa poitrine ainsi qu’un jet de plomb fondu. Dieu ! Il lui semble que sa fatigue coule le long de ses membres, fourmille à chaque articulation blessée. » C’est, suivant l’occasion, un désinfectant, un anesthésiant, les lampées de l’amitié, le signe de la force virile. Il sert surtout à oublier la dureté de la vie, à endormir la faim, à plonger son consommateur dans une indifférence proche de l’abrutissement. L’alcool est aussi un anxiolytique qui permet d’affronter des situations effrayantes. L’eau-de-vie détruit ceux qui s’y adonnent, réclamant des quantités toujours plus importantes pour être « fin saoul ». Surtout elle lève les inhibitions, rendant les buveurs chroniques violents, colériques et parfois criminels. Bernanos a bien noté comment la pauvreté extrême secrète la misère morale par l’alcoolisation. Un des buts du récit est de dénoncer ce scandale social.
Ce petit peuple abruti par l’alcool se livre au mensonge qui embellit une existence terne ou sert à tromper le prochain. Mouchette est la victime de la duperie d’Arsène qui lui fait croire à un « cyclone » et à des démêlés mortels avec le garde Mathieu. Le braconnier est tout autant la victime de son imagination enfiévrée par l’eau-de-vie que désireux de retenir la jeune fille pour lui imposer son désir. Les misérables sont soumis à l’abus de pouvoir. Méprisés, ils doivent subir les constantes vexations de ceux qui ont autorité : coups et injures de la part des parents, reproches des commerçants ou des adultes… À ce sujet, il est intéressant de noter que Bernanos n’a pas la main tendre avec les enseignants4. Madame, l’institutrice, qui humilie sa petite élève rebelle sous couvert de bonnes intentions, manifeste une cruauté sadique. Ces comportements indignes soulignent la différence et mortifient celle qui est rejetée. Il n’est donc pas étonnant que se développent des comportements de protection qui utilisent à leur tour le mensonge ou la sournoiserie. Mouchette, tout au long du récit, s’entête à vouloir protéger son trésor intime, son jardin secret. « Le mensonge n’a jamais paru répréhensible à Mouchette, car mentir est le plus précieux, et sans doute l’unique privilège des misérables. »
Ce rejet conduit à la solitude, mais aussi au mépris. Ces misérables sont vicieux, pensent les villageois « comme il faut ». Mouchette, loin d’être plainte et défendue après son viol, est plutôt accusée de dévergondage par l’épicière, ses clientes et le garde. Cette société mesquine a tôt fait de transformer la victime en coupable. La honte qui en résulte a aussi une autre origine plus intime dans le mécanisme psychologique de l’autopunition. « Une fois de plus, sa crainte et sa fureur se retournent déjà contre elle-même, c’est elle-même qu’elle hait. Pourquoi ? Quelle faute a-t-elle commise ? Hélas ! plût au ciel qu’elle en eût commis, en effet ! Quel remords vaudrait la honte qui la ronge et à laquelle sa pauvre logique ne saurait trouver aucune raison intelligible, car c’est la honte aveugle de sa chair et de son sang. Tout en marchant, elle crispe les deux mains sur la poitrine blessée, la déchire sournoisement à petits coups rageurs, comme pour tuer. » Mouchette se sent obscurément coupable d’avoir perdu sa seule richesse : sa pureté. « Tout ce grand espoir qu’elle a eu, si grand qu’il n’était sans doute pas à la mesure de son cœur, qu’elle n’en a tiré aucune vraie joie, qu’elle ne garde que le souvenir d’une attente merveilleuse, à la limite de l’angoisse, tout ce grand espoir n’était donc que le pressentiment d’une humiliation pire que les autres, bien que de la même espèce. Elle est allée seulement plus profond, si profond que la chair elle-même y répond par une souffrance inconnue, qui rayonne du centre de la vie dans le pauvre petit corps douloureux. » Mouchette pressentait qu’un jour elle pourrait offrir son intégrité physique à celui qui l’aurait regardée et appréciée, qui aurait eu besoin d’elle. « Elle s’émerveille seulement qu’une fille puisse refuser sa jeunesse, et que cette jeunesse ne se donne qu’une fois. La valeur du don ne lui importe guère. Elle supporte volontiers qu’il soit à la mesure de sa pauvreté, pauvre comme elle. Qu’on implore d’elle serait déjà une humble revanche. Mais au fond de son cœur, hier encore, une voix secrète lui disait qu’elle l’offrirait un jour. » Le destinataire de ce présent s’est finalement emparé par la violence de ce que la jeune fille rêvait de donner, tout elle-même, corps et esprit, sa virginité comprise comme la possibilité d’un don unique et définitif à l’être aimé. Sa vie est désormais saccagée, son enfance salie, volée. Elle est entrée dans le cycle infernal, illustrant sans le savoir le scandale évangélique exprimé par Matthieu en 18, 6 : « Mais, si quelqu’un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu’on suspendît à son cou une meule de moulin, et qu’on le jetât au fond de la mer. »
Elle est donc, par la solitude, la honte, acculée au désespoir. L’unique échappatoire est de disparaître, de sacrifier ce corps souillé, de faire taire définitivement cet esprit bouleversé par le dégoût, la honte et la haine de soi. Le suicide est envisagé non seulement comme un atroce acte réparateur, mais encore comme un refuge maternel. « Elle songeait à sa propre mort, le cœur serré non par l’angoisse, mais par l’émoi d’une découverte prodigieuse, l’imminente révélation d’un secret, ce même secret que lui avait refusé l’amour. Et, certes, l’idée qu’elle se faisait de cet événement mystérieux restait puérile, mais l’image qui la laissait la veille insensible, l’enivrait maintenant d’une tendresse poignante. Ainsi un visage familier nous apparaît dans la lumière du désir, et nous savons tout à coup que depuis longtemps il nous était plus cher que la vie. » Dans ce désir d’anéantissement plus fort que l’instinct de survie, Bernanos discerne la dernière ruse satanique, l’aboutissement naturel de la stratégie de noire séduction, l’ultime tromperie de la logique mortifère. Cependant la haine démoniaque s’est exercée sur une enfant innocente, sur un être qui, dans son dénuement, n’a pas eu accès à une vie spirituelle et à la possibilité d’un pardon, c’est pourquoi le romancier fait en sorte que le suicide de Mouchette échappe en partie à la condamnation.
Le roman de la compassion et de la colère
Bernanos a, dans un premier temps, sollicité la compassion du lecteur. Mais il sait aussi que la pitié est une manière d’exonérer la responsabilité par l’attendrissement romantique : « Ce qu’une fille des faubourgs à l’imagination ensemencée par les feuilletons et le cinéma fait si aisément, Mouchette s’y exerce maintenant avec une maladresse poignante. Il lui faut un effort immense pour seulement comprendre qu’elle doit à sa déception d’amour une sorte de promotion mystérieuse, qu’elle est entrée ainsi du coup dans le monde romanesque à peine entrevu au cours de quelques lectures, qu’elle appartient désormais à ce peuple privilégié où les cœurs sensibles vont chercher, ainsi que l’amateur dans son vivier la truite la plus brillante, une belle proie pour leur pitié. »
C’est pourquoi la quatrième partie prend un ton nouveau, celui de la colère, de la sainte colère.
La tragédie de Mouchette s’est transformée en la nôtre. Bernanos attend plus que de la pitié, il désire une révolte salutaire. Il nous demande d’arrêter de pactiser avec le Mal. Notre silence coupable de bien-pensants cache au fond un médiocre égoïsme, un refus de changer. Nos premières victimes sont les enfants, êtres fragiles et dépendants, puis les femmes. Nous autres, bien-pensants, ajoutons à notre aveuglement et à notre égoïsme le péché abominable de culpabiliser les victimes. C’est pourquoi les forces de mort ont pris possession de notre Terre jusqu’à y créer les portes de l’enfer. Bernanos est persuadé que la civilisation moderne nous a fait entrer dans les derniers temps. Les signes en sont la paupérisation croissante de l’humanité, la solitude, le désespoir, la misère morale. L’auteur voit avec effroi notre monde aller vers sa condamnation dans l’indifférence générale. La Nouvelle Histoire de Mouchette est finalement un ultime acte de charité avant qu’il ne soit trop tard. Bernanos s’est déjà saisi de sa nouvelle manière, celle de Monsieur Ouine : convertir, s’il est encore possible, par l’effroi et l’écœurement. La fiction ne doit plus nourrir des émotions fugaces, mais des décisions courageuses. Bernanos, plus que jamais, met son art de conteur au service d’un militantisme chrétien qu’il dissimule subtilement derrière une noirceur réaliste en même temps que fantasmatique. « J’ai juré de vous émouvoir, d’amitié ou de colère, qu’importe ! », avait-il écrit en 1931 dans la Grande Peur des bien-pensants. Ici et désormais, Bernanos a choisi la voie de la colère qui glace et fustige le lecteur5.
Notes
1 On pourrait presque dire le martyre dans la mesure où elle reste fidèle à ses valeurs jusqu’à en mourir. ↑
2 D’autres personnages comme l’épouse du garde Mathieu ou la vieille veilleuse des morts sont capables de compassion pour l’enfant humiliée dans son être profond. Cette solidarité féminine qui dépasse le qu’en-dira-t-on me paraît nouvelle chez Bernanos. ↑
3 Mouchette, à sa manière, participe à la Passion du Christ à Gethsémani, en particulier par son désir de protéger son bourreau, de se sacrifier pour lui. ↑
4 M. Ouine, dans un genre différent, est aussi fortement critiqué par Bernanos. Il conviendrait d’ajouter que le professeur de langues, dans son enfance, a lui-même été victime d’un attentat de la part d’un de ses enseignants. Bernanos aurait-il été victime de ses maîtres dans ses jeunes années ? ↑
5 Bernanos va apparemment abandonner le roman pour le journalisme pamphlétaire de 1937 à 1943. Apparemment, car il continue de porter en lui, au cours de son exil sud-américain, les étranges pages de Monsieur Ouine. ↑