Madame Bovary : une œuvre réaliste ou romantique ?
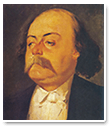 Autour de 1850, une nouvelle sensibilité autant littéraire que picturale se dessine : il s’agit du réalisme. Tandis que Murger écrit Les Scènes de la vie de Bohème, que Champfleury donne Monsieur de Boisdhyver, Courbet déclenche un véritable scandale avec son tableau Un enterrement à Ornans parce qu’un chien vient entacher le caractère sacré d’une inhumation. Cette évolution avait été préparée par le positivisme scientiste d’un Auguste Comte qui avait permis de réagir contre les excès du sentimentalisme romantique. C’est dans ces conditions que l’histoire personnelle de Flaubert va rejoindre les tendances d’une certaine élite de son temps. Il venait d’écrire La Tentation de Saint Antoine, somptueuse évocation de toutes les hérésies, et avait soumis son ouvrage à l’appréciation de ses amis Du Camp et Bouilhet. Les deux critiques conseillèrent alors à Flaubert de renoncer au lyrisme et de purger son esprit trop imaginatif en se consacrant à une histoire triviale. Sous forme de boutade peut-être, ils lui proposèrent de romancer une aventure sordide qui avait défrayé la chronique de Ry : l’adultère, l’endettement et pour finir, la ruine et le suicide de l’épouse du médecin Delamare. Flaubert allait entreprendre la rédaction de Madame Bovary. Son roman serait-il une oeuvre réaliste comme le souhaitaient ses amis ? N’y retrouverait-on pas les traces d’une propension à une rêverie grandiose ? Flaubert pourrait-il discipliner ses tendances profondes ?
Autour de 1850, une nouvelle sensibilité autant littéraire que picturale se dessine : il s’agit du réalisme. Tandis que Murger écrit Les Scènes de la vie de Bohème, que Champfleury donne Monsieur de Boisdhyver, Courbet déclenche un véritable scandale avec son tableau Un enterrement à Ornans parce qu’un chien vient entacher le caractère sacré d’une inhumation. Cette évolution avait été préparée par le positivisme scientiste d’un Auguste Comte qui avait permis de réagir contre les excès du sentimentalisme romantique. C’est dans ces conditions que l’histoire personnelle de Flaubert va rejoindre les tendances d’une certaine élite de son temps. Il venait d’écrire La Tentation de Saint Antoine, somptueuse évocation de toutes les hérésies, et avait soumis son ouvrage à l’appréciation de ses amis Du Camp et Bouilhet. Les deux critiques conseillèrent alors à Flaubert de renoncer au lyrisme et de purger son esprit trop imaginatif en se consacrant à une histoire triviale. Sous forme de boutade peut-être, ils lui proposèrent de romancer une aventure sordide qui avait défrayé la chronique de Ry : l’adultère, l’endettement et pour finir, la ruine et le suicide de l’épouse du médecin Delamare. Flaubert allait entreprendre la rédaction de Madame Bovary. Son roman serait-il une oeuvre réaliste comme le souhaitaient ses amis ? N’y retrouverait-on pas les traces d’une propension à une rêverie grandiose ? Flaubert pourrait-il discipliner ses tendances profondes ?
- Madame Bovary, une œuvre réaliste
- Madame Bovary recèle des éléments romantiques
- Un réalisme personnel
- Conclusion
Madame Bovary, une œuvre réaliste
Qu’est-ce que le réalisme ?
Le réalisme est l’enfant de la déception. Les hommes du milieu du XIXe siècle ont perdu leur chimère de fraternité, de liberté. Il faut dire que la répression qui a suivi la révolution de 1848 ou la prise du pouvoir par Louis Napoléon Bonaparte en 1851 a installé une bourgeoisie affairiste et réactionnaire. Ces hommes ont aussi perdu leurs illusions artistiques : le romantisme erre dans la rhétorique grandiloquente, délaisse la réalité pour une évasion mensongère. Des écrivains comme Mérimée, Stendhal, Henri Monnier et surtout Balzac ont préparé le terrain. À une époque où la photographie se développe, les artistes visent à une reproduction intégrale et objective de la réalité la plus banale par la recherche du document humain et social. C’est l’ « école de la sincérité dans l’art », du « daguerréotype littéraire ». La revue Le Réalisme proposait cette définition : « Le réalisme conclut à la reproduction exacte, sincère du milieu social, de l’époque où l’on vit, parce qu’une telle direction d’études est justifiée par la raison, les besoins de l’intelligence et l’intérêt du public, et qu’elle est exempte de mensonges, de toute tricherie ». Le réalisme est surtout un refus des excès, comme l’avait exprimé Champfleury à George Sand : « Ne pas dire à celui qui est monté sur un âne : quel beau cheval vous avez là ! »
Va-t-on retrouver ces éléments constitutifs dans Madame Bovary ?
Condamnation des dangers du romantisme
- Madame Bovary est essentiellement une condamnation de cette propension de l’esprit à tout enjoliver, à parer la réalité la plus triviale des feux de l’imagination.
- Flaubert dénonce un certain romantisme par refus de l’invraisemblance et haine des lieux communs. Il se moque de la littérature dont Emma se gorge au couvent : « Ce n’étaient qu’amours, amants, amantes, dames persécutées s’évanouissant dans des pavillons solitaires, postillons qu’on tue à tous les relais, chevaux qu’on crève à toutes les pages, forêts sombres, troubles du cœur, serments, sanglots, larmes et baisers, nacelles au clair de lune, rossignols dans les bosquets, messieurs braves comme des lions, doux comme des agneaux, vertueux comme on ne l’est pas, toujours bien mis, et qui pleurent comme des urnes ».
- Flaubert démystifie un certain nombre de poncifs. La grande passion romantique qui emporte l’âme devient un mariage d’affaires où les sentiments sont sacrifiés à l’intérêt. Tout au long du roman, les questions d’argent empoisonnent les idylles successives d’Emma.
- L’auteur de Bouvard et Pécuchet va surtout dénoncer les dangers du rêve qui dénature la réalité, de ce rêve éveillé que vit Emma et qui la conduira, d’abandon en lâcheté, à l’issue fatale pour avoir poursuivi un impossible idéal. Par exemple, lorsqu’elle est invitée à la Vaubyessard, elle pare un vieillard assez délabré de toutes les séductions de son esprit enfiévré parce qu’il a été un grand amant et qu’il a connu une existence romanesque. Plus loin, lorsqu’elle rêve de Paris, elle choisit inconsciemment les tableaux qui peuvent flatter ses chimères : là tout n’est que luxe, mystère, passion dévorante. « C’était une existence au-dessus des autres, entre ciel et terre, dans les orages, quelque chose de sublime. Quant au reste du monde, il était perdu sans place précise comme n’existant pas ». C’est alors que la perspective s’inverse, c’est l’exceptionnel qui devient ordinaire, tandis que le monde réel, banal est évacué, rayé de l’existence.
Les éléments proprement réalistes
- Loin d’être seulement la critique d’une imagination enflammée, Madame Bovary présente les principaux éléments caractéristiques du réalisme.
- Tout d’abord, comme nous l’avons noté plus haut, Flaubert n’a pas inventé la trame de son récit, il l’a tirée d’un fait divers. Comme un journaliste, il a enquêté sur place pour mieux comprendre les personnages qu’il allait mettre en scène. Il a amassé des documents pour atteindre à l’exactitude : il a lu des traités de médecine pour connaître les symptômes d’un empoisonnement par l’arsenic avant de décrire l’agonie d’Emma. Il n’a pas hésité à consulter un avocat pour ne pas commettre d’erreurs dans les désordres financiers de son héroïne non plus que dans leur règlement. Flaubert se livre à un véritable travail de bénédictin. Afin d’assurer la cohérence interne de son récit, en ce qui concerne la localisation des événements, il va jusqu’à dessiner un plan d’Yonville.
- Au-delà de ce souci de vérité, Flaubert cherche l’objectivité avec cette « impartialité qu’on met dans les sciences physiques ». Il jette un regard quasi médical sur le monde qu’il décrit. Il essaie de peindre ce qui est visible. À défaut de pouvoir rendre toute la réalité, il choisit les détails pittoresques et justes. La cuisine du père Rouault est autant le lieu poétique où la lumière du soleil joue au travers les persiennes que l’endroit sordide où les mouches mènent leur bal répugnant. En arrivant aux Comices, « les fermières des environs retiraient, en descendant de cheval, la grosse épingle qui leur serrait autour du corps leur robe retroussée, de peur des taches ». Le détail est non seulement vivant, il est révélateur de la légendaire vertu d’économie normande. Comme un photographe, Flaubert apprend à connaître ses modèles de l’extérieur vers l’intérieur. Au travers des comportements, nous voyons peu à peu les caractères se dessiner. Flaubert nous convie à observer. Avec lui, nous devinons progressivement la timidité maladive de Charles Bovary, son incompréhension, son application bornée comme si nous étions les témoins amusés du chahut déclenché par l’arrivée du “nouveau”. Voilà posé l’essentiel de la personnalité de celui qui sera incapable de satisfaire et de comprendre sa femme ! De même la sensualité d’Emma nous est révélée, avant même qu’elle envahisse sa vie, par la manière dont la jeune campagnarde boit la liqueur par petits coups de langue gourmands.
- Cette volonté de réalisme, nous la retrouverons aussi dans la façon de parler. Chaque personnage possède le langage de sa classe sociale, en accord avec sa psychologie. Ainsi le père Rouault s’exprime comme un campagnard madré ; ses propos sont émaillés de provincialismes tels que « la petite », « manger le sang », « chez nous » (pour "à la maison") et dévoilent sa compréhension aussi exacte qu’intuitive de la situation : il n’imposera pas au timide Charles l’aveu quasi impossible de sa passion. Lors de l’arrivée des époux Bovary à Yonville, Homais leur tient un discours où il se gargarise de termes savants pour impressionner son auditoire mais où, sous l’éloquence scientifique, percent l’intérêt et la stupidité.
- Ensuite nous devons noter cette tendance continuelle à expliquer les caractères par l’influence du milieu et du tempérament. Comme un savant, Flaubert constate les lois biologiques qui régissent individus et sociétés. S’il insiste sur l’adolescence d’Emma, c’est que son héroïne est en partie conditionnée par ses expériences de pensionnat. Mais il faudrait ajouter que ces expériences ont elles mêmes un retentissement très personnel sur cet esprit mystique du fait des origines de l’enfant. Cette jeune paysanne qui lit Le Génie du Christianisme de Chateaubriand et y découvre le sentiment romantique de la nature, ne peut idéaliser ce qu’elle connaît fort bien : la campagne, aussi reportera-t-elle son lyrisme sur des paysages inconnus : la mer tempétueuse ou les ruines. Ainsi Flaubert veut-il montrer le déterminisme qui nous gouverne.
- Enfin l’œuvre objective doit renoncer à l’hérésie du moralisme. Le roman n’a pas à défendre une thèse, il se doit d’exposer des faits. Au lecteur à tirer les leçons ! Le livre ne doit plus faire de concessions à un prétendu « bon goût ». Flaubert n’hésitera pas à heurter notre sensibilité par des détails insupportables lors de l’agonie d’Emma. Rien ne nous est épargné.
- On peut dire que Madame Bovary par bien des côtés est une œuvre anti-romanesque. C’est l’histoire d’une déchéance assez lamentable, c’est aussi un examen clinique de la réalité. Ces deux aspects essentiels fondent son réalisme.
Pourtant Madame Bovary recèle des éléments romantiques
Le moi de Flaubert
Flaubert a mis beaucoup de lui-même dans son roman. Malgré un certain parti pris d’impartialité, il a pu aussi s’écrier : « Madame Bovary, c’est moi ! ». Ce cri a été interprété de plusieurs manières. Peut-être faut-il y voir d’abord le désir de Flaubert de couper court à l’enquête sur ces sources, à la part réaliste de son œuvre, en rappelant utilement la part de l’écrivain dans sa création. Flaubert a coulé dans son œuvre ses propres inquiétudes, ses manières de penser, sa matière personnelle. En particulier, comme Emma, il a éprouvé un goût immodéré pour la lecture. Au lycée de Rouen, « les pensums finis, la littérature commençait, et on se crevait les yeux à lire au dortoir des romans. On portait un poignard dans sa poche, comme Antony… Mais quelle haine de toute platitude ! Quels élans vers la grandeur ! ». Le jeune Gustave appelle les orages comme son aîné, René de Chateaubriand. Plus tard, le vice ne l’a pas quitté et, pour écrire Bouvard et Pécuchet, il dévorera plus de mille cinq cents volumes.
Le goût de la rêverie
Au détour d’une page, on le surprend à rêver de la belle manière, ce qu’il appelait son « infini besoin de sensations intenses ». Les lectures d’Emma, fades et niaises, déclenchent parfois en lui le désir de voyager comme l’évocation de « ces sultans à longues pipes, pâmés sous des tonnelles aux bras de bayadères, djiaours, sabres turcs, bonnets grecs… » (Il est parti d’ailleurs pour l’Orient). Il lui faut alors l’aide de l’ironie pour secouer l’esprit qui vagabonde et dénoncer l’invraisemblance et le poncif.
Un goût de la période
Chaque fois que Flaubert se laisse aller à la rêverie, la phrase prend l’ampleur et la cadence de la période romantique. Ainsi, la veille de sa fuite avec Rodolphe, Emma contemple la lune en compagnie de son amant :
- « La lune, toute ronde et couleur de pourpre, se levait à ras de terre, au fond de la prairie. Elle montait vite entre les branches des peupliers, qui la cachaient de place en place, comme un rideau noir, trouvé. Puis elle parut, élégante de blancheur, dans le ciel vide qu’elle éclairait ; et alors, se ralentissant, elle laissa tomber sur la rivière une grande tache, qui faisait une infinité d’étoiles, et cette lueur d’argent semblait s’y tordre jusqu’au fond à la manière d’un serpent sans tête couvert d’écailles lumineuses. Cela ressemblait aussi à quelque monstrueux candélabre, d’où ruisselaient tout au long des gouttes de diamant en fusion. La nuit douce s’étalait autour d’eux ; des nappes d’ombre emplissaient les feuillages ».
- Cet émoi de Flaubert devant un spectacle qui flatte son sens esthétique ne rappelle-t-il pas celui de Chateaubriand savourant la nuit dans les déserts du Nouveau Monde ?
Les émois de la passion
Parfois Flaubert éprouve une secrète délectation dans les plaisirs destructeurs de la passion romantique qu’il entend condamner. Là, point d’ironie qui vient briser le sortilège ! Emma éprouve un tendre attachement pour le jeune clerc Léon Dupuis, elle vient d’accepter son bras, au risque de se compromettre, tandis qu’elle se rend chez la nourrice de sa fille :
- « Ils sentaient une même langueur les envahir tous les deux ; c’était comme un murmure de l’âme, profond, continu […] Surpris d’étonnement à cette suavité nouvelle, ils ne songeaient pas à s’en raconter la sensation ou en découvrir la cause. Les bonheurs futurs, comme les rivages des tropiques, projettent sur l’immensité qui les précède leurs mollesses natales, une brise parfumée, et l’on s’assoupit dans cet enivrement, sans même s’inquiéter de l’horizon qu’on n’aperçoit pas ».
- La passion naissante rejoint curieusement le désir d’évasion dans le voyage, que nous notions tout à l’heure.
La révolte
- C’est ce même le désir d’évasion qui constitue le plus profondément le romantisme d’Emma, bien proche de son créateur lorsque qu’elle éprouve un grand dégoût pour le monde étriqué qui l’entoure. Lors de son mariage avec Charles ne voit-on pas l’opposition irréductible entre son sentimentalisme qui se traduit par le désir d’une cérémonie nocturne aux flambeaux et le matérialisme de son père qui pense seulement à la nourriture et aux plaisirs. Depuis on appelle bovarysme cette volonté d’être plus et mieux, ce désir forcené d’une autre existence plus exaltante. Nous rejoignons là le goût romantique de la révolte, la haine de l’ordre établi. Emma s’échappe sans cesse de ce monde ennuyeux qui l’étouffe. Si le roman est sous-titré « Mœurs de province », c’est que la sévère peinture d’une campagne pitoyable et triste explique en partie le destin de l’héroïne. Flaubert partage le dégoût d’Emma, même s’il s’en défend : « Croyez-vous donc que cette ignoble réalité, dont la reproduction vous dégoûte ne me fasse tout autant qu’à vous sauter le cœur ? Si vous me connaissiez davantage vous sauriez que j’ai la vie ordinaire en exécration. Je m’en suis toujours personnellement écarté autant que j’ai pu », confie-t-il dans sa correspondance. À la différence d’Emma cependant, il ne fuira pas dans un rêve éveillé mais cherchera à sublimer la réalité par le travail artistique. Au sein de cette histoire ordinaire, nous trouvons une fatalité toute romantique, cet échec qui clôt inéluctablement toute tentative d’évasion. Même nous pourrions dire que la semence de destruction est autant en Emma qu’autour d’elle. Flaubert ne l’a fait pas mourir de manière très commune. Après la longue agonie qui suit l’empoisonnement à l’arsenic, il l’a fait entrer toute vive dans un cauchemar sans fin, marquée du sceau de sa propre damnation : « Et Emma se mit à rire, d’un rire atroce, frénétique, désespéré, croyant voir la face hideuse du misérable qui se dressait dans les ténèbres éternelles comme un épouvantement ».
- Force pourtant nous est de reconnaître que ces éléments sont peu nombreux, même si leur caractère exceptionnel donne à l’œuvre une coloration si particulière.
Un réalisme personnel
Le dualisme de Flaubert
- Deux aspects si contrastés réunis chez la même personne pourraient nous étonner, or Flaubert, le premier, connaissait parfaitement l’existence de ses deux tendances fondamentales : « Il y a en moi deux bonshommes distincts, un qui est épris de gueulades, de lyrisme, de grands vols d’aigle […] ; un autre qui creuse et qui fouille dans le vrai tant qu’il peut, qui aime à accuser le petit fait aussi puissamment que le grand, qui voudrait vous faire sentir presque matériellement les choses qu’il reproduit ». A-t-il su dépasser ce dualisme ? Tout d’abord, nous l’avons vu, il l’a au moins admis et lui a donné droit de cité dans son œuvre. L’écrivain est autant celui qui observe le monde que celui qui l’anime.
- « Aujourd’hui, homme et femme tout ensemble, amant et maîtresse à la fois, je me suis promené à cheval, dans ma forêt, par une après-midi d’automne, sous des feuilles jaunes et j’étais les chevaux, les feuilles, le vent, les paroles qu’on se disait… » Quelle imagination ! Lorsqu’il décrit l’agonie d’Emma, il a dans la bouche le goût de l’arsenic : quel pouvoir d’autosuggestion ! Parfois même comme Dieu, après avoir créé et animé son monde, il le juge. Alors la plume grince, le trait est appuyé, l’imagination s’enflamme. La noce d’Emma a sombré dans la ripaille et la beuverie, Flaubert est agacé et, tout d’un coup, nous passons à l’image dantesque, fantastique d’attelages fous : « et toute la nuit, au clair de lune, par les routes du pays, il y eut des carrioles emportées qui courraient au grand galop, bondissant dans les saignées, sautant par-dessus les mètres de cailloux, s’accrochant aux talus, avec des femmes qui se penchaient en dehors de la portière pour saisir les guides ».
Un point de vue nouveau et original
La vision que nous livre Flaubert est donc autant une photographie réaliste qu’une interprétation romantique : c’est là un point de vue nouveau et original. Tout d’abord le romancier nous livre ses personnages au travers de la vision d’autrui, il en résulte un kaléidoscope d’impressions, un jeu de miroirs dans lequel les images fuient, sont renvoyées déformées. Emma par exemple est tantôt la petite paysanne dans laquelle Charles va déceler l’image de son éternel féminin, tantôt la campagnarde que Rodolphe entend séduire par jeu, tantôt la femme sensuelle que Lheureux flatte pour mieux en tirer profit. Ensuite Flaubert amasse les détails justes dont l’accumulation même confine à la caricature. Les objets sont alors habités d’une vie étrange à la manière des symboles. La casquette de Charles est plus qu’une coiffure, c’est l’image du mauvais goût « dont la laideur muette a des profondeurs d’expression comme le visage d’un imbécile », elle traduit à l’avance l’inadaptation de Charles bientôt victime de la cruauté de ses condisciples. Au bal à la Vaubyessard, la jeune provinciale aurait dû être séduite par le luxe, les ors, les lumières, son attention pourtant se concentre sur la galerie des portraits des grands ancêtres pour nous faire sentir le caractère figé, distant voire prétentieux de cette noblesse campagnarde. Le clopinement du pied-bot d’Hippolyte rythme la maladresse et l’échec de Charles. Le livre fourmille de telles notations.
Un réalisme poétique
Nous sommes donc loin d’une représentation photographique de la réalité. Flaubert d’ailleurs sait que le réalisme intégral est une utopie, et il écrivait à Huysmans : « L’art n’est pas la réalité, quoiqu’on fasse, on est obligé de choisir dans les éléments qu’elle fournit ». Il ira encore plus loin, il choisira en fonction d’un effet à produire, ce que nous pourrions appeler le réalisme poétique, bien loin du réalisme tout court. En décembre 1875, il écrivait : « Ceux que je vois souvent, et que vous désignez, recherchent tout ce que je méprise et s’inquiètent médiocrement de ce qui me tourmente. Je regarde comme très secondaire le détail technique, le renseignement local, enfin le côté historique et exact des choses. Je recherche par-dessus tout la beauté dont tous mes compagnons sont médiocrement en quête ». Cette beauté ne se situe pas forcément dans les objets, les scènes ou les paysages décrits, souvent volontairement prosaïques, mais dans la composition, l’agencement qui leur donnent un sens. Ainsi la description de la noce obéit à une loi secrète, celle de la désagrégation : l’émulation joyeuse du début dégénère en ripaille et en rancœurs. La scène des comices peut être lue comme une symphonie où se croisent, en de subtiles variations, les déclarations enflammées de Rodolphe et la trivialité de la fête agricole, deux mondes juxtaposés, étrangers qui se rejoignent pourtant dans leur culte du poncif et du rêve à bon marché.
Un pessimisme fondamental
Ce que Flaubert nous livre en fin de compte est un monde pessimiste. Nous l’avons vu, son roman est l’histoire d’un échec. Madame Bovary se détruit lentement. Tout porte en soi son propre ferment de destruction. Cependant la vérité essentielle du livre, c’est que l’idéalisme n’a pas sa place dans un monde où triomphent les intérêts mesquins et la bêtise. Emma est une victime. Les vrais coupables ne sont pas punis : Rodolphe n’éprouve aucun remords et dort du sommeil du juste, Lheureux n’y a jamais vu qu’une « bonne affaire ». Allons plus loin encore, les coupables sont récompensés, honorés : Lheureux a fait fortune et s’est installé à l’enseigne “les favorites du commerce”, son nouveau magasin ; Homais, parangon de bêtise satisfaite, « vient de recevoir la croix d’honneur ». Le roman se termine sur la vision grinçante de la sottise humaine.
Un travail de styliste
Face à ce monde éprouvant pour une sensibilité d’écorché vif comme celle de Flaubert, nous éprouvons cependant une intense impression d’harmonie, de beauté. C’est que l’artiste a toujours cherché une parfaite appropriation du mot à l’idée à exprimer. Seul le style permet d’échapper à la « triste plaisanterie de l’existence ». Le culte de la beauté permet de recomposer une création mal faite ou tout simplement de s’échapper dans le monde des idées pures. Le romancier doit, nous l’avons vu, choisir en fonction de l’effet à produire, mais de plus, au contraire du pâtissier qui a réalisé la ridicule pièce montée des noces où éclate mauvais goût dans la juxtaposition de styles eux-mêmes composites, élaguer, tendre à la pureté, à l’accord parfait entre le sujet et les mots pour le dire. À cet endroit, plus de romantisme ou de réalisme ; le premier entache la vérité par excès d’imagination ou de subjectivité, le second ne peut atteindre à la beauté car le monde brut est laid. Seul l’art mérite nos efforts. Écoutons la dernière leçon de l’ermite de Croisset (lettre à Louise Colet du 16 janvier 1852) : « Les œuvres les plus belles sont celles où il y a le moins de matière ; plus l’expression se rapproche de la pensée plus le mot colle dessus et disparaît, plus c’est beau […] C’est pour cela qu’il n’y a ni beaux ni vilains sujets et qu’on pourrait presque établir comme axiome, en se posant au point de vue de l’Art pur, qu’il n’y en a aucun, le style étant à lui tout seul une manière absolue de voir les choses ». De là à rêver “d’un livre sur rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par la force interne du style”, voilà des préoccupations plus proches des spéculations mallarméennes que des enquêtes naturalistes de Zola !
Conclusion
Madame Bovary recèle des aspects réalistes et des aspects romantiques comme l’œuvre de Flaubert qui oscille elle-même sans cesse de la grisaille à la couleur, de la terne réalité aux fastes de l’imagination. Il y a loin de l’Éducation sentimentale à Salammbô, de Bouvard et Pécuchet à La Tentation de Saint-Antoine. Mais même lorsque Flaubert entend écrire sur un sujet trivial, il renonce au réalisme pur. Qu’il n’ait pas réussi à exorciser les vieux démons de son adolescence, c’est tant mieux ! Nous avons alors sous les yeux une œuvre originale qui échappe aux règles trop étroites d’une école, d’un mouvement ou tout simplement d’une doctrine. Son roman y gagne en profondeur, en personnalité, en universalité pourrions-nous dire. Flaubert pouvait affirmer : « Ma pauvre Bovary souffre et pleure dans vingt villages de France ! », preuve qu’il ne s’agissait plus de la simple transcription réaliste de l’affaire Delamare. L’auteur des Trois contes se situe exactement à la charnière de son siècle, héritant du mal du siècle romantique, cette difficulté à vivre dans un monde borné, il annonce le spleen baudelairien et l’incapacité à s’accommoder d’une existence qui brime l’idéal. Épurant le romantisme de ses excès, il fonde une certaine impartialité dans le récit, ouvrant la voie au roman moderne fait de critique et d’échec. Accordant une grande importance au style, il sacralise l’Art et laisse présager les magiciens du verbe qui auront nom les symbolistes. Flaubert particulièrement dans Madame Bovary reste donc un solitaire, un artiste indépendant dont l’œuvre agira à la manière d’un ferment littéraire.
Voir aussi :
- Biographie de Flaubert
- Étude d’un personnage : Monsieur Homais dans Madame Bovary
- Flaubert, Madame Bovary, étude d’un texte descriptif
- Madame Bovary, III, 5
- Flaubert, L’Éducation sentimentale, I, 5 et étude du discours rapporté
- L’Éducation sentimentale, III, 6
- Flaubert, Bouvard et Pécuchet, étude du discours rapporté
- Lire des citations de Flaubert sur l’art