Lyrisme
Le lyrisme est l’expression d’une émotion personnelle intense. La poésie lyrique traite des sentiments du poète (les thèmes récurrents sont l’amour, la mort, la nostalgie, la fuite du temps, la communion avec la nature, le destin, le sacré, etc.). Le registre lyrique peut se rencontrer aussi dans les textes en prose.
Les marques du registre lyrique :
- l’emploi de la première personne du singulier ;
- les apostrophes ;
- le vocabulaire des émotions et des sentiments (→ champs lexicaux) ;
- une ponctuation expressive (points d’exclamation, points d’interrogation) ;
- la présence d’adverbes d’intensité ;
- l’emploi de figures de style (comparaisons, métaphores, hyperboles, …) ;
- etc.
Termes liés : l’élégie, le pathétique, le pathos (émouvoir les passions du lecteur).
Quelques textes
Chateaubriand (1768-1848), René (1802)
« Mais comment exprimer cette foule de sensations fugitives que j’éprouvais dans mes promenades ? Les sons que rendent les passions dans le vide d’un cœur solitaire, ressemblent au murmure que les vents et les eaux font entendre dans le silence d’un désert : on en jouit, mais on ne peut les peindre.
« L’automne me surprit au milieu de ces incertitudes : j’entrai avec ravissement dans les mois des tempêtes. Tantôt j’aurais voulu être un de ces guerriers errant au milieu des vents, des nuages et des fantômes ; tantôt j’enviais jusqu’au sort du pâtre1 que je voyais réchauffer ses mains à l’humble feu de broussailles qu’il avait allumé au coin d’un bois. J’écoutais ses chants mélancoliques, qui me rappelaient que dans tout pays, le chant naturel de l’homme est triste, lors même qu’il exprime le bonheur. Notre cœur est un instrument incomplet, une lyre où il manque des cordes, et où nous sommes forcés de rendre les accents de la joie sur le ton consacré aux soupirs.
« Le jour, je m’égarais sur de grandes bruyères terminées par des forêts. Qu’il fallait peu de choses à ma rêverie ! une feuille séchée que le vent chassait devant moi, une cabane dont la fumée s’élevait dans la cime dépouillée des arbres, la mousse qui tremblait au souffle du nord sur le tronc d’un chêne, une roche écartée, un étang désert où le jonc flétri murmurait ! Le clocher solitaire, s’élevant au loin dans la vallée, a souvent attiré mes regards ; souvent j’ai suivi des yeux les oiseaux de passage qui volaient au-dessus de ma tête. Je me figurais les bords ignorés, les climats lointains où ils se rendent ; j’aurais voulu être sur leurs ailes. Un secret instinct me tourmentait ; je sentais que je n’étais moi-même qu’un voyageur ; mais une voix du ciel semblait me dire : “Homme, la saison de ta migration n’est pas encore venue ; attends que le vent de la mort se lève, alors tu déploieras ton vol vers ces régions inconnues que ton cœur demande.”
« “Levez-vous vite, orages désirés, qui devez emporter René dans les espaces d’une autre vie !” Ainsi disant, je marchais à grands pas, le visage enflammé, le vent sifflant dans ma chevelure, ne sentant ni pluie ni frimas2, enchanté, tourmenté, et comme possédé par le démon de mon cœur.1 « Celui qui garde, fait paître le bétail. » (Le Petit Robert)
2 « Brouillard froid et épais qui forme du givre en tombant. » (Dictionnaire de l’Académie)Victor Hugo (1802-1885), Les Contemplations (1856), Livre V, XXIV :
En 1843, Victor Hugo perd sa fille Léopoldine, qui s’est noyée dans la Seine à Villequier.
J’ai cueilli cette fleur pour toi sur la colline.
Dans l’âpre escarpement qui sur le flot s’incline,
Que l’aigle connaît seul et seul peut approcher,
Paisible, elle croissait aux fentes du rocher.
L’ombre baignait les flancs du morne promontoire ;
Je voyais, comme on dresse au lieu d’une victoire
Un grand arc de triomphe éclatant et vermeil,
À l’endroit où s’était englouti le soleil,
La sombre nuit bâtir un porche de nuées.
Des voiles s’enfuyaient, au loin diminuées ;
Quelques toits, s’éclairant au fond d’un entonnoir,
Semblaient craindre de luire et de se laisser voir.
J’ai cueilli cette fleur pour toi, ma bien-aimée.
Elle est pâle, et n’a pas de corolle embaumée,
Sa racine n’a pris sur la crête des monts
Que l’amère senteur des glauques goémons ;
Moi, j’ai dit : Pauvre fleur, du haut de cette cime,
Tu devais t’en aller dans cet immense abîme
Où l’algue et le nuage et les voiles s’en vont.
Va mourir sur un cœur, abîme plus profond.
Fane-toi sur ce sein en qui palpite un monde.
Le ciel, qui te créa pour t’effeuiller dans l’onde,
Te fit pour l’océan, je te donne à l’amour. —
Le vent mêlait les flots ; il ne restait du jour
Qu’une vague lueur, lentement effacée.
Oh ! comme j’étais triste au fond de ma pensée
Tandis que je songeais, et que le gouffre noir
M’entrait dans l’âme avec tous les frissons du soir !→ À relever dans ce poème : les pronoms personnels, les comparaisons et les métaphores), l’expression des sentiments, les verbes, le temps des verbes, le lexique et les adjectifs, le rythme, etc.
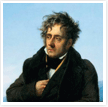 « Mais comment exprimer cette foule de sensations fugitives que j’éprouvais dans mes promenades ? Les sons que rendent les passions dans le vide d’un cœur solitaire, ressemblent au murmure que les vents et les eaux font entendre dans le silence d’un désert : on en jouit, mais on ne peut les peindre.
« Mais comment exprimer cette foule de sensations fugitives que j’éprouvais dans mes promenades ? Les sons que rendent les passions dans le vide d’un cœur solitaire, ressemblent au murmure que les vents et les eaux font entendre dans le silence d’un désert : on en jouit, mais on ne peut les peindre.