L’Argent de Zola (1891)
Le jeu boursier, un mal nécessaire
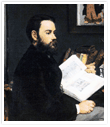 L’Argent est un roman d’Émile Zola publié en 1891. C’est le dix-huitième volume de la série les Rougon-Macquart. Le titre qui évoque une entité comme la Terre ou l’Œuvre fait de cette abstraction le thème principal du récit. Zola y dépeint le capitalisme triomphant en même temps que les prémices financières de l’écroulement final du second Empire. Ce récit n’étudie pas l’argent comme un métal monétaire que l’on thésaurise, contemple et adore. Zola se livre à l’étude des mécanismes spéculatifs. Ce roman aurait pu s’intituler plus justement la Bourse. Pourtant son auteur ne rebute pas le lecteur par des considérations techniques arides. Il a su avec beaucoup d’habileté dramatiser sa fiction inspirée d’événements réels en la transformant en un combat épique.
L’Argent est un roman d’Émile Zola publié en 1891. C’est le dix-huitième volume de la série les Rougon-Macquart. Le titre qui évoque une entité comme la Terre ou l’Œuvre fait de cette abstraction le thème principal du récit. Zola y dépeint le capitalisme triomphant en même temps que les prémices financières de l’écroulement final du second Empire. Ce récit n’étudie pas l’argent comme un métal monétaire que l’on thésaurise, contemple et adore. Zola se livre à l’étude des mécanismes spéculatifs. Ce roman aurait pu s’intituler plus justement la Bourse. Pourtant son auteur ne rebute pas le lecteur par des considérations techniques arides. Il a su avec beaucoup d’habileté dramatiser sa fiction inspirée d’événements réels en la transformant en un combat épique.
- Résumé du roman : grandeur et décadence de la Banque Universelle
- Un roman naturaliste
- Un roman journalistique : Les sources de L’Argent
- Un roman sociologique
- Un roman engagé
- Un roman historique
- Des aspects mélodramatiques
- Un roman utopique
- L’épopée de l’argent moderne
- L’antisémitisme au service de la dramatisation du récit
- Conclusion : un roman actuel ?
Résumé du roman : grandeur et décadence de la Banque Universelle
Les titres donnés aux chapitres sont de notre propre invention.
Chapitre 1 : Autour de la Bourse
Le roman commence dans un restaurant à proximité de la Bourse, institution qui va rythmer tout le récit. En 1864, dans les dernières années du second Empire, Aristide Saccard attend le député Huret qu’il a chargé d’une démarche auprès de son frère, le puissant ministre d’État, Eugène Rougon. Zola a réutilisé1 un des personnages principaux de la Curée. Aristide Saccard avait alors changé de patronyme pour ne pas gêner par ses activités douteuses son frère, homme politique parvenu au faîte du pouvoir. Il avait amassé une fortune considérable dans des opérations immobilières à la suite des grands travaux parisiens du baron Haussmann, avant de la perdre par une succession d’engagements risqués. Toujours animé d’une énergie débordante, et désireux de prendre sa revanche, il a voulu sonder l’attitude du « grand homme » à son égard avant de se lancer dans une nouvelle aventure financière. Le ministre d’État a décidé de lâcher son frère compromettant. En colère, Saccard se rend chez Busch, un inquiétant personnage spécialisé dans le recouvrement de créances douteuses. Il veut voir le frère pour se faire traduire un document. À l’occasion de cette visite, il est reconnu comme celui qui, par le passé, a abusé d’une jeune fille, l’a blessée et mise enceinte, puis a fui sans honorer le dédommagement qu’il avait promis. Revenu sur la place de la Bourse, il reçoit un coup de coude du richissime banquier Gundermann. Cet événement anodin libère sa colère rentrée. Il décide, malgré les obstacles, de mettre en œuvre sans tarder le projet qu’il porte en lui.
Chapitre 2 : Les habitants de l’hôtel d’Orviedo
Il vend sa luxueuse propriété du parc Monceau afin de régler ses créanciers, puis loue deux étages dans l’hôtel particulier de la princesse d’Orviedo, dévote qui veut expier les fautes de son défunt mari. Saccard, qui a cédé autrefois des terrains à la princesse, a montré alors son savoir-faire. Il est devenu à cette occasion l’administrateur bénévole et dévoué de l’Œuvre du Travail, fondation de bienfaisance voulue par la princesse. Le chevalier d’industrie s’y montre d’une honnêteté scrupuleuse « simplement récompensé par cette joie des sommes considérables qui lui pass[ent] entre les mains. » Un moment tenté de devenir le collaborateur de la mystique entêtée, il se voit repoussé dans son offre de services. Le désir obsessionnel de vaincre le banquier Gundermann prend alors corps en lui. Dans l’hôtel d’Orviedo, il fait la connaissance de Georges et Caroline Hamelin, un ingénieur et sa sœur. Ils ont exercé en Égypte et en Orient, mais depuis leur retour à Paris, ils végètent. Pourtant ils ont constitué au cours de leur séjour à l’étranger un portefeuille de projets qui attendent seulement de trouver des capitaux. Les voisins deviennent familiers. Madame Caroline devient la gouvernante du ménage de Saccard. Un soir de tristesse, elle se donne à lui sans amour. S’installera plus tard une liaison peu satisfaisante. Les nouveaux amis rêvent éperdument sut les projets de l’ingénieur. Peu à peu Saccard met au point sa stratégie.
Chapitre 3 : La création de la Banque Universelle
Saccard se lance dans la recherche de ceux qui siégeront au syndicat des premiers gros investisseurs dans le capital de sa banque, ceux qui assureront le succès de l’émission des actions par achat des quatre cinquièmes contre une rétribution privilégiée. Il lui faut trouver ceux qui donneront confiance au monde financier, mais en même temps des personnes peu regardantes sur la régularité des opérations. Il commence par se rendre chez son ennemi Gundermann en connaissant par avance la réponse méprisante du banquier, mais Saccard a besoin de venir défier son adversaire.
Chapitre 4 : Installation de la banque dans l’hôtel d’Orviedo
Saccard a réussi à circonvenir la propriétaire des lieux. En jouant habilement sur les dessous religieux de l’affaire, il a arraché à la pénitente l’autorisation d’implanter les locaux de la banque dans son hôtel. Madame Caroline demeure inquiète sur la légalité de la fondation qui n’a pas souscrit la totalité du capital. Saccard s’enflamme, expose son projet de faire de la Banque Universelle un paravent qui, derrière ses opérations classiques de dépôt et d’escompte, servira à attirer les capitaux et, par la spéculation, à financer les projets industriels de l’ingénieur. Saccard recrute Sabatani comme homme de paille pour couvrir les opérations illégales et surtout Jantrou, un professeur chassé de l’Université, pour créer le tapage journalistique autour de son affaire. Se présente alors sa future clientèle : la noblesse désargentée en la personne de la comtesse de Beauvilliers, les joueurs à tout crin avec la baronne Sandorff, Dejoie qui représente le « petit capitaliste aux économies grattées sou à sou ».
Chapitre 5 : Un premier semestre difficile
Busch est venu rendre visite à Madame Caroline pour lui révéler l’existence de Victor, le fils naturel de Saccard. La jeune femme émue se rend aussitôt à la Cité de Naples, un ensemble de taudis sur lesquels règne la Méchain. Elle conduit l’enfant à l’Œuvre du Travail pour le soustraire à sa misère vicieuse. C’est pour elle l’occasion de plonger dans le passé trouble de Saccard. Ce soin de Victor qui réveille une maternité non épanouie la conduit à devenir la maîtresse du père. Les débuts de la banque sont parsemés d’embûches aussi Saccard doit-il se montrer très prudent. Les préventions de Madame Caroline à son égard tombent. À la fin du printemps 1865, Saccard décide de doubler le capital de la banque pour fournir les crédits nécessaires aux projets d’Hamelin. Mais déjà une partie de la souscription reste dans les coffres de l’Universelle. Ces bonnes nouvelles économiques font monter rapidement le cours de l’action et la fièvre spéculative.
Chapitre 6 : Le coup de Sadowa
Saccard se sert habilement de la presse pour réaliser sa publicité, acheter les adversaires, faire pression sur le pouvoir en place et manipuler l’opinion publique. Tout est conçu pour attirer l’épargne populaire par des gains faciles et rapides. Toute la Bourse joue à la baisse en raison de la guerre où s’affrontent la Prusse, l’Italie et l’empire austro-hongrois. À la suite d’une indiscrétion de Huret qui a surpris une dépêche confidentielle sur le bureau du ministre Rougon, Saccard, qui est seul à savoir que la paix va survenir après la victoire de Sadowa (juillet 1866), joue à la hausse et rachète toutes les actions disponibles pour réaliser une plus-value exceptionnelle. Dans la foulée, il décide d’un nouveau doublement du capital de la banque. L’action stationnaire repart brusquement à la hausse. Saccard continue la politique risquée de détenir illégalement un nombre important de ses propres actions. Il décide en fin d’année de transférer la banque dans des locaux plus vastes rue de Londres pour bâtir le palais de ses rêves. Un soir, Madame Caroline découvre que Saccard la trompe avec la baronne Sandorff.
Chapitre 7 : Une prise de conscience douloureuse
Cette trahison réveille les préventions de la jeune femme qui sont confirmées par les confidences de Maxime sur son père, un soir où Madame Caroline n’en peut plus de tristesse. Saccard « s’était vendu lui-même, et il la vendrait elle aussi, il vendrait son frère, battrait monnaie avec leurs cœurs et leurs cerveaux. » Décidée à s’enfuir, elle reste cependant pour servir les généreux projets de son frère, ayant compris que l’argent corrupteur est source de progrès.
Chapitre 8 : L’emballement programmé de la machine financière
Au printemps de 1868, au début de l’Exposition universelle qui consacre le succès de l’Empire, Saccard inaugure les nouveaux locaux somptueux de l’Universelle. Le luxe tapageur du nouveau bâtiment succède au recueillement monacal de l’hôtel d’Orviedo. À l’été, Saccard veut encore une augmentation du capital et entend financer une partie du prix de l’action sur les dividendes à attendre, « dans le surchauffement mensonger de toute la machine, au milieu des souscriptions fictives, des actions gardées par la société pour faire croire au versement intégral, sous la poussée que le jeu déterminait à la Bourse, où chaque augmentation du capital exagérait la hausse ! ». Saccard se laisse griser par son succès au point de perdre tout discernement quant à la fragilité de l’édifice. Il achète les administrateurs, suscite des débats truqués, communique sa ferveur aux personnes les plus hésitantes : les dames de Beauvilliers, Dejoie… Il emporte l’adhésion des Hamelin réticents et soupçonneux. Étourdi par son pouvoir tout neuf, il déclare ouvertement la guerre à son frère, le ministre, et à Gundermann.
Chapitre 9 : Premiers nuages
Un clan de baissiers avec à sa tête Gundermann estime que l’action est surévaluée. Il vend par petites quantités sans que la montée de l’action ne faiblisse. Sur l’instigation de Jantrou, la baronne Sandorff est allée proposer au banquier juif de le renseigner sur Saccard. Huret a trahi lui aussi en se réconciliant avec le frère ministre et en vendant ses actions. Delcambre, le rival malheureux dans la possession de la baronne Sandorff, a été nommé ministre de la Justice. Les premiers nuages s’amoncellent. En cette fin d’année 1868, l’action dépasse les 3000 francs. Saccard se sent menacé néanmoins par les baissiers et sursaute quand Madame Caroline lui avoue qu’elle a vendu, désireuse de stabiliser l’action à sa valeur réelle.
Chapitre 10 : Austerlitz et Waterloo
Le directeur de l’Universelle est obligé d’acheter ses propres actions pour soutenir le cours. La dernière séance de l’année promet une belle bataille. Longtemps indécise, elle tourne en faveur de Saccard. Par une habile manœuvre d’achats à la Bourse de Lyon qui se répercute à Paris, le stratège Aristide met ses ennemis en déroute. Au début de 1869 le marché revient à plus de réalisme et commence à crever la bulle spéculative. Saccard voit inexorablement la valeur de l’action s’éroder. À force de vouloir acheter ses actions pour soutenir le cours, il se voit dépossédé de toute trésorerie. Gundermann qui peut s’appuyer sur d’importants fonds propres est en train de le laminer. Saccard en est réduit à escompter des papiers de complaisance à l’étranger. La baronne Sandorff qui a fouillé ses affaires va révéler en vain ce secret à Gundermann alors que le banquier juif doute pour la première fois. La défaite de Saccard est désormais inéluctable. Après sa victoire d’Austerlitz, Saccard va connaître son Waterloo à cause de la défection de son allié Daigremont.
Chapitre 11 : Le grand craquement
Toujours combatif, Saccard va être perdu par son frère Rougon qui voit en lui une bonne occasion de donner des gages à une opposition libérale anticatholique, par Gundermann qui accepte de souscrire à un emprunt d’État sous réserve que le marché soit assaini, et par le ministre de la Justice Delcambre qui veut assouvir sa vengeance de rival éconduit. Sur une plainte de Busch pour escroquerie, Saccard et Hamelin sont arrêtés, l’Universelle est mise en faillite. Les petits porteurs sont ruinés. La baronne Sandorff se donne à Jantrou dans l’espoir d’échapper à la catastrophe financière. Pendant ce temps ce sont des faillites en cascade, puis le suicide de l’agent de change Mazeaud. La crise secoue toute la place de Paris.
Chapitre 12 : Le solde des comptes
Tandis que le procès de l’Universelle tarde à se lancer, les désastres se poursuivent, plus intimes cependant. Les dames de Beauvilliers sont obligées de se retirer dans une pension pour faire face à leurs énormes dettes. Victor, le fils naturel marqué par l’hérédité paternelle, viole la fille à l’Œuvre et s’enfuit de l’institution. Ces événements conduisent Madame Caroline à accuser Saccard de tous les maux alors même que les victimes continuent à conserver leur confiance et leur estime au directeur de l’Universelle. Le grand homme n’a été abattu que par un complot pensent-elles. Puis, sous l’influence de son frère, elle accepte de revoir Saccard une dernière fois. Les deux amants se séparent définitivement, toute colère apaisée, après que Madame Caroline reprend conscience de sa force de vivre au contact de l’énergie entêtée et grandiose d’Aristide. À la fin de 1869, Saccard passe enfin en correctionnelle, bataille héroïquement devant le tribunal et se voit condamné à cinq ans de prison. Pendant les délais d’appel, sur l’instigation de son frère qui craint pour sa propre popularité, il quitte la France et se rend en Hollande ; il s’y consacre à une affaire colossale : l’assèchement d’immenses marais.
Un roman naturaliste
Les Rougon-Macquart sont sous-titrés « Histoire naturelle et sociale d’une famille sous le second Empire ». C’est que Zola entend bien peindre une fresque sociale servant non seulement de toile de fond aux aventures romanesques de ses personnages, mais plus encore de conditionnement sociologique à leur existence. Pour l’écrivain naturaliste, le héros romanesque est façonné par son hérédité et l’Histoire, particulièrement par la société de son temps.
Ici, Zola prétend moins que dans d’autres récits devenir un romancier du futur en soumettant ses personnages à des expériences destinées à mettre en lumière le dynamisme des comportements déterminés par l’hérédité et le milieu. Seul, Victor semble répondre à cette emprise génétique. Il est défini comme une « bête écumant du virus héréditaire ». En revanche l’empreinte sociologique reste forte et l’on peut dire que, dans sa volonté d’étudier la société du second Empire, Zola réalise une véritable sociologie de l’argent.
Un roman journalistique : Les sources de L’Argent
Ce roman a sans doute beaucoup coûté à Zola parce que le sujet lui était peu familier. Si le lecteur curieux parcourt les premières listes de 1870 constituant l’architecture de la saga des Rougon-Macquart, il s’étonnera de ne trouver aucune mention de l’Argent. Pourtant les aspects financiers étaient déjà bien présents dans la Curée par exemple. Mais, dans ce roman, la focalisation portait moins sur le désir effréné de richesse monétaire ou les spéculations foncières que sur la pourriture d’un monde sans foi ni loi. Zola a pris conscience peu à peu qu’il devait écrire cette enquête sur l’argent moderne, une des causes principales de la chute du régime impérial honni. Par ailleurs l’observateur naturaliste connaissait bien les deux ressorts de l’âme humaine soulignés dans ses Notes : « II n’y a que l’amour et l’argent ». La seconde forme essentielle du désir, surtout dans ses aspects contemporains du pouvoir des énormes sommes mystérieusement brassées loin du public, n’avait jamais été réellement et méthodiquement abordée.
Il convient de noter que la jeune IIIe République est traversée par quelques scandales financiers retentissants dont le Bel-Ami de Maupassant paru cinq ans plutôt s’était déjà fait l’écho lui aussi. L’affaire de la « dette tunisienne » devenue marocaine sous la plume de Maupassant n’est pas sans rappeler le coup fourré de Sadowa dans l’Argent. Au moment où Zola écrit son roman le scandale de Panama bat son plein. Rappelons que Ferdinand de Lesseps, pour subventionner un projet mal évalué au départ, a massivement fait appel aux capitaux des petits épargnants (le fameux « bas de laine »), en recourant à des hommes d’affaires qui soutiennent la publicité de l’investissement en achetant largement des journaux peu consciencieux. C’est cette stratégie payante que reprend d’ailleurs Saccard.
Zola est démuni face aux questions financières, au droit des sociétés, aux cotations boursières. Il n’a même pas de compte bancaire. Son éditeur, Fasquelle, lui avance au fur et à mesure l’argent dont il a besoin. Il va donc constituer un dossier de plus de mille pages pour combler ses connaissances lacunaires avouées à demi-mot, à deux reprises, dans le premier chapitre du roman : « ce mystère des opérations financières où peu de cervelles françaises pénètrent » ; « ce mystère des opérations financières, d’autant plus attirant pour les cervelles françaises que très peu d’entre elles les pénètrent ». Zola a donc consulté plusieurs ouvrages pour s’initier à cette religion de la finance. Il a lu les Mémoires d’un coulissier de Feydeau, l’ouvrage de Mirecourt sur La Bourse et celui d’Aycard sur Le Crédit mobilier. Il bénéficie des leçons de son éditeur, qui a pratiqué le métier d’agent de change avant de se lancer dans la librairie. Il s’est surtout beaucoup inspiré du krach de l’Union générale survenu en janvier 1882. Le polytechnicien Bontoux avait repris en 1878 cette banque qui avait connu des difficultés. Par une gestion audacieuse, il avait fait grimper la valeur de l’action jusqu’à des hauteurs insoupçonnées, enrichissant tout un petit peuple d’actionnaires. C’est que Bontoux avait eu la lumineuse idée de drainer l’épargne religieuse vers sa banque catholique. Pourtant au début de 1882, ce fut l’effondrement du cours, l’action perdant les neuf dixièmes de sa valeur. Poursuivi pour escroquerie, le banquier se réfugia en Espagne d’où il rédigea, pour sa défense, une apologie qui parut en librairie en 1888. Zola a de plus étudié dans les numéros du Droit les comptes rendus d’audience du procès Bontoux qui s’acheva sur la condamnation de l’intéressé à cinq ans de prison en 1883. L’opinion française est alors travaillée par l’ouvrage antisémite de Drumond, la France Juive. Bontoux, lui aussi, invoque un complot des Juifs et des francs-maçons pour expliquer la déroute de son œuvre bien-pensante et, de fait, lui et ses actionnaires avaient bien été ruinés en partie par la spéculation des Rothschild2. Ces accusations vont d’ailleurs resservir à l’occasion du scandale de Panama, permettant à plusieurs personnalités d’échapper à la vindicte populaire. Elles contribueront à faire enfler notablement le ressentiment antisémite à l’occasion de l’Affaire Dreyfus. Elles sont bien présentes dans le roman de Zola.
Plus anecdotique, la scène scabreuse qui oppose Saccard à Delcambre à propos de l’entretien de la baronne Sandorff tire son origine d’un fait divers de l’époque : Edwige Sapia fut bien l’objet d’une empoignade de mauvais garçons entre deux notabilités, le banquier Jules Mirès (condamné à cinq ans de prison en 1861 pour la faillite de la Caisse générale des chemins de fer) et Gustave Louis Chaix d’Est-Ange, avocat et homme politique français.
Le personnage de Saccard a plusieurs origines : d’abord le père de Zola, trop tôt disparu lors des sept ans d’Émile. Le fils a gardé de lui le souvenir ébloui d’un entrepreneur moderne, hardi, engagé dans le progrès social3. Zola a également été marqué par le spéculateur et industriel Hector de Sastres4, qui fut l’ami et le protégé du ministre Jacques Louis Randon. Bien sûr, Saccard a hérité aussi de quelques caractéristiques de Paul Eugène Bontoux. Zola a donné à Saccard la confiance en soi, l’optimisme chevillé au corps, l’esprit visionnaire, le sens des opportunités économiques de ces personnalités. Notons également que quelques traits de Bontoux et du père ont été attribuées à Hamelin, l’ingénieur brillant, appliqué, utopiste.
Zola a donc réuni plus de mille pages de notes pour rédiger son roman. Il s’est livré à une étude du dossier comme un journaliste moderne. Si ses confrères se sont parfois montrés très critiques à l’égard de ces compilations laborieuses qui, selon eux, cachaient un manque d’inspiration ou d’audace créatrice, il nous faut bien reconnaître que Zola se présente comme un écrivain moderne, scrupuleux, appliquant à la fiction romanesque les méthodes du journalisme d’investigation.
Un roman sociologique
L’Argent aborde le thème de la Bourse, de la spéculation qui s’y déroule et des scandales qui en découlent. C’est aussi le roman de la décadence financière de la deuxième puissance économique de l’époque ainsi que du régime politique qui la dirigeait.
L’Argent aborde trois domaines financiers :
La banque
Zola décrit un système économique en partie « intermédié » dans lequel les banques jouent un rôle intermédiaire de collecteur de fonds entre les agents à besoin de financement et les agents à capacité de financement. La banque se justifie par la transformation des dépôts de court terme de sa clientèle en prêts à moyen et à long terme mais au prix de risques importants de liquidité, de taux de rémunération… qui la fragilisent. Les capitaux sont alors enserrés dans une économie d’endettement. Les premiers mois de l’Universelle relèvent de cette étape. Le nouvel établissement développe ces fonctions classiques, elle sert un habituel cinq pour cent aux actionnaires.
Le bâtiment est la façade honorable qui dissimule les complots des financiers. Les locaux sont une publicité vivante destinée à faire perdre toute raison au client, une invitation permanente à rêver, une imprégnation des esprits par la richesse des ors, la brillance et la solidité des marbres, la profusion des guichets et des services. Rien n’est donc trop beau ou trop clinquant pour Saccard qui veut très vite quitter l’austérité initiale de l’hôtel d’Orviedo pour le palace de la rue de Londres. Notre homme croit infiniment dans les signes extérieurs de richesse pour donner confiance.
En effet, derrière ce décor de théâtre, se joue la véritable pièce. En coulisse, quelques initiés définissent la stratégie et manipulent le conseil d’administration. Hommes de paille, administrateurs somnolents dont le sommeil est acheté par des primes spéciales, comparses véreux derrière une apparence honorable s’engraissent sur l’affaire tant qu’elle a du crédit mais s’empressent de quitter la barque dès les premières secousses.
La Bourse
La Bourse de valeurs manifeste le passage à une économie « désintermédiée ». Elle permet la rencontre entre les épargnants et les demandeurs de capitaux sur le marché financier. Les entreprises et l’État y émettent des titres financiers, ces obligations qui révulsent Saccard par leurs gains sûrs mais médiocres. Dans le système décrit par Zola, les banques continuent cependant de jouer un rôle essentiel. Quelques individus fortunés comme la baronne Sandorff ou Daigremont interviennent directement sur le marché par les agents de change ou les remisiers. Seul l’ancien militaire Chave semble participer en tant que petit boursicoteur pour réaliser des opérations réduites avec une extrême prudence. Tous les autres passent par la banque. Il est vrai que pour eux la Bourse reste un monde mystérieux.
La Bourse décrite par Zola correspond à un état historique de marché à la « criée » (système de cotation par enchères) dirigé par les ordres d’achat et de vente. Un tel système ne permet pas la fixation des cours en continu. C’est pourquoi il faut procéder à des liquidations journalières où les cours sont arrêtés. Les acteurs profitent des fluctuations entre elles pour réaliser des gains. L’organisation financière d’alors est fragile en raison du manque d’une autorité de tutelle chargée de la protection de l’épargne, du contrôle des opérations financières et de l’information donnée au public, ce qui explique en partie l’ampleur de la crise qu’elle va connaître.
Au travers de quelques personnages à la psychologie sommaire, Zola nous présente tout le petit monde qui gravite autour du marché des valeurs. Voilà d’abord les agents de change chargés de négocier les ordres de leurs clients. Ces acteurs sont propriétaires de leur charge. Ils sont responsables sur leurs fonds personnels du paiement des transactions négociées en Bourse pour le compte des donneurs d’ordre. En pratique ils n’exigent pas le paiement des sommes engagées au jour le jour par leurs mandataires, mais proposent le règlement à terme5 pour solder les comptes résultant des achats et des ventes. Ils se rémunèrent à la commission. Certains agissent en outre pour leur propre compte sur leurs fonds propres. Deux attitudes s’affrontent : les « haussiers » à l’optimisme indestructible, croyant à un progrès indéfini ; les « baissiers » au pessimisme inhibiteur dans l’attente de catastrophes inéluctables. Dans tous les cas, seuls réussissent les perspicaces capables d’anticiper les retournements de tendance.
Les courtiers emploient de nombreux commis, les remisiers6, chargés de porter les ordres à la corbeille. Ces jeunes employés mènent grand train. La plupart, dépourvus de biens propres, utilisent les sommes engagées par les clients pour réaliser des plus-values grâce au laps de temps écoulé entre l’ordre et son paiement effectif. Tous ces jeunes employés espionnent à qui mieux mieux pour dérober l’information gagnante.
Il y a aussi quelques marginaux interlopes, ces intermédiaires véreux qui permettent aux banquiers ou aux donneurs d’ordre peu scrupuleux de réaliser des opérations illégales en sous-main. Il en va ainsi de Sabatani, ce croisement d’Italien et de juif levantin dont la réputation sulfureuse7 est soulignée par le patronyme qui mélange sabbat et Satan.
Ce monde de la finance se partage entre le petit nombre des prudents à la vie familiale quasi irréprochable, et les flambeurs majoritaires. Ces derniers s’épuisent dans une vie mondaine factice où il faut, pour afficher son succès, paraître au bras des actrices à la mode ou accéder secrètement aux alcôves des têtes titrées.
Le récit aborde donc les rapports qui existent entre l’argent et la libido.
C’est ainsi que Jantrou utilise par avance un des ressorts de la publicité moderne, la stimulation du rêve par les images impudiques du corps féminin : « il courut même une plaisanterie, on raconta qu’il avait fait tatouer ces mots : Achetez de l’Universelle, aux petits coins les plus secrets et les plus délicats des dames aimables ».
Le désir féminin se manifeste dans l’admiration pour les gagnants, la soumission au vainqueur ou plus sordidement dans la vénalité des relations. Les Chuchu, Germaine Cœur et autres théâtreuses parasites sont accomplies dans le personnage anecdotique de Madame de Jeumont, celle qui avait tarifé autrefois sa nuit d’amour avec l’empereur à cent mille francs, celle que Saccard s’offre pour deux cent mille francs afin d’afficher sa victoire financière et son pouvoir tout neuf sur Paris. Seule, Madame Comin, la gentille papetière, se refuse au parvenu et fait bien la différence entre argent et plaisir physique. Pourtant la femme la plus étrange reste la baronne Sandorff, cette nymphomane dont le désir s’est mué en passion du jeu jusqu’à la rendre frigide.
Le désir masculin s’exprime chez les joueurs par le besoin d’étaler la réussite, de proclamer la volonté de puissance en piquant l’envie des concurrents. Il faudrait pourtant aller plus loin dans l’analyse. Zola oppose deux comportements. Gundermann est un ascète, un bourreau de travail, il consacre toute son énergie à la gestion de ses biens. Les femmes n’ont plus de place dans sa vie. Tout y est soumis à l’autorité d’une froide logique qu’aucun désir ne vient distraire. À l’opposé, Saccard est impulsif, jouisseur. L’argent est censé lui apporter les plaisirs : nourriture, boisson et surtout la possession des corps féminins désirables. Saccard est resté vert pour son âge. Il en tire fierté. Il mesure l’efficacité de ses efforts à l’aune de ses bonnes fortunes. L’exercice de sa génitalité est le baromètre de son énergie virile, de sa capacité à entreprendre. En fait c’est la même énergie qui est employée dans la bataille financière et dans l’amour. « Il vivait […] dans un tel désir, dans une telle anxiété du succès, que ses autres appétits allaient en rester comme diminués et paralysés, tant qu’il ne se sentirait pas triomphant, maître indiscuté de la fortune. » C’est une des raisons pour lesquelles Saccard sera défait : il a dissipé son énergie vitale, il s’est laissé distraire quand son adversaire n’a cessé de rester concentré sur la bataille.
Le recouvrement des dettes et le contentieux
Busch est cet odieux personnage chargé des basses œuvres. Son métier, nous dit Zola, est de vivre de la misère d’autrui. Son bureau est une caverne d’Ali-baba remplie de titres dépréciés, de créances douteuses, de reconnaissances de dettes rachetés à vil prix et valorisés par un long, minutieux travail de recherche des individus. Cet emploi consiste à quadriller Paris par un réseau d’informateurs, à analyser des dossiers, à amasser des informations puis, lorsque le gibier a été retrouvé, d’attendre le moment propice, celui d’une émergence à la lumière, pour fondre sur lui, le faire chanter, l’intimider et lui arracher des sommes exorbitantes. Busch et son aide la Méchain appartiennent à la race des charognards.
Un roman engagé
Zola s’est attaché à évoquer deux systèmes économiques :
- le capitalisme
- le communisme marxiste. Cette conception d’un nouvel ordre social est incarnée par le doux rêveur Sigismond Busch, frère du terrible recouvreur de créances. Disciple de Marx, il théorise ce besoin de justice en imaginant une redistribution du capital en faveur des plus démunis.
Zola évoque trois âges de la propriété :
- les origines avec le troc, l’échange de services. C’est l’ère archaïque.
- la création de la monnaie qui banalise les échanges, permet de normaliser les valeurs et culmine avec la propriété foncière, c’est l’ère rurale dominée par la puissance nobiliaire dont la révolution industrielle vient de sonner le glas. La comtesse de Beauvilliers le reconnaît naïvement : « je m’imaginais que la terre seule, la grande propriété devait nourrir des gens tels que nous… » Saccard lui répond en lui assénant de manière condescendante son credo d’entrepreneur moderne : « Mais, madame, personne ne vit plus de la terre… L’ancienne fortune domaniale est une forme caduque de la richesse, qui a cessé d’avoir sa raison d’être. Elle était la stagnation même de l’argent, dont nous avons décuplé la valeur, en le jetant dans la circulation, et par le papier-monnaie, et par les titres de toutes sortes, commerciaux et financiers. C’est ainsi que le monde va être renouvelé, car rien n’était possible sans l’argent, l’argent liquide qui coule, qui pénètre partout, ni les applications de la science, ni la paix finale, universelle… Oh ! la fortune domaniale ! elle est allée rejoindre les pataches. On meurt avec un million de terres, on vit avec le quart de ce capital placé dans de bonnes affaires, à quinze, vingt et même trente pour cent. » Ces propos trahissent la revanche caustique de la bourgeoisie sur l’aristocratie. Zola note aussi le risque qu’encourt la monnaie en perdant le contact avec la réalité terrienne. L’argent perd sa consistance solide pour devenir liquide, il peut ainsi irriguer tous les secteurs de l’économie au risque de s’évaporer…
- l’époque moderne avec la dématérialisation partielle de la masse monétaire. La Bourse est l’outil moderne de l’ère industrielle, elle autorise une meilleure mise en circulation de l’argent. La Bourse permet aux entrepreneurs de trouver des fonds pour leurs projets. L’argent se coupe du réel. Il y a le risque mortel de la spéculation financière, du jeu (l’argent produit l’argent, il n’est plus le produit du travail). S’il aliène la classe ouvrière, il démocratise la fortune par une certaine aisance des classes moyennes. L’argent est en outre destructeur du lien social et de l’homme.
Un roman historique
Zola irrigue son roman sur l’argent moderne par une politique de grands travaux et d’entreprises financières à l’image de ce qu’a réalisé le second Empire. Napoléon III avait fait décoller l’économie par la constitution accélérée d’un réseau ferroviaire, par une augmentation des surfaces agricoles, par la création d’établissements bancaires comme le Crédit mobilier des frères Pereire dont la réussite paraissait envoûtante et par la faveur accordée aux rentiers et aux boursiers. De même Zola lance Saccard sur les projets grandioses d’Hamelin et met la Banque Universelle au service d’un système de transports apte à donner la prospérité par la circulation des biens et des personnes. Lorsque, abattu par ses imprudences, ce même Saccard doit s’exiler en Hollande, ce sera pour se lancer dans des travaux gigantesques de poldérisation. Toujours ces rêves grandioses d’aménagement du territoire, ces modernes travaux d’Hercule !
Saccard est chargé d’illustrer la fièvre spéculative qui a parcouru le second Empire. Le roman aurait pu s’appeler « Grandeur et décadence financière de l’Empire français ». Comme les historiens du temps, Zola voit dans la ruine de la France de Napoléon III des causes morales ; « Saccard […] ramenait aux difficultés de sa situation personnelle cette crise où l’empire semblait entrer. Lui, une fois encore, était par terre est-ce que cet empire, qui l’avait fait, allait comme lui culbuter, croulant tout d’un coup de la destinée la plus haute à la plus misérable ? Ah ! depuis douze ans, qu’il l’avait aimé et défendu, ce régime où il s’était senti vivre, pousser, se gorger de sève, ainsi que l’arbre dont les racines plongent dans le terreau qui lui convient. Mais, si son frère voulait l’en arracher, si on le retranchait de ceux qui épuisaient le sol gras des jouissances, que tout fût donc emporté, dans la grande débâcle finale des nuits de fête ! »
La prospérité du début du règne a été engloutie par des campagnes hasardeuses comme celle du Mexique, par l’aveuglement en politique étrangère sur le travail de sape du chancelier Bismarck, par le manque de courage, les atermoiements impériaux à l’égard du voisin prussien, mais surtout en raison de la dissipation des fonds publics dans des dépenses de prestige à la gloire du régime comme l’Exposition universelle de 1867. Zola note aussi les progrès du socialisme qui ont conduit l’empereur à libéraliser son régime. La crise financière a également des causes politiques, elle a été alimentée par la perte de confiance dans l’autorité et la clairvoyance de l’empereur. Tout culmine, avant la Débâcle, avec le désastre de Sedan. Si Zola a avancé de 1882 à 1869 la déroute bancaire qui lui a servi de modèle, c’est bien pour marquer l’interpénétration des Histoires financière et politique. Ainsi l’ascension et la chute de la Banque Universelle sont-elles les conséquences des velléités et de l’aveuglement comme de l’affairisme et de la corruption de l’Empire avant d’en être le symbole éclatant. Zola souligne à plusieurs reprises le retour cyclique de ces crises tous les dix ou quinze ans. Mais celle-là présente un caractère exemplaire de gravité dans ses causes et ses conséquences : « cette fois, derrière cette fumée rousse de l’horizon, dans les lointains troubles de la ville, il y avait comme un grand craquement sourd, la fin prochaine d’un monde. »
Zola expose aussi dans son roman ses thèses sur les relations de l’argent et de l’écrivain. Déjà dans « L’Argent dans la littérature » (Le Messager de l’Europe, mars 1880 ; Le Voltaire, juillet 1880) il s’était livré à une sociologie de la littérature, il avait noté que les écrivains du passé avaient dû obéir aux volontés des puissants et s’étaient réfugiés dans de stériles querelles de métier dans les salons. En revanche les auteurs contemporains, qui vivaient honnêtement de leur plume pouvaient se montrer indépendants à l’égard du pouvoir politique et choisir librement leurs sujets. Zola s’est souvenu de ses difficultés du début. Il s’est peint dans le petit Jordan, personnage idéaliste, travailleur, journaliste et homme de lettres qui ne se laisse pas corrompre et cherche sans cesse à placer ses œuvres pour faire vivre son ménage.
Des aspects mélodramatiques
Le récit est parcouru d’aspects mélodramatiques hérités du roman-feuilleton : les complots souterrains, le fils naturel inconnu, les retournements brutaux de situation. Le passé de Saccard recèle quelques ignominies qui vont refaire surface : une jeune fille violée dans des circonstances rocambolesques, un fils naturel à l’existence bestiale retrouvé grâce à un concours de circonstances invraisemblable.
Le lecteur est aussi happé par le misérabilisme outrancier de la Cité de Naples, le cloaque infernal de ceux qui n’ont rien, « les hommes, les femmes, les enfants, en tas, se pourrissant les uns les autres », tous ces êtres « livrés, dès la petite enfance, à l’instinctive luxure de la plus monstrueuse promiscuité ». Zola dénonce le grand scandale de la misère par la plongée dans cette zone de marginalité honteusement exploitée par la Méchain qui annonce les marchands de sommeil modernes.
On peut relever également la lente plongée des dames de Beauvilliers, ce destin qui s’acharne sur l’innocence et la naïveté. Ces femmes sont doublement victimes de Saccard qui les vole et de son fils Victor qui les viole.
Cette vision outrée est particulièrement perceptible dans la manière de considérer l’argent. Zola part d’une représentation traditionnelle de moraliste pessimiste. Il rapproche brutalement les deux fils de Saccard pour dénoncer les illusions de la fortune. L’argent est d’abord cette monnaie qui permet le luxe et la paresse chez Maxime, l’oisif décadent. C’est un vernis qui cache mal la bête qui sommeille en chacun d’entre nous. « N’était-ce pas la réponse à cette question de savoir si l’argent n’est point l’éducation, la santé, l’intelligence ? Puisque la même boue humaine reste dessous, toute la civilisation se réduit-elle à cette supériorité de sentir bon et de bien vivre ? »
L’argent est ensuite destructeur du lien social. Les Maugendre se coupent de leur fille à cause de leur passion du jeu qui révèle leur manque de générosité. La fille Dejoie, saisie par le démon du jeu, abandonne son père qui a tant sacrifié pour elle. « Ah ! l’argent, cet argent pourrisseur, empoisonneur, qui desséchait les âmes, en chassait la bonté, la tendresse, l’amour des autres ! Lui seul était le grand coupable, l’entremetteur de toutes les cruautés et de toutes les saletés humaines. »
La baronne Sandorff perd peu à peu conscience de son rang dans une chute dégradante, jusqu’à accepter servilement les perversions amoureuses de Saccard, puis à s’abandonner au peu reluisant Jantrou, jadis serviteur de la famille. « Il y a, dans la passion du jeu, un ferment désorganisateur que j’ai observé souvent, qui ronge et pourrit tout, qui fait de la créature de race la mieux élevée et la plus fière une loque humaine, le déchet balayé au ruisseau… »
On peut enfin remarquer le recours au pathétique de morts extraordinaires. Le lecteur est frappé par deux tableaux atroces : celui où l’épouse de Mazeaud, entourée de ses trois jeunes enfants, ne peut se détacher du cadavre de son mari qui vient de se suicider. Zola construit également avec beaucoup de soin, selon les canons de l’image pieuse, l’agonie de Sigismond. Le jeune penseur meurt de la phtisie (la maladie romantique par excellence), dans le dénuement, tout en se livrant à des déclarations enflammées sur l’avènement de « la cité de justice et de bonheur ». Zola y rajoute l’antithèse entre le renoncement exalté du penseur socialiste et le mercantilisme du frère dont la souffrance colérique anéantit stupidement le travail de toute une vie. Décidément l’argent n’aime pas la culture désintéressée.
Un roman utopique
Le récit s’évade à plusieurs reprises de ce monde mesquin, cruel et sordide par des ouvertures sur un avenir plus radieux.
Zola met dans la bouche d’Aristide des propos enthousiastes concernant la force des cartels dont la constitution au XIXe siècle crée les premiers empires financiers. Les ententes qui évoluent en fusion sont une première étape de la prise de pouvoir économique. Saccard et Hamelin vont la mettre en pratique avec la Compagnie générale des Paquebots réunis pour jeter les bases de leur puissance financière. Jusque-là Zola s’inspire de la réalité économique de son temps. Plus étonnante est la suite qui généralise le principe dans une vision prophétique annonçant la globalisation tant redoutée actuellement. « Les syndicats, murmura Saccard, l’avenir semble être là, aujourd’hui… C’est une forme si puissante de l’association ! Trois ou quatre petites entreprises, qui végètent isolément, deviennent d’une vitalité et d’une prospérité irrésistibles, si elles se réunissent… Oui, demain est aux gros capitaux, aux efforts centralisés des grandes masses. Toute l’industrie, tout le commerce finiront par n’être qu’un immense bazar unique, où l’on s’approvisionnera de tout. »
Il verse même dans l’utopie du mirage oriental lorsque l’argent associé au progrès technique fait refleurir le désert, bouscule les immobilismes et ranime la splendeur des Mille et une Nuits. Zola, à sa manière pacifique, réécrit l’épopée égyptienne de Napoléon Ier. Au début du roman, Hamelin, qui fait miroiter la mise en valeur des ressources inemployées du Carmel, annonce solennellement « la civilisation victorieuse ». L’ingénieur rêve également de libéraliser le brutal empire Ottoman par le progrès économique. On reconnaît là des bribes de l’idéal saint simonien8. Madame Caroline « voudrait des foules heureuses, des chantiers, des villes naissantes, un peuple régénéré par le travail. » À plusieurs reprises, Zola entonne ce messianisme économique, encense cette vertu civilisatrice du capitalisme associé à la révolution industrielle. Il prête à Madame Caroline une « voix lente de dormeuse éveillée » lorsqu’elle évoque la magie de l’Orient, et fait dire à Saccard : « Mais c’est un pays de cocagne ». L’Orient est lié au merveilleux des contes de fée. Madame Caroline y voit la Belle au bois dormant. Elle se passionne à « l’idée du coup de baguette tout-puissant dont la science et la spéculation pou[rr]aient frapper cette vieille terre endormie, pour la réveiller. »
Les théories socialistes sont, elles aussi, exprimées sous la forme d’un rêve : « Imaginez une société où les instruments de la production sont la propriété de tous, où tout le monde travaille selon son intelligence et sa vigueur, et où les produits de cette coopération sociale sont distribués à chacun, au prorata de son effort. Rien n’est plus simple, n’est-ce pas ? une production commune dans les usines, les chantiers et les ateliers de la nation ; puis, un échange, un paiement en nature. […] Plus de concurrence, plus de capital privé, donc plus d’affaires d’aucune sorte, ni commerce, ni marchés, ni Bourses. L’idée de gain n’a plus aucun sens. » Ce que Sigismond imagine est la fin de l’argent, la mort de la monnaie, la régression vers le troc. Il appelle cette renaissance d’une pureté antérieure hypothétique lorsque l’enrichissement n’avait pas encore corrompu le cœur de l’homme. Ce rêve passéiste étonne Saccard. Zola considère le risque de voir disparaître la source des initiatives économiques, le salaire des efforts, la récompense des entrepreneurs. Sigismond en est bien conscient : « Certainement, l’état social actuel a dû sa prospérité séculaire au principe individualiste, que l’émulation, l’intérêt personnel rend d’une fécondité de production sans cesse renouvelée. Le collectivisme arrivera-t-il jamais à cette fécondité, et par quel moyen activer la fonction productive du travailleur, quand l’idée de gain sera détruite ? Là est, pour moi, le doute, l’angoisse, le terrain faible où il faut que nous nous battions, si nous voulons que la victoire du socialisme s’y décide un jour… Mais nous vaincrons, parce que nous sommes la justice. » Zola profite du délire de Sigismond, lors de son agonie, pour évoquer cette civilisation des loisirs9 promise par le progrès : « Grâce au grand nombre des bras nouveaux, grâce surtout aux machines, on ne travaillera que quatre heures, trois peut-être ; et que de temps on aura pour jouir de la vie ! car ce n’est pas une caserne, c’est une cité de liberté et de gaieté, où chacun reste libre de son plaisir, avec tout le temps de satisfaire ses légitimes appétits, la joie d’aimer, d’être fort, d’être beau, d’être intelligent, de prendre sa part de l’inépuisable nature. » Le rêve s’achève sur la vision d’un paradis terrestre : « Ah ! cité bienheureuse, cité triomphale vers qui les hommes marchent depuis tant de siècles, cité dont les murs blancs resplendissent, là-bas… Là-bas, dans le bonheur, dans l’aveuglant soleil…10 » Finalement l’idéologie socialiste qui ne tient pas compte de la réalité humaine est un acte de foi, elle repose sur une espérance, ce qui en fait une nouvelle religion dont Zola se méfie en raison de son caractère contre nature. Il semble bien que Zola n’accepte pas « cet avenir de bonheur général et moyen », cet égalitarisme qui nivellerait les mérites.
L’Œuvre du Travail de la princesse d’Orviedo participe de cette rêverie utopique. Là il s’agit du projet religieux un peu fou d’immerger de jeunes gens exclus dans un univers luxueux et sain afin de les corriger de leurs vices et de leur donner un métier. La démesure voulue, l’absence d’avenir pour l’établissement, le gaspillage des fonds sont non seulement le contrepoint de l’entreprise de Saccard, mais encore une caricature de ces institutions religieuses qui, au nom d’une philanthropie mal comprise, manquent d’esprit pratique. Ce gaspillage éhonté, ces équité et charité correctrices irrationnelles choquent Zola quand elles contreviennent à la simple justice. En définitive, la princesse d’Orviedo, dans son entêtement mystique, rejoint son intendant. La défiance maladive à l’égard de l’argent est aussi coupable que l’avidité. En tout cas elles conduisent au même résultat : un désastre retentissant annoncé.
L’utopie la plus étonnante est la translation de la papauté à Jérusalem. Ce projet politique et religieux surprend sous la plume de l’agnostique Zola. Ses origines sont multiples. Elles s’inscrivent d’abord dans les difficultés d’alors lorsque l’émergence du nationalisme italien a contesté le pouvoir temporel de l’Église et la présence d’un État « étranger » sur le sol de Rome11. Ces relations conflictuelles font tache d’huile auprès des catholiques, notamment en France, ce que Zola note à plusieurs reprises dans le récit. Elles culminent dans l’annexion de Rome le 2 octobre 1870, qui met fin à l’existence millénaire des États du pape. Zola a sans doute voulu rendre compte aussi des agissements de son modèle, Bontoux, qui avait reçu l’aide du cardinal Jacobini12, secrétaire du pape Léon XIII, et de nombreux évêques français. Le directeur de l’Union Générale avait recueilli indirectement les encouragements du souverain pontife lui-même qui souhaitait que le catholicisme se dotât de banques pour aider financièrement l’Église quasiment exsangue. Zola dénonce aussi à demi-mots l’absence de scrupule chez Saccard : ce dernier se laisse emporter habilement par cette idéologie syncrétique pour travestir l’opportunité de drainer l’épargne catholique. Mais il reste quand même à justifier le choix de Jérusalem dont il était improbable que la Grande Porte pût accepter de se dessaisir dans la mesure où la ville figurait parmi les trois cités saintes du monde musulman sunnite. Zola a-t-il voulu évoquer un messianisme apocalyptique confondant les Jérusalem céleste et terrestre ou les gloses ésotériques sur la prophétie de Malachie circulant dans certains milieux catholiques ? Si tel a été le cas, est-ce pour rendre compte du courant de pensée en bon journaliste ? ou pour le discréditer comme « imaginations extravagantes » ? Une autre supposition pourrait être l’antisémitisme de certains cercles bien-pensants qui rêvaient de remplacer définitivement le judaïsme obsolète13 par « l’ère nouvelle, l’ère triomphale du catholicisme ». Cette hypothèse concorderait bien avec la lutte à mort engagée par Saccard contre la grande banque juive internationale. Aristide, inspiré de Bontoux, devait-il être le champion de la finance catholique nationaliste désireuse de s’émanciper de la tutelle juive des Hottinguer, des Neuflize et surtout des Rothschild pour ensuite la supplanter ?
L’épopée de l’argent moderne
Le récit prend aussi très vite des aspects épiques avec ce combat permanent entre la vie et la mort que Zola souligne fréquemment et sur lequel d’ailleurs il clôt son roman. Cet élargissement aux forces cosmiques à l’œuvre dans le monde est d’ailleurs habituel chez notre auteur.
Une part essentielle du ressort dramatique réside dans l’affrontement entre Saccard et Gundermann. C’est le jeu, la passion et le désir contre la logique, l’ascèse et le sang-froid. Gundermann l’emporte car il est un être désincarné, ayant échappé au vertige du jeu pour se cantonner dans la foi en la raison. Gundermann pratique l’approche fondamentaliste qui considère qu’une action a une valeur intrinsèque à laquelle elle doit revenir immanquablement. Si cette valeur d’équilibre est fixée subjectivement à deux mille francs par le banquier juif, tout son plan de bataille est fondé sur la logique de vendre sur le moyen terme pour produire, par effet sur les cours, des pertes chez les agioteurs. Gundermann ne semble plus appartenir à l’espèce humaine dans son vertigineux pouvoir sur l’argent et le monde, dans son détachement des plaisirs terrestres.
On peut relever d’autres caractères épiques secondaires.
La Bourse
Comme souvent chez Zola, un objet ou une construction prend un relief inhabituel jusqu’à devenir un protagoniste du drame. Cette transformation en symbole est produite par l’animation de l’inanimé au moyen d’une série de métaphores. La Bourse, à la fois bâtiment et institution, relève d’un tel traitement jusqu’à devenir une présence obsessionnelle dès le premier chapitre.
La Bourse apparaît d’abord comme un théâtre où chacun tient un rôle précis. C’est surtout le lieu des tragédies. Zola décrit le « derrière du monument, comme l’envers d’un théâtre, l’entrée des artistes ». Il faut dire que le lieu nécessite des comédiens, des initiés, une possibilité de s’échapper discrètement. Le romancier note également l’interface avec une rue louche, celle de Notre-Dame des Victoires. Si le côté ouvert au public est imposant, majestueux, la face opposée révèle la collusion avec les trafiquants.
L’institution caractérisée par les vociférations de la corbeille est souvent comparée à la mer. Ainsi « la voix haute de la Bourse, […] déferlait avec l’entêtement du flux à son retour. » Ce bruit continu rappelle le ressac : « la clameur du jeu venait battre les trottoirs grouillant de monde, avec la violence débridée d’une marée haute. » La Bourse est aussi le réceptacle des courants humains convergents. Les quatre carrefours qui marquent ses angles déversent un « fleuve » de voitures.
Elle est aussi assimilée par la vie agitée de ses sessions à une énorme chaudière, symbole des temps modernes industriels : « La trépidation, le grondement de machine sous vapeur, grandissait, agitait la Bourse entière, dans un vacillement de flamme. »
Elle est aussi « la noire fourmilière du jeu » par son intense activité, ses aspects mécaniques et dérisoires, un lieu caché où tout un peuple se sacrifie, perd son individualité. Les joueurs donnent l’impression de servir inlassablement une reine. Dans la Bourse l’homme devient un insecte insignifiant qui s’agite en vain et se précipite vers sa fin.
La métaphore la plus constante est celle du temple. Le premier chapitre nous décrit en quelque sorte le téménos, l’enceinte sacrée qu’Aristide parcourt avant de l’investir, le péristyle qui abrite le commerce. La corbeille plus tard peut être vue comme le lieu du sacrifice sanglant à un dieu dévorateur.
La dernière métaphore sera celle du champ de bataille qui verra s’affronter deux armées dans un corps à corps meurtrier renvoyant à la « boucherie héroïque » de Candide ou aux évocations épiques hugoliennes.
Pour renforcer son aspect de lieu initiatique, La Bourse est organisée en cercles concentriques :
- Le premier cercle est celui de la petite Bourse des affaires déclassées, appelée aussi les « Pieds humides » : C’est une espèce de Cour des miracles où, exposée aux intempéries, à l’extérieur du bâtiment, une troupe hideuse de juifs se dispute les cadavres de sociétés mortes. Ces brocanteurs financiers « agiotent encore, des actions de cinq cents francs qu’ils se disputent à vingt sous, à dix sous, dans le vague espoir d’un relèvement improbable, ou plus pratiquement comme une marchandise scélérate, qu’ils cèdent avec bénéfice aux banquiers désireux de gonfler leur passif. » L’usurier juif traditionnel est devenu chez Zola, avec le personnage de Busch, l’ancêtre des officines de recouvrement contentieux.
- Le second est celui de la coulisse : « Terme de bourse. Petit parquet14, non reconnu par la loi, où des courtiers, non autorisés, mais, en dépit d’efforts contraires, consacrés par l’usage et la coutume, font l’office d’agents de change ; on ne s’y occupe que des rentes et à peu près exclusivement du 3%. La coulisse est une succursale du parquet pour les affaires exclusivement dites de jeu.
Réunion de courtiers marrons (c’est-à-dire non institués par la loi) ne faisant que des opérations à terme, ne levant ni ne livrant jamais de rentes, mais compensant avec le parquet, et faisant des marchés non escomptables, et des primes dans des conditions de temps tout autres qu’au parquet (du jour au lendemain, par exemple). » Littré
La coulisse se caractérise donc par son statut hors-la-loi, par ses liens avec le jeu spéculatif, par son action souterraine. Massias, un de ses représentants, reconnaît qu’elle aussi est dominée par les juifs, seuls capables d’y réussir comme Nathansohn. - Le troisième est celui des courtiers.
- Le quatrième est celui « du côté de la rue Notre-Dame-des-Victoires, le côté de la spéculation riche, qui affectait de se désintéresser des petits bruits du jour. »
- Le cinquième est le parquet avec en son centre « la corbeille, [qui] était le lieu sacré interdit au public ».
Saccard, un Napoléon de l’affairisme
Un autre élément qui confère au récit un caractère épique est la métaphore qui parcourt tout le récit et fait de Saccard un avatar du mythe napoléonien.
Comme le « petit Corse », Aristide a le teint bistre, il est de petite taille. Comme lui, animé d’une énergie farouche, il est parvenu pauvre à Paris. Méprisé, il désire ardemment se faire un nom et, comme son aîné en littérature, Rastignac, une autre figure emblématique du mythe napoléonien, il est parti à la conquête de la capitale. Comme le jeune consul, il est habité de projets grandioses, il exerce un magnétisme certain sur ceux qui l’entourent, il sait galvaniser ses troupes avec « sa parole ardente qui transformait une affaire d’argent en un conte de poète. » Il a lui-même le pouvoir phénoménal de s’autosuggestionner « de se griser de son propre enthousiasme, d’arriver à la foi par son désir brûlant de réussir ».
Pour qualifier les aventures boursières du Méridional, Zola utilise souvent la métaphore de la conquête guerrière. Dès le début du roman, Saccard fait « le siège du monument », l’enserre « d’un cercle étroit, pour y rentrer un jour en triomphateur ». Passé derrière le bâtiment, l’aventurier le scrute avec « le regard aigu d’un chef d’armée examinant sous toutes ses faces la place dont il veut tenter l’assaut ». L’exploration terminée, il décide de livrer « une bataille de terrible audace, qui lui mettrait Paris sous les talons ».
Le Napoléon de l’expédition d’Égypte est bien le modèle de l’homme d’affaires. Saccard s’est enfiévré à la lecture qui relate la campagne égyptienne du consul. Non seulement il y voit le génie conquérant à l’œuvre, mais il y perçoit aussi une quête mystique, « un but grandiose et mystérieux. » Saccard transforme son vulgaire désir d’enrichissement, il lui donne des lettres de noblesse en l’élevant jusqu’à la grandeur épique dans un savant mélange de rationalité moderne et de mystique surannée. « Et ce que les Croisades avaient tenté, ce que Napoléon n’avait pu accomplir, c’était cette pensée gigantesque de la conquête de l’Orient qui enflammait Saccard, mais une conquête raisonnée, réalisée par la double force de la science et de l’argent. Puisque la civilisation était allée de l’est en l’ouest, pourquoi donc ne reviendrait-elle pas vers l’est, retournant au premier jardin de l’humanité, à cet Éden de la presqu’île hindoustanique, qui dormait dans la fatigue des siècles ? Ce serait une nouvelle jeunesse, il galvanisait le paradis terrestre, le refaisait habitable par la vapeur et l’électricité, replaçait l’Asie Mineure comme centre du vieux monde, comme point de croisement des grands chemins naturels qui relient les continents. Ce n’étaient plus des millions à gagner, mais des milliards et des milliards. »
Dès le début, Saccard, en véritable héros antique, est soumis au destin. Avant même que son épopée boursière ait commencé, il croise, aux portes du palais Brongniart, la Méchain, oiseau de mauvais augure. Elle apparaît également le soir même où la maison de crédit est fondée officiellement. L’aigle rencontre l’oiseau charognard : « Dans les batailles meurtrières de la finance, la Méchain était le corbeau qui suivait les armées en marche ; pas une compagnie, pas une grande maison de crédit ne se fondait, sans qu’elle apparût, avec son sac, sans qu’elle flairât l’air, attendant les cadavres, même aux heures prospères des émissions triomphantes ; car elle savait bien que la déroute était fatale, que le jour du massacre viendrait, où il y aurait des morts à manger, des titres à ramasser pour rien dans la boue et dans le sang. » Ainsi est signifié, dès le commencement du récit, moins la marque tragique du héros que celle de la défaite inéluctable des joueurs.
Son désir de puissance et d’enrichissement va se concrétiser dans la lutte titanesque avec Gundermann. Sa conquête du pouvoir est rêvée comme l’épopée napoléonienne : « il avait l’autre joie, la lutte des gros chiffres, les fortunes lancées comme des corps d’armée, les chocs des millions adverses, avec les déroutes, avec les victoires, qui le grisaient ». Saccard se voit comme le héros national dressé contre la coalition étrangère.
La fin d’année 1868 voit lors de la liquidation le combat entre les troupes de Gundermann et le seul Saccard qui les défie. Tout évoque la mémorable bataille d’Austerlitz : le mois de décembre, le placement anticipé des troupes (ici les ordres d’achat donnés à la Bourse de Lyon) pour prendre à revers les baissiers de Paris, le soleil qui éclaire cette froide journée, la disproportion des forces en présence, la bataille longtemps indécise dans des corps à corps frénétiques. « Ce fut sa grande journée, celle dont on parle encore, comme on parle d’Austerlitz et de Marengo. »
Un mois plus tard, Saccard va connaître Waterloo. « Saccard, radieux, certain de vaincre, s’arrêta sur-le-champ le plan de la bataille, tout un mouvement tournant d’une rare hardiesse, emprunté aux plus illustres capitaines d’abord, au début de la Bourse, une simple escarmouche pour attirer les baissiers et leur donner confiance ; puis, quand ils auraient obtenu un premier succès, quand les cours baisseraient, l’arrivée de Daigremont et de ses amis avec leur grosse artillerie, tous ces millions inattendus, débouchant d’un pli de terrain, prenant les baissiers en queue et les culbutant. Ce serait un écrasement, un massacre. » Mais Daigremont va se comporter comme Grouchy en ne se présentant pas au rendez-vous de l’Histoire. Il trahit son chef. « Comme à Waterloo, Grouchy n’arrivait pas, et c’était la trahison qui achevait la déroute. »
Pour finir le récit, Saccard doit comme son prestigieux modèle s’exiler mais avec l’espoir de revenir prendre la tête d’un peuple à sa dévotion pour combattre la coalition étrangère et l’ennemi de l’intérieur. La foi en son génie reste intacte.
Signification possible des patronymes
Le choix des patronymes des protagonistes contribue au caractère épique du récit par leurs connotations appuyées.
Aristide Saccard est impulsif et colérique15, ce que peut évoquer le patronyme qu’il s’est choisi. Sac signifie au figuré et familièrement l’estomac, le ventre auquel a été ajouté le suffixe péjoratif -ard. Aristide Saccard ne manquerait donc pas d’aplomb, mais il serait aussi le personnage cupide16, le sac d’écus bien rempli ou l’estomac insatiable.
Zola en donne une explication à l’humour cocasse : « C’était lors de ces débuts difficiles qu’il avait changé son nom de Rougon contre celui de Saccard, en transformant simplement le nom de cette première femme, qui se nommait Sicardot. » En effet après la mort de sa première femme qui lui avait apporté une dot de dix mille francs, il s’est remarié par l’entremise de sa sœur avec Renée Béraud du Châtel, riche héritière à qui il a volé discrètement son argent et ses biens. Le personnage a épousé ces femmes pour leur dot. Une fois l’épouse morte, il aura donc tout pris jusqu’au nom néanmoins amputé de la fortune qu’il a conservée.
Saccard est donc ce sac qui veut à tout prix se remplir, ce personnage avide, « guettant la fortune, inassouvi, torturé d’une faim de jouissance telle, que jamais il n’en avait souffert davantage. » Le lecteur a tout de suite compris que le personnage n’attend pas la fortune d’une vie laborieuse, patiente et monotone, mais bien d’un coup de dés audacieux : « Il n’y avait que le jeu, le jeu qui, du soir au lendemain, donne d’un coup le bien- être, le luxe, la vie large, la vie tout entière. »
« Gundermann. Ils ne pouvaient s’entendre, l’un passionné et jouisseur, l’autre sobre et d’une froide logique. » Gundermann est un nom à consonance germanique. Il renvoie à l’ennemi héréditaire qui menace sur les frontières de l’Est.
Saccard attire par la chaleur de sa vie débridée alors que Gundermann repousse par sa rationalité et son sens de l’ordre implacables. Saccard représenterait ainsi les forces et faiblesses du héros national ; Gundermann, la puissance inhumaine de l’ennemi. Peut-on aller jusqu’à voir dans l’Argent, comme dans Cyrano de Bergerac de Rostand, une tentative plus ou moins consciente de surmonter l’affront cuisant pour l’orgueil national de la défaite de 1870 ? Il est quand même surprenant de considérer les efforts déployés par Zola pour rendre son personnage sympathique malgré ses « brigandages ». Le lecteur peut noter en particulier une certaine générosité de la part d’Aristide, là où Gundermann se montre odieux. La scène où la baronne Sandorff va retrouver le banquier juif pour obtenir, comme Judas, le prix de sa trahison est très éclairante ; elle n’obtient que des paroles cinglantes et misogynes : « Ne jouez pas, ne jouez jamais. Ça vous rendra laide, c’est très vilain, une femme qui joue. » Gundermann est tout entier dans ce rigorisme froid comme la mort.
L’antisémitisme au service de la dramatisation du récit
Tout le roman baigne dans une forme de violence exercée à l’encontre des juifs. Ce mépris qui confine à la haine contribue à dramatiser le récit. Ce combat inexpiable entre deux puissances financières : la banque nationaliste et catholique opposée au pouvoir juif international, constitue l’essentiel de cette épopée moderne de l’argent. Zola a donc recouru à une peinture appuyée de l’antisémitisme ambiant, sans que l’on puisse déterminer s’il se borne à relayer la xénophobie française d’alors ou s’il souscrit pour une part aux critiques d’inspiration nationaliste qui rejettent l’ennemi intérieur.
Zola utilise les poncifs à la mode pour identifier le juif suspect. Le banquier Kolb, fondeur d’or, est décrit comme « un homme petit, très brun, dont le nez en bec d’aigle, sortant d’une grande barbe, décelait l’origine juive ». La petite bourse des valeurs déclassées présente la même iconographie. « Il y avait là, en un groupe tumultueux, toute une juiverie malpropre, de grasses faces luisantes, des profils desséchés d’oiseaux voraces, une extraordinaire réunion de nez typiques, rapprochés les uns des autres, ainsi que sur une proie, s’acharnant au milieu de cris gutturaux, et comme près de se dévorer entre eux. »
Plus loin on relève ce trait fielleux : « On m’a dit que Nathansohn était entré à la coulisse. – Un garçon très gentil, […] et qui mérite de réussir. […] Mais il arrivera, lui, car il est juif. » Compte tenu du caractère illégal de la coulisse, Zola suggère, par la voix de ses personnages, que l’activité traditionnelle des juifs est le maniement occulte, voire douteux de fonds spéculatifs privés.
La pratique traditionnelle de l’usure a évolué vers des formes plus modernes de participation à la vie économique. Busch synthétise tout ce que l’époque imagine des juifs : « Mais, outre l’usure et tout un commerce caché sur les bijoux et les pierres précieuses, il s’occupait particulièrement de l’achat des créances ». Busch s’est en effet lancé dans une entreprise de rapacité qui tient du détective privé, du chantage, de la spéculation sur les erreurs et les secrets honteux. L’usure s’est épanouie en recouvrement des dettes. Busch est devenu l’œil scrutateur, l’espion des dessous de la vie économique. C’est un avatar naturaliste du Vautrin de Balzac, l’audace, la révolte en moins, la patience, la crasse et la paperasse en plus.
Le personnage le plus exécré est Gundermann, le richissime banquier, roi de Paris et du monde. Pour ce personnage, Zola s’est inspiré de quelques traits du banquier James de Rothschild. Il lui a donné son goût pour les antiquités, son rôle de patriarche dans la tribu familiale, la rigueur, l’obstination, la froideur calculatrice et la haine du jeu qui ont permis au fondateur de la branche parisienne de venir à bout de ses concurrents Péreire, Mirès, Philippart et Bontoux perdus par une spéculation osée et une absence de fonds propres.
Saccard se répand contre lui dans une diatribe inspirée des arguments de Drumond dans sa France juive17 (réédition populaire de 1888) : l’accusation d’usure, le complot universel, la volonté de puissance hégémonique, le parasitisme, le refus du travail manuel, le sens aigu des affaires, une religion qui enseigne l’exploitation d’autrui… Le rejet est viscéral, atavique : « Ah ! le juif ! il avait contre le juif l’antique rancune de race, qu’on trouve surtout dans le midi de la France ; et c’était comme une révolte de sa chair même, une répulsion de peau qui, à l’idée du moindre contact, l’emplissait de dégoût et de violence, en dehors de tout raisonnement, sans qu’il pût se vaincre. […] Il dressait le réquisitoire contre la race, cette race maudite qui n’a plus de patrie, plus de prince, qui vit en parasite chez les nations, feignant de reconnaître les lois, mais en réalité n’obéissant qu’à son Dieu de vol, de sang et de colère ; et il la montrait remplissant partout la mission de féroce conquête que ce Dieu lui a donnée, s’établissant chez chaque peuple, comme l’araignée au centre de sa toile, pour guetter sa proie, sucer le sang de tous, s’engraisser de la vie des autres. […] Et il prophétisait avec emportement la conquête finale de tous les peuples par les juifs, quand ils auront accaparé la fortune totale du globe, ce qui ne tarderait pas, puisqu’on leur laissait chaque jour étendre librement leur royauté, et qu’on pouvait déjà voir, dans Paris, un Gundermann régner sur un trône plus solide et plus respecté que celui de l’empereur. » Bien entendu, Zola n’est pas dupe de la fausse naïveté qu’il prête à son personnage. Le brigand financier s’exonère aisément de ses fautes sur le compte d’un croquemitaine. À la vérité, Saccard envie le génie financier de son adversaire et lui reconnaît une force dont il est lui-même dépourvu.
Le lecteur ne peut que s’interroger sur ces propos. Nous savons que lors de l’affaire Dreyfus, notre auteur s’est rangé derrière l’officier juif injustement accusé. L’antisémitisme est-il seulement pour Zola un effet de style romanesque ou l’extériorisation de peurs inconscientes ? Lui sert-il à se concilier le public pour le succès de son livre ? Seule Caroline Hamelin exprime timidement une fois l’idée que les juifs sont des gens comme les autres. C’est peu pour contrebalancer les nombreuses invectives de Saccard.
Conclusion : un roman actuel ?
Ce roman qui a un peu plus d’un siècle peut encore nous intéresser et nous séduire aujourd’hui.
En cette matière aride, écrite par un homme qui s’était infligé un pensum, accumulant les notes sur son sujet, le lecteur est surpris par la qualité didactique du propos et surtout par la vie foisonnante de ce monde romanesque. À la suite des personnages, il parcourt les lieux publics, les salons bourgeois, les alcôves et les taudis. Ces êtres de papier sont bien individualisés malgré leur psychologie sommaire ou utilitaire. La trame du récit reste attractive même si certains événements sont attendus. Il faut reconnaître beaucoup d’habileté au romancier.
Ce qui séduit le plus est l’épaisseur humaine des deux personnages principaux : Saccard et Madame Caroline. Zola connaît alors la crise de la cinquantaine. Il doute de lui, vit un regain de vitalité amoureuse qu’il prête au toujours vert Aristide. En 1888, il est tombé amoureux de Jeanne Rozerot, une jeune lingère de 21 ans, entrée à son service à Médan. Émile a conçu pour elle une passion d’autant plus dévorante que la jeune femme lui a donné deux enfants alors que son union avec sa femme Alexandrine était restée stérile. Madame Caroline hérite donc de la jeunesse et de la vitalité de Jeanne en même temps que de la fécondité rêvée d’Émile et d’Alexandrine. Le personnage réconcilie symboliquement par avance l’existence cruellement divisée du romancier. En tout cas, il donne au roman un éclairage bienveillant et doux qui tranche sur la cruauté d’ensemble.
Le thème principal du récit est lui aussi encore actuel. Même si le monde économique et financier décrit par Zola a pu vieillir, même si le romancier porte sur lui un regard incomplet ou frustrant dans ses hésitations, le lecteur est touché par la chronique de cette crise financière, ne serait-ce que par les éléments mélodramatiques habilement disposés dans l’intrigue. Bien entendu il peut y trouver une préfiguration du gigantesque craquement qui a terrorisé le monde en ce début du XXIe siècle. Qu’on en juge : le nom de la banque Universelle n’est-il pas déjà les premières traces du capitalisme international, de la mondialisation ? Est évoquée également la théorie du complot de la part d’une ploutocratie supranationale. Zola y présente aussi les esquisses des systèmes libéral et socialiste, rêve d’un monde sans argent, réfléchit aux risques de la financiarisation de l’économie, à la collusion entre l’argent et le pouvoir, aux dérives d’un système insuffisamment contrôlé, au désastre qui menace les petits épargnants, à la perte de confiance préjudiciable pour l’économie, à la nécessité de fluidifier les flux de capitaux, à la solidarité des nations, au rôle interventionniste de l’État, au progrès par le développement… Sur cet ensemble il porte plus un regard de poète que d’économiste par ses propos vibrant d’indignation ou d’enthousiasme. Les leçons pragmatiques qu’il en retire sont encore aujourd’hui de quelque utilité : ne pas s’enflammer, ne pas mettre toutes ses économies dans le même panier, rechercher des placements éthiques, ne pas privilégier le seul gain…
Pourtant le roman touche surtout par les désastres humains d’une économie incontrôlée. Cette méditation sur l’argent trompeur et destructeur mérite d’être approfondie. Zola dénonce les illusions faciles du bonheur par le gain, le romancier besogneux s’étonne du divorce entre certaines rémunérations et le travail accompli, il recherche sur quelles valeurs fonder la moralisation de l’argent. Il arrive presqu’au cœur de la question quand il perçoit que la trilogie avoir-pouvoir-savoir s’est substituée à l’être. Comment l’argent qui asservit l’homme pourrait-il devenir une force de libération ?
Alors que le récit a été organisé pour que s’effondrent dans une fosse commune toutes les victimes, Zola fait ressortir en contrepoint l’extraordinaire vitalité de la femme-mère.
La fin du roman au printemps de 1870 nous livre une explication de poète visionnaire. Après l’hiver et la mort apparente de la nature, la vie reprend ses droits. Madame Caroline est prise dans cette résurgence des énergies vitales. « L’espoir ressuscitait de nouveau, brisé, ensanglanté, mais vivace quand même, plus large de minute en minute. La vie telle qu’elle est, dans sa force, si abominable qu’elle soit, avec son éternel espoir ! »
La position de Zola à l’égard de l’argent se dessine peu à peu : c’est un mal nécessaire qui permet le progrès par le développement économique. C’est le fumier qui permet la floraison des entreprises. Madame Caroline18 « eut la brusque conviction que l’argent était le fumier dans lequel poussait cette humanité de demain. Des phrases de Saccard lui revenaient, des lambeaux de théories sur la spéculation. Elle se rappelait cette idée que, sans la spéculation, il n’y aurait pas de grandes entreprises vivantes et fécondes, pas plus qu’il n’y aurait d’enfants, sans la luxure. Il faut cet excès de la passion, toute cette vie bassement dépensée et perdue, à la continuation même de la vie. » Et encore « L’argent, empoisonneur et destructeur, devenait le ferment de toute végétation sociale, servait de terreau nécessaire aux grands travaux dont l’exécution rapprocherait les peuples et pacifierait la terre. »
Le credo zolien est alors curieusement identifié à l’amour, il eût mieux valu dire le désir.
« Pourquoi donc faire porter à l’argent la peine des saletés et des crimes dont il est la cause ? L’amour est-il moins souillé, lui qui crée la vie ? »
Ce n’est pas l’argent qui est mauvais, mais le cœur de l’homme habité par un désir de vivre puissant et désordonné. Cette fin met au premier plan la toujours jeune Caroline Hamelin qui mêle inextricablement dans ses pensées, le désastre de l’Universelle et sa relation amoureuse subie avec Aristide. Ce coup de projecteur est significatif. Zola a, tout au long de ce récit sur l’argent, opposé l’homme et la femme, la paternité et la maternité. L’argent est une aventure sexuée. À l’homme, il appartient d’appliquer son énergie désordonnée, son désir génésique puissant à la transformation du monde et à sa domestication au risque de tuer la nature. Il se trouve que le fruit de ses accouplements peut être vicié, ignoré, rejeté. L’homme ne considère que sa réussite, son plaisir, son accomplissement personnel. Caroline, la femme qui n’a pu être mère, accomplit sa vocation en protégeant les faibles, en tentant de corriger les brutalités d’Aristide. Elle accomplit un ministère de miséricorde par le pardon et la compassion auprès des fils délaissés ou des victimes abandonnées dont elle se sent responsable par amour. Zola, qui vient d’avoir le bonheur d’être père, laisse le dernier mot à la mère rayonnante, à la femme source de vie et d’espoir : après les turpitudes de l’argent, la foi irraisonnée en un avenir meilleur. On croirait entendre par avance Aragon : « la femme est l’avenir de l’homme ».
Notes
1 À la manière de Balzac, dans la Comédie humaine. ↑
2 Bontoux a surtout été victime de ses imprudences et malversations. ↑
3 Le père, François Zola, officier subalterne italien, s’est fait connaître à Aix-en-Provence par des travaux hydrauliques, la construction d’un canal et d’un barrage qui portent son nom. ↑
4 Hector de Sastres, né en 1846, s’est affranchi très tôt des préjugés nobiliaires familiaux qui interdisaient de se livrer à des activités industrielles ou commerciales. Il fait fortune dans l’industrie textile. Il profite de l’emballement des affaires sous le second Empire. Il devient l’ami et le protégé du ministre Jacques Louis Randon au point de devenir le principal fournisseur des armées françaises lors de la campagne mexicaine de Napoléon III. Il se constitue un empire financier en se diversifiant dans l’industrie minière, les aciéries, les chemins de fer, les journaux. Il s’appuie sur la presse pour influencer les hommes politiques. Il meurt en 1916, après avoir été un industriel majeur lors du Premier conflit mondial. ↑
5 Selon un système très voisin de notre SRD (Service de Règlement Différé) actuel. ↑
6 « Dans la langue de la bourse, tout commis d’agent de change qui apporte des affaires à la charge et reçoit une remise sur le courtage exigé du client ; la remise varie suivant l’importance du remisier, soit 1/16, le courtage étant de 1/8 pour la plupart des opérations. Avant la guerre, les relations entre notre place [Francfort] et Paris étaient si nombreuses, qu’il s’était établi des remisiers qui prenaient des ordres pour les agents de Paris et les transmettaient le matin par le télégraphe… aussitôt après la paix, ces remisiers ont repris leurs affaires, mais leurs dépêches n’arrivent pas pour la Bourse, ou bien la réponse ne vient que le lendemain, et l’arbitrage entre les deux places en souffre, Extrait de la Semaine financière du 30 sept. 1871, p. 461, 2e col. » Littré ↑
7 D’ailleurs Zola, obsédé par la sexualité, dote sa créature d’organes prodigieux sur lesquels il revient à plusieurs reprises. Le prête-nom est un voyou avenant qui excite les attentions curieuses de la bonne société. ↑
8 Rappelons que Prosper Enfantin, un ingénieur, a propagé la pensée saint-simonienne qui a conduit à de nombreuses réalisations pratiques. Afin de trouver les fonds nécessaires au financement de projets industriels, les frères Péreire créent le Crédit mobilier. D’autres saint-simoniens constituent la Compagnie générale transatlantique, mettent en œuvre le percement du canal de Suez et construisent des infrastructures ferroviaires — Enfantin fonde notamment la Compagnie de la ligne de Lyon. Ces entrepreneurs veulent également améliorer les conditions de vie de la population ouvrière. C’est finalement tout le programme d’Hamelin qui s’émerveille de voir des villes s’épanouir dans le désert autour des lieux de production et qui est certain que les stations de sa future ligne de chemin de fer feront naître des agglomérations. ↑
9 Ce thème a agité le débat économique à la fin des Trente Glorieuses. On peut relever également le démenti de notre temps qui, en organisant à la fin des années 1990 une réduction forcée du temps de travail pour mieux le partager, a finalement appauvri les revenus des ouvriers les privant de la jouissance de ces loisirs. ↑
10 Cette vision pourrait rappeler la dystopie de La Cité du soleil de Tommaso Campanella (1623). ↑
11 Il faut attendre les accords du Latran signés en 1929 par le pape Pie XI (1922-1939) et Mussolini, pour régler la « question romaine ». La création de l’État du Vatican, par un point d’ancrage territorial, conforte la papauté dans sa souveraineté internationale déjà reconnue. ↑
12 Qui investit à titre personnel 335 000 francs dans l’affaire. ↑
13 Hamelin n’affirme-t-il pas que le pape doit rejoindre « la terre sacrée où le Christ a parlé ! C’est là qu’est son patrimoine, c’est là que doit être son royaume » ? Notons que ces catholiques n’ont pas renoncé au pouvoir temporel de l’Église. « Nous le ferons puissant et solide, ce royaume, nous le mettrons à l’abri des perturbations politiques, en basant son budget, avec la garantie des ressources du pays, sur une vaste banque dont les catholiques du monde entier se disputeront les actions. » Ingénument, Hamelin trahit les paroles du Christ : « Mon royaume n’est pas de ce monde » et le fameux « rendez à César ce qui appartient à César ». L’universalité du salut est profanée en une communion d’intérêt. Saccard d’ailleurs s’en inspirera pour dénommer sa banque Universelle au lieu de catholique. Que penser de cette caricature du catholicisme, surtout quand Zola raille : « Le trésor du Saint-Sépulcre, hein ? superbe ! l’affaire est là ! » ? ↑
14 « Terme de commerce. Enceinte où se réunissent les agents de change pour traiter de leurs affaires. Le parquet des agents de change. » Littré ↑
15 Saccard ne manque pas de clairvoyance sur lui-même : « il se disait qu’il était peut-être trop passionné pour cette bataille de l’argent, qui demandait tant de sang-froid. » ↑
16 « Aristide leva les yeux au plafond, répétant, écoutant la musique des syllabes :
— Sicardot…, Aristide Sicardot… Ma foi, non ; c’est ganache et ça sent la faillite. […]
— J’aimerais mieux Sicard tout court, reprit l’autre après un silence ; Aristide Sicard…, pas trop mal…, n’est-ce pas ? peut-être un peu gai…
Il rêva un instant encore, et, d’un air triomphant :
— J’y suis, j’ai trouvé, cria-t-il… Saccard, Aristide Saccard !… avec deux c… Hein ! il y a de l’argent dans ce nom-là ; on dirait que l’on compte des pièces de cent sous. » La Curée, chapitre II.
Selon son frère le ministre, c’est « un nom à aller au bagne ou à gagner des millions ». Toujours le jeu sur le sac qui peut contenir une fortune ou évoquer les gens de sac et de corde. ↑
17 Drumont, à la suite du livre d’Eugène Bontoux : L’Union Générale, sa vie, sa mort, son programme publié en 1888, s’y livre à des propos haineux contre la famille Rothschild. ↑
18 Si elle n’est pas le personnage principal du roman, elle est le porte-parole de Zola dans son honnêteté foncière, sa sagesse, sa bienveillance et son amour absolu de la vie. ↑
Voir aussi :
- Zola, La Fortune des Rougon, chapitre 1 (extrait)
- Zola, La Curée (chapitre 1)
- Émile Zola, La Joie de vivre, chapitre VII
- L’Argent, texte en ligne du roman
- L’Argent de Zola par Paul Lafargue publié dans « Die Neue Zeit » 1891-92, retraduit de l’allemand
- Argent et littérature : quelques réflexions sur le XIXe siècle (conférence)
- Le Krach de la Banque de L’Union Générale
- Comment le Crédit Lyonnais devint sage